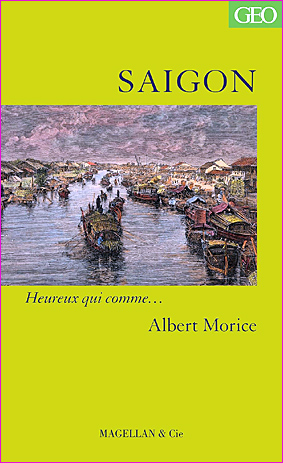
La collection Heureux qui comme… (référence au poème de Joachim du Bellay) accueille des récits de voyageurs du passé, comme la Sicile de Guy de Maupassant, Pompéi de Théophile Gautier, Florence d’Alexandre Dumas, Sparte de Maurice Barrès ou Angkor de Pierre Loti. Saigon (écrit sans tréma selon Albert Morice) s’appelle Hô Chi Minh-Ville depuis 1975 et la victoire nationale communiste du nord sur le sud. Utopie marxiste selon laquelle l’Histoire commence à Karl, renommant les villes en pré-Woke pour faire table rase de tout le passé. Ainsi Karl-Marx Stadt, Leningrad, Stalingrad, Hô-Chi-Minh-Ville. Comme si Paris s’était renommée François-Mitterrand-Ville…
Ce n’était pas « mieux avant » mais Albert Morice a connu le Saigon de 1872, ancien village de pêcheurs khmers proche du delta du Mékong devenue petite ville de cases sur pilotis des marchands viets et chinois venus par le grand fleuve. Les troupes coloniales françaises se sont emparées de Saigon en 1859, après la création d’un Ministère des Colonies l’année précédente. Albert Morice a alors 10 ans. Il deviendra médecin après deux ans d’études médicales (depuis, les études s’allongent à l’infini sans guère mieux soigner, hors techniques…) et demandera à partir en Cochinchine comme médecin de Marine en 1872. Il restera deux ans dans la péninsule indochinoise avant de revenir pour six mois en métropole où il publie sa suite d’articles sur Saigon dans la célèbre revue Le Tour du monde. Lorsqu’il repart en 1876, ce n’est que pour quelques mois, il est rapatrié sanitaire pour tuberculose et meurt à Toulon à 29 ans.
Il n’a pas eu le temps de faire d’enfant et s’intéresse à tout, en dilettante ou en naturaliste. Il aime les plantes, les insectes, les serpents, les animaux ; quant aux divers types humains, il les considère comme à l’époque de la suprématie blanche : des peuples-enfants à peine dérivés du singe. C’est du moins sa première impression, largement partagée par ses lecteurs à l’époque. Il changera d’avis au fil des mois et des pages, car cette supériorité culturelle n’engendre chez lui aucune haine, seulement de la répulsion initiale pour les mœurs et surtout la saleté. Le XIXe siècle est hygiéniste et Morice est médecin. Toutes les maladies comme la malaria, le trypanosome, le choléra, la dysenterie, la lèpre, le ténia, la variole, la bourbouille, se concentrent sous les tropiques, dans la proximité de l’eau et la promiscuité grouillante des êtres.
Ce qui ne l’empêche nullement d’avoir de l’empathie pour les petits mendiants qui donnent du feu aux cigarettes, « la grêle charpente des femmes annamites », et, « au milieu de ces vices des races privées de liberté, (…) des qualités qui permettent d’espérer beaucoup : une gaieté touchant trop souvent au persiflage, une aptitude puissante à apprendre et à comprendre et, chose singulière, un certain orgueil de race, du moins chez quelques-uns » p.27. Autrement dit, tout n’est pas perdu, l’éducation et l’hygiène vont civiliser ces mœurs encore sauvages. L’observation naturaliste se veut neutre d’idéologie, et le sentiment de fierté blanche se met en retrait face aux réalités des gens. Ce pourquoi Albert Morice, malgré les sursauts d’expressions qui nous semblent aujourd’hui inacceptables, reste un voyageur qui sait voir.
Ainsi « le gamin de Saigon », décrit comme le gamin de Paris de Delacroix dans son tableau sur la Liberté guidant le peuple (seins nus), ou le Gavroche de Victor Hugo que son auteur a fait mourir en 1832. Comme son modèle parisien d’enfant-moineau, « le gamin de Saigon est un être hybride : c’est un enfant de Paris enté sur un lazzarone, et transporté sous le soleil de l’Orient » p.31. A moitié nu ou en loques, il sert de porteur dans les villes, de guide et de ramasseur de gibier lors des chasses, de protecteur contre les buffles agressifs qu’il connaît bien, de tuteur aux Blancs inhabiles à marcher sur les minces talus des rizières alors que lui-même plonge « avec insouciance ses jambes dans l’horrible boue chaude » p.32.
Morice passe en revue les troupes annamites, les femmes congaï, leurs costumes, leurs caractères, le machouillage du bétel, la fumerie d’opium, l’enterrement, la fête du Têt, les spectacles (interminables) de marionnettes. Il préfère s’intéresser aux geckos, aux margouillats, aux crocodiles (qui se mangent), aux tigres (qui préfèrent dévorer l’indigène nu plutôt que le Blanc trop habillé), l’éléphant blanc, le cobra (dont il a pris la mère et une portée !), les fourmis noires (qui dévorent tout), les scorpions (aucun mortel), les araignées, les singes (de diverses sortes), les mini-cerfs, le varan, le pangolin, l’herpéton tentaculé (ou serpent à barbe qui vit dans l’eau)…
Quant à la ville, la rive « de droite était couverte de fort petites cases en torchis et en paillote, qui pour la plupart trempaient à moitié dans le Donaï ; sur la gauche s’étalait Saigon (et non pas Saïgon comme on s’obstine encore à l’appeler en France)» p.16. La ville blanche aux maisons de pierres grignote peu à peu l’arroyo chinois aux maisons de bois sur la rivière. Le médecin reste trois mois dans la capitale du sud avant d’aller en mission à Choquan et Cholon puis à travers toute l’Indochine.
Il recueillera nombre d’animaux, surtout des serpents, qu’il fera livrer au Jardin des Plantes à Paris, et des sculptures Cham (du IIe à la fin du XVIIe siècle) qu’il enverra au musée Guimet de Lyon. La moitié des caisses couleront avec le vapeur naufragé Meï-Kong des Messageries maritimes. Elles seront récupérées dans les fonds marins en 1995 et ramenées en Europe.
Un récit d’exotisme et de curiosité pour le monde et les êtres vivants qui montre combien le choc initial de civilisation laisse peu à peu place au décentrement de soi pour aborder la réalité des choses.
Albert Morice, Saigon, 1875, Magellan collection Heureux qui comme… 2018, 125 pages, €7,01, e-book Kindle €4,99 ou emprunt abonnés (mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

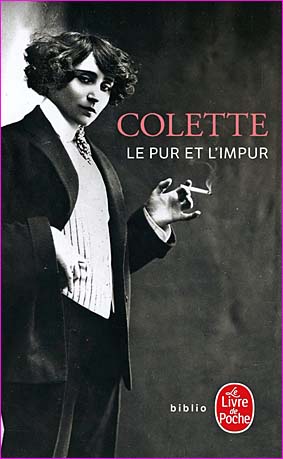
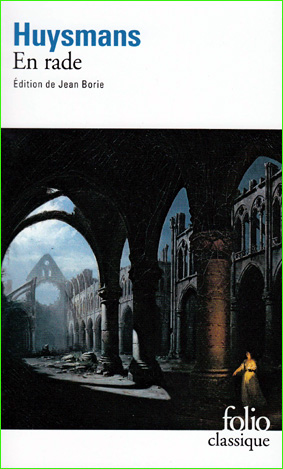




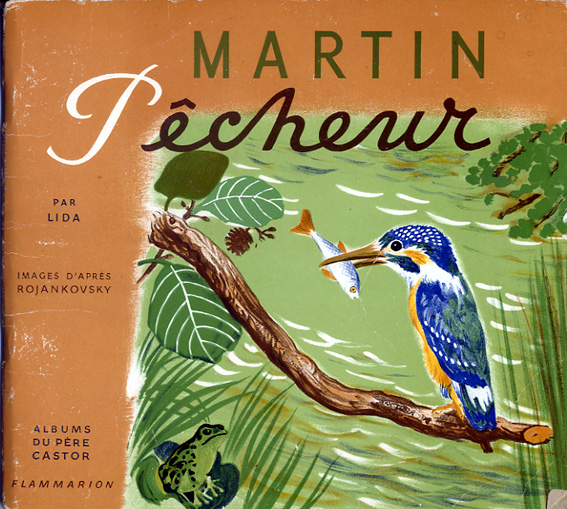

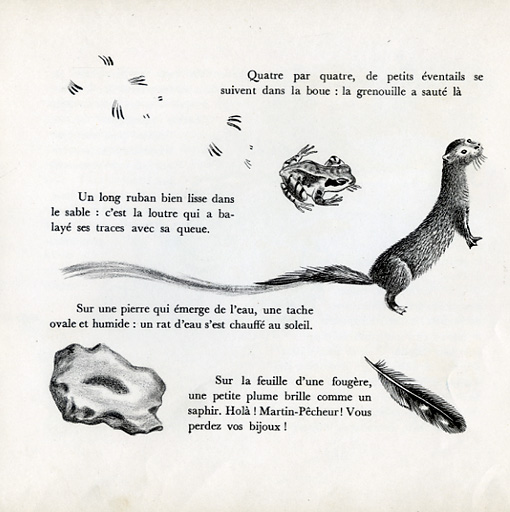

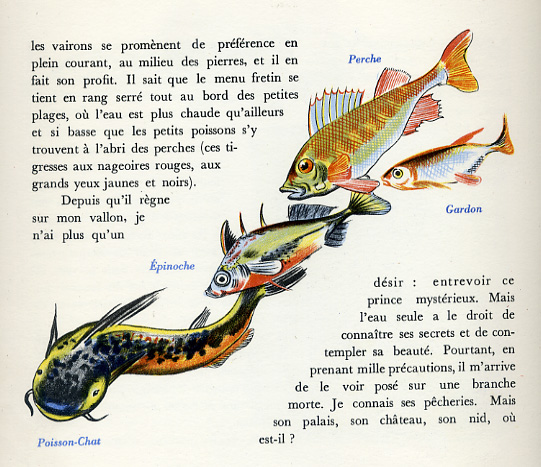
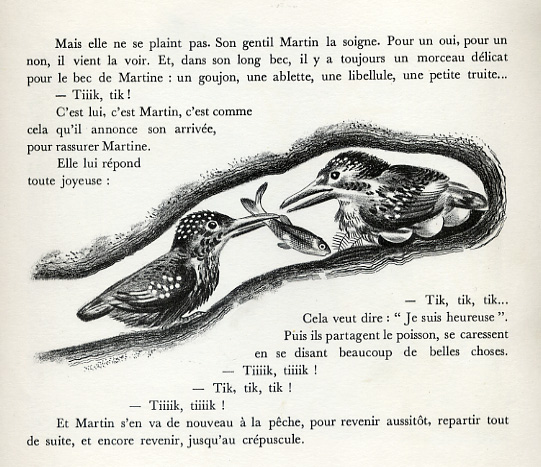
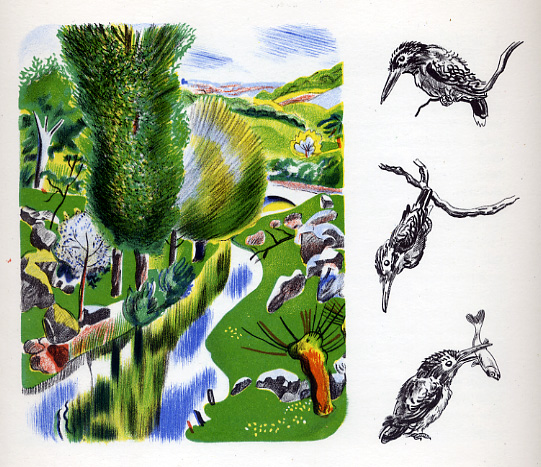

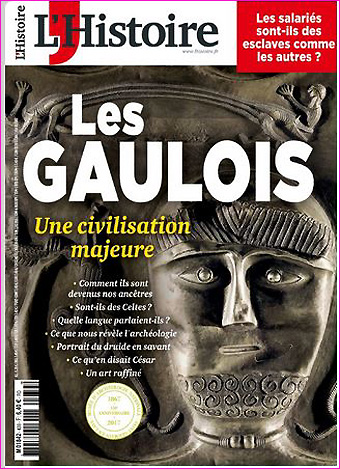

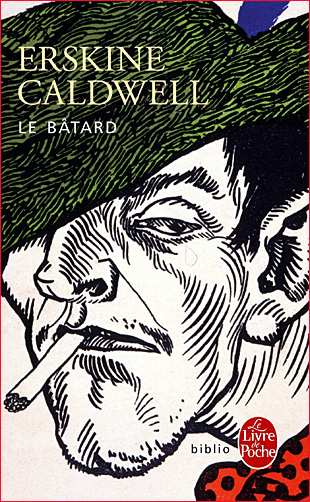

Commentaires récents