Dans la suite de ses titres courts, comme des interjections, l’auteur s’attaque cette fois aux paysans. Jacques et Louise fuient la ruine et les créanciers de Paris et se réfugient, le temps que soient réglées leurs affaires, chez l’oncle de l’épouse, dans la Brie. Il occupe avec sa femme un pavillon dans le parc du château de Lourps, en ruines, que le propriétaire, parisien, n’entretient pas. Mais il y a de la place et, si les pièces sont moisies et ruinées, elles offrent un toit au couple.
C’est l’occasion de belles pages sur le paysage de la campagne, écrites d’un style florissant et fluide. C’est l’occasion aussi de faire vivre les gens du coin au naturel, dans la veine naturaliste, en reproduisant leur langage. Le facteur ivrogne et glouton, la tante aux bras de camionneur, le curé qui expédie les messes, l’épicière obèse et enceinte (immonde vision !) qui exige quarante sous pour que sa péronnelle de fillette passe prendre la liste des commissions commandées. Mais Huysmans est un rêveur spéculatif qui préfigure le surréalisme. Il entremêle ses chapitres de réel avec trois chapitres de rêves, faisant (mal) alterner le jour et la nuit, le conscient et l’inconscient. C’est bancal mais intéressant. Dans le chapitre sur l’exploration lunaire, le lecteur se croit chez Jules Verne !
Il reste que la vie paysanne n’est guère réjouissante. Ce ne sont que récriminations sur le labeur physique harassant des champs, les problèmes sexuels des vaches et des jeunes, l’avarice pour l’argent et la bouffe, la cruauté envers les chats et les chat-huant. Ce n’est que crasse, superstition et ruse madrée – sans parler des aoûtats aux chaleurs et de la boue partout à la saison des pluies. L’église est lépreuse et les oiseaux de nuit fientent sur le Christ nu qui branle, laissant puer leurs proies mortes derrière l’autel. Les jeunes au bourg vont à tour de rôle, entre deux verres de vin, dans la même chambre de l’auberge pour les baisers et pelotages, puis par couple dans les bosquets de la campagne pour la baise ; une fois le polichinelle apparent, le curé se charge de régulariser. Ce n’est que machisme primaire envers des femelles déjà laides à 10 ans. Que galopades d’enfance, braillements vantards de jeunesse et parler fort d’adulte. Il faut être né dedans, et resté inculte, pour y trouver le bonheur.
Huysmans le pessimiste remet à sa place Rousseau et ses idéalismes, dont George Sand était l’héritière contemporaine : les mœurs et la morale de la campagne sont pires qu’à Paris. L’insensibilité, le cynisme et la rapacité bourgeoise trouvent leur origine directement dans le tempérament paysan. Après tout, le bourg(eois) est le cultivateur monté au bourg et enrichi dans le maquignonnage et le trafic, pas plus.
Ce qui a fait scandale et a été censuré par la revue qui a publié le roman en chapitres sont, outre les allusions au sexe direct entre jeunes, les scènes de vêlage et de saillie du taureau. C’est cru, brut, nature. Et les bourgeois ont horreur de la nature, des éléments bruts et de tout ce qui n’est pas apprêté ou cuit (jusqu’aux babas devenus bobos puis écolo-végano-puritains d’aujourd’hui).
Ce qui a été reconnu comme précurseur est le recours à ce qui deviendra plus tard la psychanalyse, via les symptômes de la « névrose » (qui s’avère le stade ultime de la syphilis) et surtout les rêves. Ils sont interprétés selon Wundt, Sully et Radestock, nés respectivement en 1832, 1842 et 1857. L’exploration imaginaire de la lune évoque, selon Gaston Bachelard, un dégoût mortifère de la matière organique et une préférence pour le minéral, figeant la vie dans l’immobilisme et la mort. L’adoption de la robe de moine de l’auteur sur la fin de sa vie ne sera qu’un enterrement dans le siècle avant la mort définitive. Jusqu’au château lui-même comme figure de l’inconscient humain, de belle apparence mais délabré de l’intérieur, aux volets déglingués mais aux souterrains massifs et labyrinthiques qui conduisent on ne sait où. Huysmans évoque « un fil souterrain fonctionnant dans l’obscurité de l’âme » p.810 Pléiade.
Cette immersion maternelle dans la terre qui ne ment pas, cette régression à l’enfance à la campagne, cette expérience du château ruiné mais solide font pendant aux rêves de luxure avec Esther violée par Assuérus, l’arpentage de la lune avec sa femme, la rencontre de la Grande Vérole hideuse. Ils rendent le retour à Paris à la fois nécessaire et médical. L’air est plus sain mais l’on étouffe en province : d’ennui, de mesquinerie, de décombres. Surtout ne pas rester en rade dans le bled, isolé et ignoré de tous, sans aucune perspective que de voir la pluie tomber ou le soleil griller. Vivement les livres, le théâtre et la « contre-nature » de l’existence urbaine !
Joris-Karl Huysmans, En rade, 1887, Gallimard Folio 1984, 256 pages, €8.50
Huysmans, Romans et Nouvelles, Gallimard Pléiade 2019, 1856 pages, €73.00
Huysmans sur ce blog

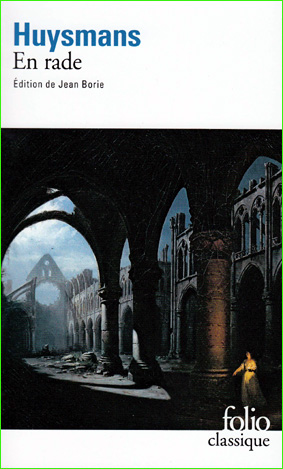











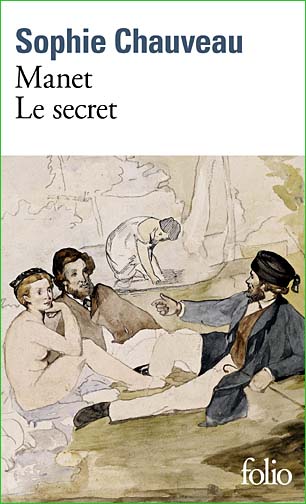
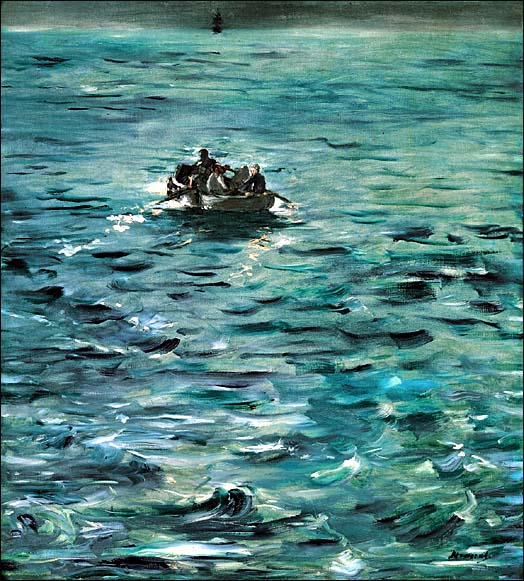

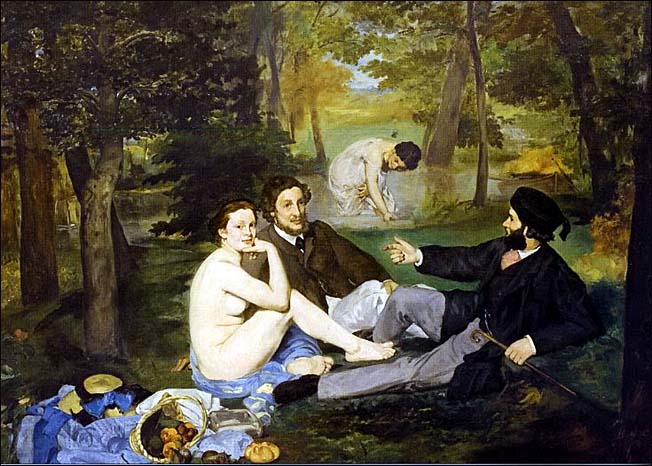
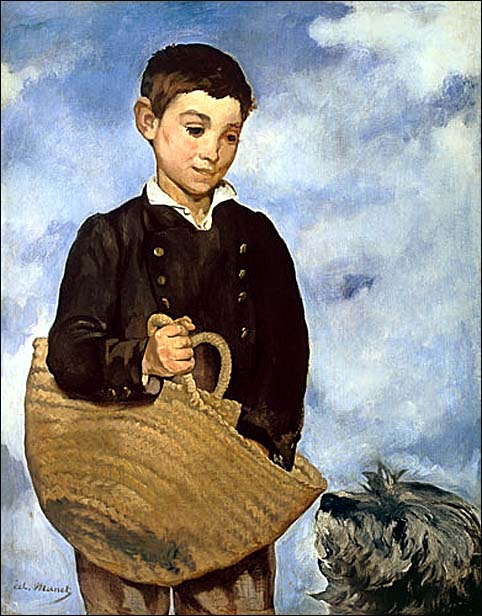

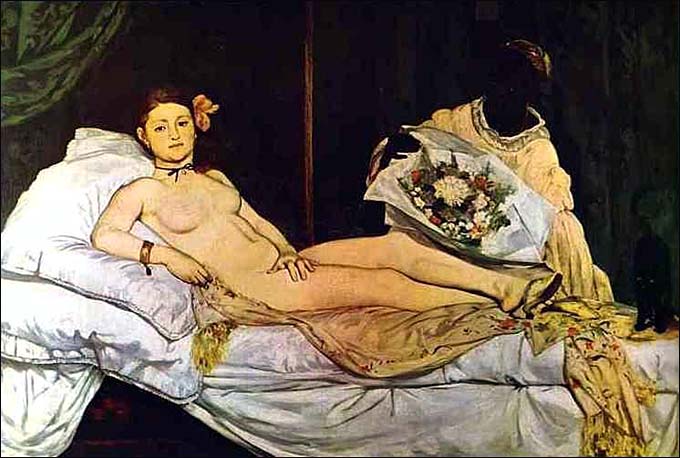
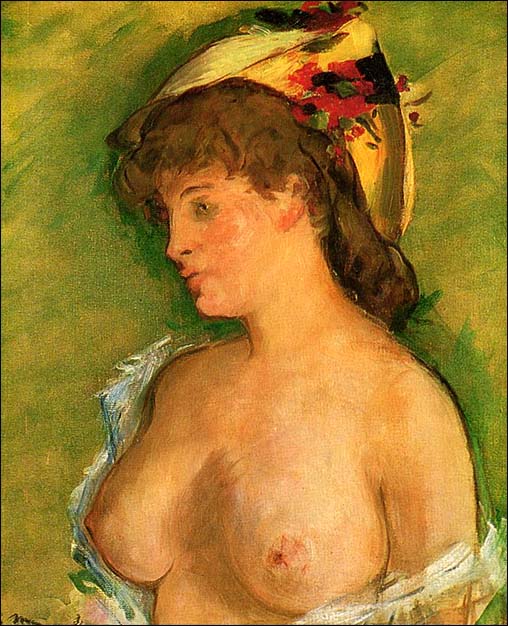

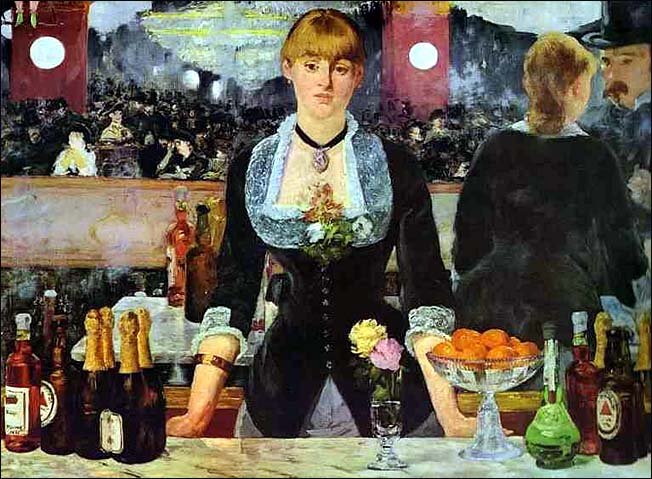


Commentaires récents