Vous lisez le premier polar – bon sous tous rapports – d’un acteur reconverti dans les comédies romantiques. Il est né en Angleterre mais Slovaque, marié à un mec, Ján, et connaît Londres, la ville européenne cosmopolite, comme sa poche. Autrement dit, il n’y aura pas que de l’intrigue mais aussi tous ces préjugés de classe et de race que véhicule le choc de mondialisation.
Andrea est une jeune fille riche d’à peine vingt ans dont le père est vendeur d’armes international nommé baron depuis peu et siégeant à la chambre des Lords. Lui et elle sont, autrement dit, de l’Establishment. Qu’allait-elle donc faire en bomber rose et minijupe par un soir d’hiver où il neige, dans ce quartier sordide et mal famé de Londres où même les téléphones mobiles n’ont pas de réseau ? Quel est cet homme contre qui elle récrimine violemment toute seule ? Quel est ce personnage qui surgit en voiture et s’arrête ? Dès le premier chapitre, vous êtes saisis.
Dès le second, l’auteur vous met dans l’ambiance. Un looser au chômage accomplit sous la neige son travail d’intérêt général obligatoire pour toucher ses allocations lorsqu’un téléphone se met à sonner sous un hangar à bateau du parc dont il aide au jardin. Il le voit et le convoite, c’est un iPhone 5S de grand prix. Mais la glace du lac cède sous son poids et… il se retrouve non seulement transis mais médusé devant un cadavre qui le regarde les yeux grands ouverts, un masque de terreur figée sur le visage. Andrea est morte étranglée, la chatte à l’air, et les tabloïds se déchaînent comme des vautours avides de fric…
L’enquête est confiée à Erika Foster, Slovaque d’origine et mariée à un ex-flic qui s’est fait descendre sous ses yeux et sous ses ordres par des trafiquants de drogue quelques mois plus tôt lors d’une opération. Son origine lui vaut le mépris du lord père d’Andrea, qui met tous les immigrés d’Europe centrale dans le même sac ; son genre lui vaut l’hostilité du détective chef Sparks qui aurait dû voir se confier l’enquête bien qu’il ne fasse pas des étincelles. Le superintendant Marsh la soutient parce qu’elle lui a fait rencontrer sa femme, avec laquelle il est très heureux, et qu’elle est à son avis une bonne enquêtrice.
Qui l’a fait ? Mystère épaissi à merci par les multiples pistes, à commencer par celle du double téléphone et du compte Facebook d’Andrea, interrompu brutalement six mois plus tôt dans le même temps qu’une amie d’Europe centrale disparaissait sans laisser de traces. Andrea adorait poser à demi nue en situation sexuelle avec un partenaire sur les photos de son téléphone qu’elle postait ensuite sur les réseaux (Facebook ne s’était pas encore converti à la pudibonderie). Qui est ce beau mâle musclé torse nu qui lui agrippe un sein sous le corsage avant de lui croquer le mamelon sur une autre vue alors qu’elle rit devant l’appareil ? Ou cet autre dont elle suce complaisamment le vit dressé ? Par qui ces photos ont-elles été prises ? Est-ce par le fiancé désespéré ? Il n’a pourtant pas le physique de l’emploi, courtaud et grassouillet… Est-ce par David le petit frère, beau gosse qui ressemble à Andrea et est aussi fêtard ? Ou par Linda, la sœur mal fagotée et plutôt laide un brin jalouse, mais qui adore les chats ? La mère est une hypersensible évaporée, le père un hypocrite de classe. Tous veulent que l’enquête soit bouclée rapidement sans scandale et qu’un coupable soit désigné – et peu importe si ce n’est pas le bon.
Erika ne l’entend pas de cette oreille parce qu’elle sort des normes : en temps que femme, en tant que Slovaque, en tant que flic – DCI dans le jargon, Detective Chief Inspector, soit un enquêteur à trois étoiles sur l’épaule, l’équivalent d’un capitaine de police chez nous. Elle ne supporte pas qu’une femme ait pu être étranglée et jetée comme un vulgaire kleenex, d’autant que d’autres meurtres lui sont peut-être reliés ; elle ne supporte pas les grands airs de supériorité impériale de ceux qui se laissent abuser par leurs préjugés et foncent One Direction ; elle ne supporte pas les pressions politiques et sociales des parents fortunés qui actionnent leurs relations, payent des avocats et même des témoins au détriment des faits, préférant la convenance à l’exactitude. Son chef, pris entre deux feux, la cruelle lumière de la vérité et la douce chaleur de sa carrière, fait du stop and go : à chaque fois qu’Erika s’enlise, il lui retire l’affaire ; à chaque fois que l’enquête s’enlise, il la rappelle sur l’affaire. Il lui faut gérer la famille, la presse, ses supérieurs et ses subordonnés, sans parler de son couple et ses deux enfants. Pas simple. Quant à Erika, elle a à gérer encore la mort de Mark – et son équipe à qui elle offre café et donuts.
Chapitres courts, suspense aménagé, critique sociale sans pitié, font de ce premier polar d’un auteur non conventionnel une réussite. L’enquête avance dans les milieux troubles de la jet-set, des noceurs en soirées et des putes en pubs, côtoie la politique et les implications internationales, use et abuse d’Internet, des réseaux sociaux et du mobile. Erika agit souvent en inconsciente, poussée par sa droiture et son courage, moins intéressée par sa carrière que par la traque, mais aussi peu soucieuse des procédures et précautions élémentaires. Elle finira battue, assommée et noyée – ou presque – mais un happy end in extremis, au bout de 400 pages, punira les méchants et récompensera les bons. Et vous ne devinerez pas avant la fin qui est le coupable !
Robert Bryndza, La fille sous la glace (The Girl in the Ice), 2016, Belfond 2018, 438 pages, €19.90, ebook format Kindle €13.99

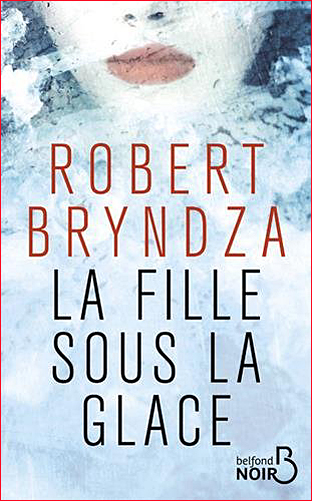
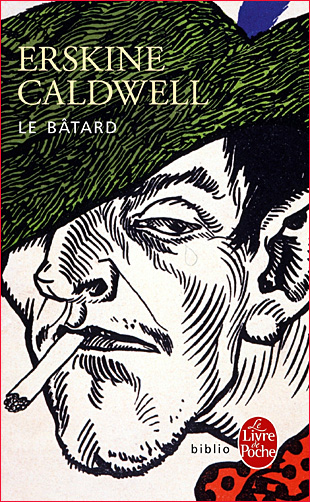



Commentaires récents