Le chapitre II du Livre II des Essais est consacré à « l’ivrognerie », mais Montaigne digresse volontiers. Il prend prétexte d’un thème pour en aborder d’autres, par association d’idées ou conjointement. En ce Livre II, il se sent moins contraint par la forme, plus libre d’aller par sauts et gambades comme il aime à le dire.
Il commence donc par l’ivrognerie, qui est un vice, mais pas n’importe lequel. C’est un vice « grossier et brutal », « tout corporel et terrestre ». Rien à voir avec l’esprit du vin mais tout avec la lourdeur de l’ivresse. Seuls les Allemands le tiennent en crédit, relate-t-il. « Les autres vices altèrent l’entendement ; celui-ci le renverse, et étonne le corps. » Rien de pire pour Montaigne, adepte de la tempérance et de l’équilibre harmonieux de l’âme et du corps, des passions et de la raison. « Le pire état de l’homme, c’est quand il perd la connaissance et gouvernement de soi. »
Exemples : non seulement le pris de vin titube et ne sait plus se tenir, mais il révèle les secrets les mieux enfouis dans sa conscience, trahissant sans le savoir comme cet ambassadeur, ou se livrant à la débauche sans conscience, comme Pausanias enivré par Attale, sa beauté abandonnée « aux muletiers et nombre d’abjects serviteurs de sa maison ». Une chaste veuve de village « vers Castres », rapporte Montaigne sur la foi du témoignage direct « d’une dame que j’honore et prise singulièrement », se trouve enceinte mais elle ne sait pas de qui, n’ayant fauté avec personne à sa connaissance. « Elle en vint là de faire déclarer au prône de son église que, qui endosserait ce fait en l’avouant, elle promettait de lui pardonner et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. » Ce qui fut fait. Péché ignoré mais avoué, est à demi pardonné. « Un sien jeune valet de labourage, enhardi par cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, un jour de fête, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir, sans l’éveiller. » Comme délicatement ces choses-là sont dites… Mettez, pas mitou. Montaigne conclut cette anecdote sobrement : « Ils vivent encore mariés ensemble ».
Un fois ces exemples posés, ce malheur de trop boire qui peut tourner en bien est-il un vice majeur ? « Il est certain que l’Antiquité n’a pas fort décrié ce vice », constate Montaigne. Il pèse toujours le pour et le contre avant de balancer pour le milieu juste. Il commence par le préjugé courant : s’enivrer est un vice (et un péché d’église), puis propose la contradiction avec les sages antiques, avant d’avancer ce qu’il pense de la chose.
Socrate et Caton s’enivraient parfois et même « Silvius, excellent médecin de Paris » dit de son temps qu’il est bon de faire un excès de boisson une fois par mois pour garder les forces de notre estomac. Nous tempérerions ce conseil de nos jours par sa version psychologique : se lâcher de temps à autre est bon pour le moral, pas pour le corps, même s’il le supporte. Mieux, dit Montaigne, plus on avance en âge, plus la boisson reste la seule consolation pour égayer l’esprit et le corps, les forces libidinales déclinant. La façon de boire à la française, durant les deux repas de la journée, est bien trop tempérée. « Mais c’est que nous nous sommes beaucoup plus jetés à la paillardise que nos pères », observe Montaigne. Les périodes de guerre, fussent-elle civiles et de religion, incitent à baiser par quelque compensation naturelle d’engendrer pour remplacer les morts. Les périodes de paix sont plus moralisantes et substituent au plaisir charnel la boisson ou la drogue, mieux socialement acceptées.
C’est à ce moment qu’est inséré un paragraphe sur son père, « très avenant, et par art et par nature, à l’usage des dames. » Il prisait Marc-Aurèle, « la contenance, il l’avait d’une gravité douce, humble et très modeste. Singulier soin de l’honnêteté et décence de sa personne et de ses habits, soit à pied, soit à cheval. Extraordinaire fidélité en ses paroles (…). Pour un homme de petite taille, plein de vigueur et d’une stature droite et bien proportionnée. D’un visage agréable, tirant sur le brun. Adroit et exquis en tous nobles exercices. » Un modèle pour son fils ; un modèle pour tout homme.
Revenant à la boisson, Montaigne ne voit pas quel plaisir il aurait à boire outre mesure. C’est « se forger en l’imagination un appétit artificiel et contre nature ». Son estomac n’y pourrait. La raison antique met des limites, comme c’est son rôle : « Platon défend aux enfants de boire vin avant 18 ans, et avant 40 de s’enivrer ; mais, à ceux qui ont passé les 40, il ordonne de s’y plaire ; et mêler largement en leurs banquets l’influence de Dionysos, ce bon dieu qui redonne aux hommes la gaieté, et la jeunesse aux vieillards, qui adoucit les passions de l’âme, comme le fer s’amollit par le feu. » Mais on ne boit pas en guerre, ni pour les magistrats avant de proférer un jugement, ni si l’on veut procréer un enfant. Montaigne est pratique et humain. Il relativise le « péché » catholique par la vertu d’équilibre antique, il interdit aux jeunes pour leur santé et le permet aux vieux pour leur gaieté.

Attention cependant à notre vanité : l’ivresse est un relâchement, un abandon, une faiblesse. « Lucrèce, ce grand poète, a beau philosopher et se bander, le voilà rendu insensé par un breuvage amoureux. » L’ivresse rend fou, pas sage, car « la sagesse ne force pas nos conditions naturelles ». Elle est une maîtrise, pas une armure. Montaigne, incliné vers les Stoïciens durant tout le Livre I, s’en détache dans ce nouveau Livre II. Le stoïcisme est trop fier et trop sectaire, l’humanité n’est pas si roide. « Quand nous entendons en Josèphe [l’historien Flavius Josèphe évoquant le martyr des sept frères Macchabées] cet enfant tout déchiré des tenailles mordantes et percé des alênes d’Antiochus, le défier encore », « il faut confesser qu’en ces âmes-là il y a quelques altération et quelque fureur, tant sainte soit-elle ». Ces « extravagances » masochistes qui jouissent de souffrir et de défier le bourreau, ne sont point sagesse mais folie, comme l’ivresse mais en plus grand. La « sainteté » n’est-elle pas une ivrognerie, ose suggérer Montaigne sans le dire ?
Et de se réfugier aussitôt derrière les Antiques pour ne pas vexer l’Eglise et saint Augustin qui l’évoque, et de tempérer aussitôt son propos absolu par la relativité humaine :« Aussi dit Aristote qu’aucune âme excellente n’est exempte de mélange de folie. Et a raison d’appeler folie tout élancement, tant louable soit-il, qui surpasse notre propre jugement et discours. D’autant que la sagesse, c’est un maniement réglé de notre âme, et qu’elle conduit avec mesure et proportion, et la maîtrise. » Voilà donc ce que Montaigne pense, tout au bout du chapitre. Quand nous sommes hors de nous-mêmes, nous pouvons être poète ou prophète, ou combattant héroïque – mais aussi pris de boisson et traître ou débauché… Tout est possible lorsque nous ne contrôlons plus rien de nous. Notre jeunesse à nous, en raves et autres prises hallucinatoires, rêve de s’élever alors qu’elle se vautre trop souvent. La sagesse est bien éloignée…
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog


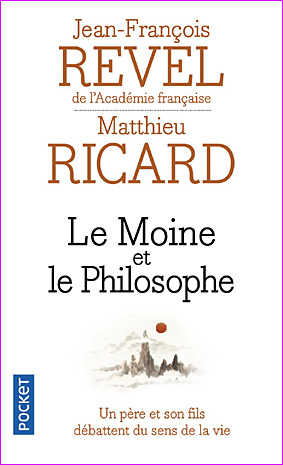

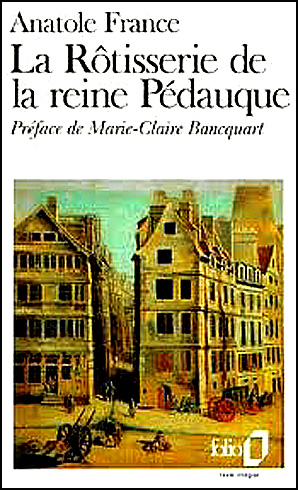

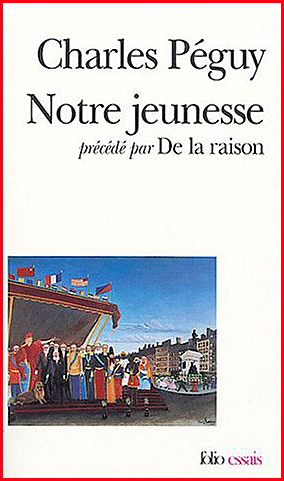


Commentaires récents