« Des prières » est le titre du chapitre LVI des Essais, livre 1. Il traite de Dieu et de la façon de se présenter à lui, humbles humains.
Montaigne s’empresse de parer les foudres éventuelles de l’Église (catholique) en son temps de guerre de religion. « Je propose des fantaisies informes et irrésolues, comme font ceux qui proposent des questions douteuses à débattre aux écoles ; non pour établir la vérité, mais pour la chercher ». Pas question de nier ou de remettre en cause « les saintes prescriptions de l’Église catholique, apostolique et romaine, en laquelle je meurs et en laquelle suis né », affirme-t-il. Il pense et il offre au jugement d’autrui de corriger et de préciser sa pensée ; il affirme son appartenance à son camp, sans réserves ; il croit que la voie juste est de suivre la croyance et morale de la société dans laquelle on est né.

Sur la prière, seuls les mots consacrés doivent être utilisés – et pas ceux qui appellent des faveurs. « J’avais présentement en la pensée d’où nous venait cette erreur de recourir à Dieu en tous nos desseins et entreprises, et l’appeler à toutes sortes de besoin et en quelque lieu que notre faiblesse veut de l’aide, sans considérer si l’occasion est juste ou injuste ; et d’écrier son nom et sa puissance, en quelque état et action que nous soyons, pour vicieuse qu’elle soit ». Dieu n’est pas à notre service, dit Montaigne, il est juste et « il use bien plus souvent de sa justice que de son pouvoir, et nous favorise selon la raison de celle-ci, non selon nos demandes ». Il faut donc avoir « l’âme nette » pour le prier avec quelque efficacité ; on ne suborne pas Dieu comme n’importe quel juge car Il voit. La prière sert pour soi, à se laver de ses fautes, pas à demander quelque chose.
« Voilà pourquoi je ne loue pas volontiers ceux que je vois prier Dieu plus souvent et plus ordinairement, si les actions voisines de la prière ne me témoignent quelque amendement et réformation ». Car c’est user de la prière comme d’une formule magique, pas comme d’un repentir sincère ni d’un vœux pieu. « Nous lisons ou prononçons nos prières. Ce n’est que mine ». Du théâtre, pas l’ouverture de son âme. Une superstition, comme « trois signes de croix au bénédicité, autant à grâces ». Cependant que « toutes les autres heures du jour, [sont à] les voir occupées à la haine, l’avarice, l’injustice ». Comme si l’heure consacrée à Dieu venait compenser l’heure consacrée aux vices, annulant la faute.
Au contraire, « il ne faut mêler Dieu en nos actions qu’avec révérence et attention pleine d’honneur et de respect », dit Montaigne. « C’est de la conscience qu’elle doit être produite, et non pas de la langue ». Inverse de la religion romaine, tout extérieure et civique, la religion chrétienne est tout intérieure et personnelle. Chacun est seul et nu en sa conscience face à Dieu, et cette introspection permet de voir clair et de s’amender. « Sursum corda – élevons nos cœurs », rappelle Montaigne.
Mais il se montre contradictoire. S’il pense par lui-même, il ne croit pas que chacun en soit capable. Il défend pour cela l’Église catholique qui réserve la lecture et l’interprétation des Livres sacrés aux prêtres, contre la Réforme protestante qui les livres à chacun. « Ce n’est pas l’étude de tout le monde, c’est l’étude des personnes qui y sont vouées, que Dieu y appelle. Les méchants, les ignorants s’y empirent ». Et il est vrai qu’on peut le constater avec Daech, la lecture littérale du Coran par les ignorants fait des ravages ; on le constate aussi avec les intégristes des sectes américaines, férus de Bible, qui mettent tout sur le même plan. « Plaisantes gens qui pensent l’avoir rendue maniable au peuple, pour l’avoir mise en langage populaire ! » On peut dire la même chose de l’Internet, qui a rendu tout accessible, même aux ignares, ce qui en fait de faux savants qui croient détenir la vérité alors qu’ils ne vérifient pas leurs sources. « Une science verbale et vaine, nourrice de présomption et témérité », analyse Montaigne. En fait, ce qui est en cause n’est pas la vulgarisation de la connaissance, mais l’éducation. Montaigne confond les deux, ce qui est de son temps, mais lui permet surtout « d’être d’accord » avec l’Église catholique, se défaussant ainsi de tout soupçon d’hérésie protestante.
S’il place au-dessus de toute discussion les textes sacrés, il affirme à nouveau que ses Essais sont des « fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et séparément considérées, non comme arrêtées et réglées par l’ordonnance céleste, indubitables et d’altercation ; matière d’opinion, non matière de foi ; de ce que je pense selon moi, non ce que je crois selon Dieu, comme les enfants proposent leurs essais… » Mais alors, pourquoi en parler ? Montaigne se fait l’objection à lui-même. Et il répond : « En quelque manière que ce soit que nous appelons Dieu à notre commerce et société, il faut que ce soit sérieusement et religieusement ». Autrement dit on peut parler de tout lorsqu’on en parle sincèrement, ouvert aux critiques et prêt à corriger ses erreurs ou inadvertances. « Celui qui appelle Dieu à son assistance pendant qu’il est dans le train du vice, il fait comme le coupeur de bourse qui appellerait la justice à son aide ».
D’où la volonté de remettre la prière à sa place, non comme une formule magique mais comme une réconciliation avec Dieu et le retour à la loi divine. « Il semble à la vérité que nous nous servons de nos prières comme d’un jargon et comme ceux qui emploient les paroles saintes et divines à des sorcelleries et effets magiciens ». Or « il n’est rien si aisé, si doux et si favorable que la loi divine ; elle nous appelle à soi, ainsi fautiers et détestables que nous sommes ». Encore faut-il être sincère et « au moins pour cet instant (…) avoir l’âme rebutée par ses fautes et ennemie des passions qui nous ont poussé à l’offenser ». Soyez vrais, dit Montaigne, sinon vos prières ne seront que textes sans chair, marmottements sans conviction, superstition et non religion.
Cet examen de conscience n’est pas réservé qu’aux croyants. Il est aussi le doute que tout scientifique doit garder à l’esprit, l’ouverture que tout sage conserve sur ce qui advient.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog

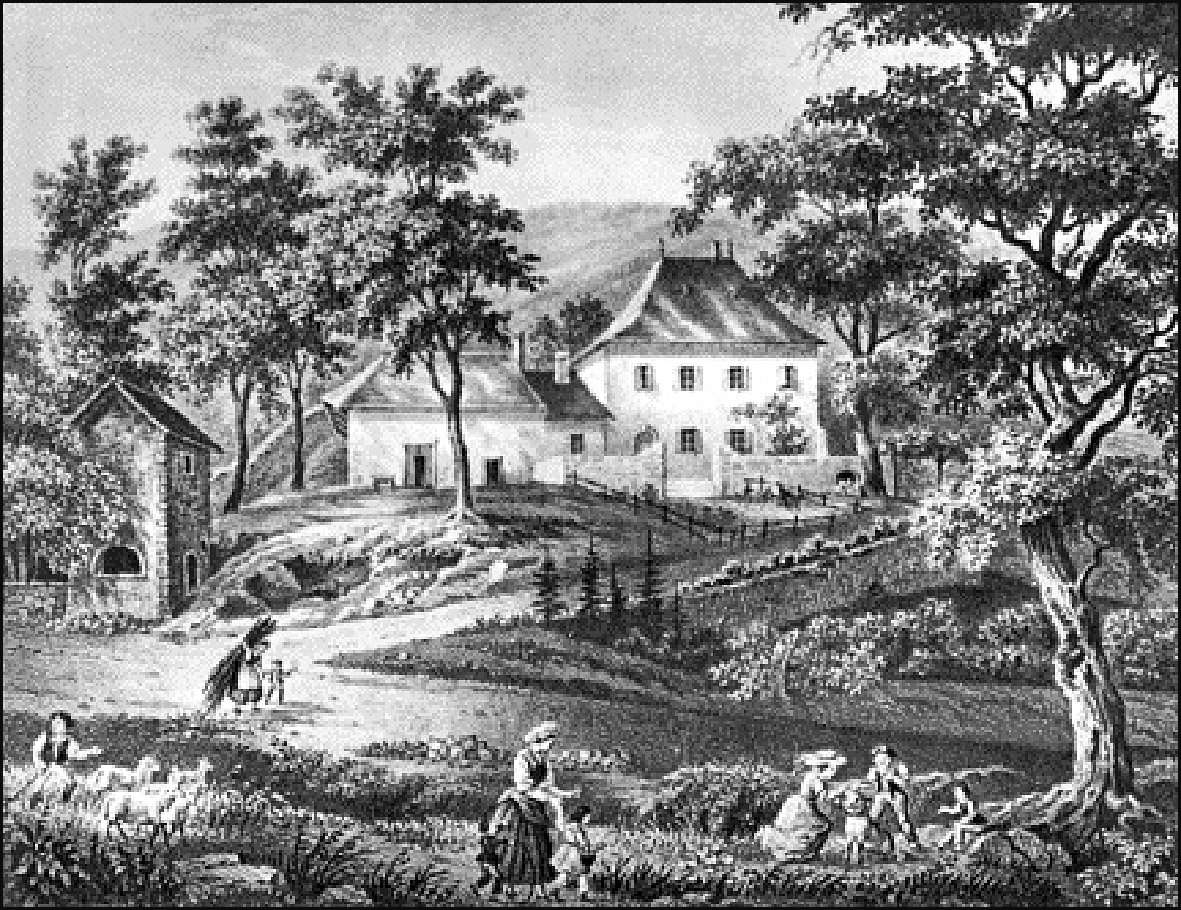

Commentaires récents