Le millésime 2020 restera dans l’histoire comme l’année 1918 ou 1945, une grande année pour l’humanité. Une année mondiale avec de grosses interrogations sur la crise. C’est le premier confinement depuis la guerre, la première vraie pandémie depuis 1918, la première fois dans l’histoire humaine que le monde entier est touché à peu près en même temps, 3.5 milliards de confinés ! Les atouts et les faiblesses des sociétés comme des gens s’y révèlent. Mais aussi le fait de regarder cette fois tous dans la même direction : l’humanité entière. Ce qui peut changer les mentalités.
Durant les premiers mois de la pandémie, la France centralisée, autoritaire, administrative, peine à déstocker, à faire produire ou à faire livrer les masques de protection ; l’impréparation est manifeste, malgré les précédentes alertes dues à des virus ou des catastrophes chimiques ; la bureaucratie des hiérarchies intermédiaire fait barrage, ralentit, réticente et imbue de son petit pouvoir. Les hôpitaux sont débordés et les médecins libéraux trop sollicités ; rien n’a été réorganisé pour donner de la souplesse et de l’efficacité depuis des décennies (le numerus clausus, l’absence de liste de matériel obligatoire à conserver en permanence, la gestion du chiffre à l’hôpital, les budgets en baisse rabot sans tenir compte des particularités locales, le caporalisme de Paris, l’absence de moyens déplaçables, l’indigence relative de l’armée en renfort).
Les politiciens ont fait avant tout de la politique avant de faire de la santé, autorisant de façon honteuse les élections municipales en mars puis changeant de cap drastiquement le soir-même (!) en instituant le confinement. Tout en faisant dire par la porte-parole si bête que « les masques ne servent à rien », faute d’en avoir en quantité suffisante ! Les gens n’ont pas cru vraiment au danger pandémique et se sont retrouvés trop souvent dehors, certains partant même en vacances dans les résidences secondaires. Le 1er mai voit Marine Le Pen en femme voilée (un comble !) aller fleurir Jeanne d’Arc et une manif de la CGT sans souci de la promiscuité, au contraire « des entreprises » où le même syndicat se dit inquiet pour les travailleurs sur les mesures de distance sociale. L’économie, évidemment devenue trop dépendante de l’étranger, en pâtit. Seuls les agriculteurs travaillent comme si de rien n’était, approvisionnant les magasins. La bourse s’est effondrée, un tiers en moins depuis le plus haut, l’incertitude est majeure sur la suite et la dette s’accumule sans compter – l’or monte, signe des temps. Une seule chaîne de radio publique semble subsister pour les informations et les journalistes travaillent depuis chez eux, les interviews se font par téléphone ; côté télé, ce n’est guère mieux, on recycle les vieilles séries et les vieux documentaires.

Le réseau Internet sature, malgré les vingt-cinq ans écoulés depuis son origine. Le dimanche de Pâques, le débit Internet est faible en fin de matinée : les gens du coin sont-ils tous à regarder la messe papale sur le net en même temps ? La décroissance écolo est là dans les faits, comme la démondialisation forcée – et ce n’est pas la joie ! Un bon point : la pollution recule et les « vraies valeurs » (comme on dit) se révèlent : produits de première nécessité, agriculture et culture, livre, disque, vidéo, cultiver son jardin. Mais je plains les parents isolés en appartement à Paris avec trois ou quatre gosses ! Il faut les occuper, gérer les relations, laisser un coin à chacun. Jeux de société, cuisine, lecture commune, discussion avec les ados, musculation et exercices, devoirs scolaires, il y a de quoi faire, mais cela demande une discipline, un programme, des horaires. Tout ce que la société hédoniste et portée vers le tout-technique n’a pas appris aux générations nées depuis Mitterrand.
Une jeune fille que je connais bien – 16 ans – pense que le monde sera très différent après ; j’ai un doute, connaissant l’inertie mentale des sociétés et les habitudes ancrées que l’on répugne à changer. Il y aura évidemment des remises en cause, notamment sur les secteurs les plus indispensables : la santé, l’alimentation, les technologies de communication, l’énergie. Ces secteurs sont stratégiques et nous ne devons pas dépendre de l’extérieur, ou du moins hors de l’Union européenne. Les usines des grands groupes seront probablement incitées à imaginer un potentiel de reconversion rapide en cas de choc sanitaire, comme en cas de guerre : les robots de Renault sont programmables et peuvent fabriquer autre chose que des pièces auto. Les sous-traitants étrangers vont être diversifiés. Quant aux « grandes questions » auxquelles mon ado songeait probablement, elles seront peut-être plus communes en effet, la mentalité Confucius rejoignant l’antique culture gréco-romaine d’Europe pour contrer l’égoïsme sacré anglo-saxon, de Boris Johnson à Donald Trump en passant par la Suède – tous pays qui ont laissé faire et laissé passer, engendrant un nombre de morts du Covid plus élevé qu’ailleurs. Le climat, les ressources, l’énergie, vont peut-être profiter de cette nouvelle façon mondiale de voir. Peut-être.
Côté social durant ce premier confinement, si vous n’appelez pas vos amis, rares sont ceux qui en prennent l’initiative : la peur de déranger, le texto obligatoire avant de décrocher, nouvelle mode due aux solliciteurs mal payés qui téléphonent pour vendre n’importe quoi. Untel que j’appelle m’annonce évidemment qu’il « allait m’appeler » car il a le temps – comme tout le monde – et envie de prendre des nouvelles (mais il ne l’a pas fait). Les jeunes trouvent le temps long et un mien proche dans sa vingtaine s’étonne du nombre de gens dans les rues de son quartier parisien qui circulent, malgré le confinement « strict ». Il vaut mieux en effet se confiner à la campagne avec jardin plutôt qu’entre quatre murs d’appartement où le soleil ne pénètre jamais, alors que les parcs et jardins sont fermés. Un voisin plus jeune – 16 ans – en école d’hôtellerie a des cours à distance mais, pour la cuisine, pas simple de faire un stage ou de passer un examen…
Je donne cette année mes cours de Master 2 à distance, procédure obligatoire via Teams de Microsoft choisi par l’Ecole. Parler en virtuel apparaît relativement simple mais est plus éprouvant qu’en face à face car l’interactivité n’est pas réelle et l’orateur a tendance à avoir peur des silences. Il y a apparemment autour de trente connectés à mon cours mais pas plus de sept ou huit participent en posant des questions par écrit dans le menu déroulant (parfois dans un français et avec une orthographe déplorable – cela se voit moins à l’oral…). Sans les voir, les échanges sont réduits et les pauses non annoncées paraissent intolérables : conclusion de cette primo-expérience, je parle trop, j’en ai mal à la voix en fin de première matinée. Il y en aura quatre comme cela ; difficile de s’habituer à ce nouveau format même si je vois désormais ce qu’il faut peu à peu aménager.
Un ami, dans la quarantaine, est toujours divorcé et toujours en acrobaties pour voir ses enfants de 14 et 11 ans, un garçon et une fille. La mère, toute-puissante aux yeux de la loi pour des enfants mineurs, est partie s’installer loin de son ex et lui a dû suivre provisoirement s’il veut exercer son droit légal de visite et garder contact avec sa progéniture. Avant le confinement, il était en petits boulots, employé imprimeur, barman, pizzaiolo, livreur de pizzas – tous ces emplois de services de proximité qui se sont figés avec la pandémie. Même les chambres de gîte, qu’il a fait aménager dans la maison de sa grand-mère, ne sont plus louées… Il n’a plus guère de revenus !
Durant le premier confinement annoncé « strict », la grand-rue de ma ville de banlieue verte autour de Paris paraît aussi pleine qu’un jour de semaine ordinaire : commerçants ouverts, couples dans les rues ; seule la Poste ne reçoit que deux ou trois personnes à la fois, les guichetiers masqués et protégés par une vitre, du gel pour les mains. La boulangerie a restreint ses horaires d’ouverture et n’accepte qu’une personne à la fois en boutique ; elle affiche même au bout de trois semaines une exigence de commande 48 h à l’avance, faute de farine en suffisance pour contenter tout le monde. Mais je n’ai jamais vu autant de promeneurs de chiens, parfois le même chien qui mène un autre maître ou maitresse en laisse pour faire semblant d’être « autorisé ». Je vois de ma fenêtre un promeneur de chien rafler tous les pissenlits qui commencent à vigoureusement pousser et fleurir en ce printemps agréable entre les interstices des murs de la rue ; ce n’est pas bête, il « fait ses courses » de confinement.
Les piafs en profitent, jamais on ne les a entendu autant chanter. L’absence de bruits humains, notamment automobile, les incite à s’exprimer plus qu’avant. Les gamins aussi ; beaucoup jouent au ballon ou piochent le jardin sans tee-shirt, au soleil, pour se défouler entre deux chats avec leurs copains à distance.
Le président a causé, le lundi de Pâques à 20h02, après les « applaudissements » rituels à la mode envers les « soignants » (c’est quoi un « soignant » ? Outre les professions médicales : un rebouteux ? Un ami qui vous veut du bien ? Un curé ? La niaiserie des mots qui ne veulent rien dire et réduisent les personnes à un « fonctionnement » augmentent la confusion de la pensée). Cette fois il a été clair, sans jargon ; bien qu’un peu long par souci de ne rien oublier, ni personne, il a dit les incertitudes, les tâtonnements, les manques. Il n’a pas été jusqu’au bout bien qu’il ait fustigé la lenteur des bureaucraties – mais que n’incite-t-il pas l’Administration et le Parlement à les corriger ? Nous serons confinés « jusqu’au lundi 11 mai » – si tout va comme prévu. Pour la suite, tout le monde est content : il faudra être plus solidaire (extrême-gauche), plus souverain (extrême-droite), relocaliser (Les Républicains), augmenter les salaires de ceux qui sont « utiles à la société » selon les mots de 1789 (Parti socialiste), entreprendre de grands travaux pour le durable (écolos). Avec l’affranchissement de la limite des 3% du PIB pour la dette, tout devient possible. Qui paiera ? Les générations futures – ou une ponction brutale sur l’épargne par l’impôt un jour prochain. A moins que ce ne soit l’inflation, mais on la voit mal repartir.
Le lundi 11 mai du déconfinement arrive mais il ne fait pas beau, pluie et vent ; peu de gens sortent dans la rue. Ce ne sont que les jours suivants qu’ils mettent le nez un peu plus dehors, souvent portant masque (dans la rue, hors des grandes villes, à quoi cela sert-il ?). La coiffeuse en profite pour rajouter 10% à ses tarifs « pour achat de produits de nettoyage Covid ». Mais tout ne rouvre pas : cafés et restaurants restent fermés, comme les parcs et jardins. De plus, la France est classée en zones rouge et verte, l’Ile-de-France en rouge comme les Hauts de France et le grand Est plus la vallée du Rhône. En bref les zones les plus densément peuplées où la contamination est rapide. Là où le port du masque est obligatoire, on n’en trouve pas avant la fin de la semaine !
Les politicards adorent blablater en croyant que leurs paroles valent actes. La bureaucratie administrative, les strates, les services, les dispositions, les signatures, retardent tout. Ne sommes-nous pas « en guerre » comme a dit Macron ? Alors pourquoi ne pas court-circuiter tous ces paperassiers pour le service sanitaire de la nation ? Le combat contre ces strate administratives inutiles et contreproductives sera crucial après la pandémie. Car il y en aura d’autres, tout comme des crises économiques et des attentats. Depuis trois présidents (Sarkozy, Hollande, Macron), ce ne sont qu’improvisations sur le tas, en urgence, avec retard, sur tous ces sujets qui surgissent. En cause : l’organisation administrative trop lourde, hiérarchique, lente, procédurière, créée pour le temps paisible de l’avant-guerre.
Je ne suis pas resté à Paris, j’ai été effaré de la promiscuité des gens dans le RER, sur les quais, dans les supermarchés, sur les trottoirs. Ils occupent l’espace et, si vous ne les poussez pas carrément avec le sac et une excuse, ils ne se dérangent même pas. Tout est fait, en Île-de-France pour entasser les gens dans la promiscuité de masse : villes étroites, magasins petits (aux loyers trop élevés), transports bétaillère, RER centralisé maqué par la CGT sans cesse en grève, réseau engorgé par la migration quotidienne banlieue-Paris, travaux interminables qui durent depuis des années sans grand résultat…
Dans ma banlieue verte, le couple de jeunes voisins jouit du confinement pour commander à tout va sur le net ; ils reçoivent depuis deux mois près de deux colis par jour via la Poste, Amazon ou les livreurs. Les travailleurs sont dissuadés de reprendre massivement les transports, d’ailleurs réservés entre 6 et 9h30 et de 16 à 19h à ceux pouvant justifier d’une attestation employeur. Les autres sont « encouragés » à rester en chômage partiel, d’autant que les écoles ne rouvrent que progressivement et partiellement (dix par classe maxi), et que certains doivent donc garder leurs enfants.
J’en profite pour tester des recettes de livres comme la Ojja tunisienne aux tomates, poivrons et œuf ou le soufflé Jean Cocteau au jambon et gruyère, sauce champignons de Paris, vu sur Arte dans Les carnets de Julie. J’alterne poulet rôti, porc en cocotte aux poires, soupes de légumes ou de butternut (meilleur que le potiron), salades avocat tomates cerises à la coriandre et au balsamique, cake salé, aubergines de l’imam, salade de poivrons à la hongroise, riz malais aux légumes et fruits de mer, filets de poulet à la Kiev, magret de canard grillé pommes de terre dans sa graisse, tarte feuilletée pomme et pruneaux, farci charentais, poires au vin… Les chats de la maison font nid, heureux d’être avec nous comme le seraient des enfants avec leurs parents. Dès qu’un rayon de soleil apparaît, les jeunes garçons du bout de la rue, 13 ans, jouent au ballon dans l’artère déserte de voitures. C’est un bonheur de revoir des enfants dans les rues après deux mois, comme une promesse que l’avenir n’est pas obturé. Le week-end, c’est la mode du vélo en famille.
En juin, toutes les écoles sauf les lycées ont repris pour deux semaines « afin de garder l’habitude de se lever le matin », comme dit un instit syndicaliste, tout à fait dans le ton caporaliste de mobilisation permanente exigé du Français à l’école comme dans l’entreprise. A Carrefour, où je vais faire des courses fin juin, il y a depuis deux semaines des masques (pas toujours d’origine France) et du gel hydroalcoolique, mais déjà plus de gants jetables. La moitié des clients ne portent pas le masque, pourtant « obligatoire » selon la règlementation mais, en France aujourd’hui, ce que règlemente l’Etat est pris comme chacun veut. Le plus amusant est que les musulmanes tradi passent en robes longues noires et foulard sur les cheveux, mais sans aucun masque sur le visage, montrant à l’envi qu’on ne se voile que pour niquer la République et les Français, pas par pudeur religieuse. Quand c’est interdit, on revendique fièrement ; quand c’est prescrit, on refuse par défi.
Je parle avec un ingénieur qui travaille dans les mines au Congo qui achète 3 kg de daurades et un gros poisson, plus neuf tubes de dentifrice. Il vient faire ses courses toutes les deux semaines seulement à cause du Covid, sa belle-sœur en est morte, et il congèle ses poissons pour en sortir selon les besoins. Lui prend de la chloroquine, dont il a fait provision dès qu’il a pu. Vivant en milieu paludéen, il prend régulièrement de la nivaquine et il « croit » que c’est bénéfique contre le virus en phase pré infectieuse. Bien qu’ingénieur, il est tout aussi sujet à croyance que le quidam. Ce qui le pousse à « croire » plutôt qu’à constater ? « Le gouvernement nous ment » : c’était vrai sur les masques, faute de stocks et de prévoyance, mais pourquoi aucun pays voisin raisonnable n’encourage-t-il la chloroquine ? Tous ne mentent pas sur le sujet avec les mêmes raisons : l’Inde, la Chine, la Russie peuvent en produire et le prescrire si c’est si efficace ; pourquoi ne le font-ils pas, sinon que cela ne sert pas à grand-chose ? Par la suite, les études l’ont montré…
L’hédonisme des réunions adultes, restaus d’affaires et de copains et fiestas jeunes ainsi que les sacro-saintes « vacances » ont répandu durant l’été le virus à très grande vitesse, au rythme des TGV aux rangées étroites où il était permis cet été de se dévoiler pour « manger à sa place » ! A l’automne, le pharmacien a des vaccins contre la grippe saisonnière, toujours utile pour réactiver son système immunitaire, mais il ne vaccine pas tandis que la pharmacie de la commune voisine vaccine mais n’a plus de vaccin. Encore une organisation de la santé défaillante : les doses ont été sous-estimées ! Il y a pénurie en ce moment. Sauf les bobos branchés qui répondent aux sondages, « les Français » ne sont pas contre le vaccin : la preuve, ils ont asséché les stocks de la grippe en une semaine ! Et le 29 octobre à minuit, nous sommes reconfits – reconfinés pour la deuxième vague. Une amie de ma génération ne pourra pas aller à Noël au Canada voir ses enfants et petits-enfants ; et ils ne pourront pas venir en France à Pâques ni même peut-être l’été prochain. Car il y aura peut-être une troisième vague durant l’hiver – qui a commencé le 21 décembre.
Le virus semble avoir muté en plus virulent depuis l’été ; il s’est adapté aux Européens moins détenteurs des gènes de Néandertal qui, dit-on, favoriseraient les réactions cytoquinniques excessives. Le sud-est de l’Angleterre révèle sa dangerosité, incitant à couper les ponts dès avant le dernier délai des derniers délais avant le Brexit qui dure depuis des années.
Mais des bonnes nouvelles existent :
- L’Europe a fait son travail pour l’économie et la monnaie : grand plan de relance, suspension des critères de dette sur PIB, rachat programmé de dettes d’Etats, possibilité d’emprunts en commun destinés à ceux qui ont besoin aux taux allemands.
- Un vaccin « efficace à 90% » de l’allemand BioNTech allié à l’américain Pfizer est au point, une thérapie nouvelle à ARN qui doit être conservé à -70°. Un second vaccin est homologué, en plus des vaccins chinois et russe dont on sait peu de chose. Mais, outre le délai nécessaire à confirmer ce succès sur les millions de gens et pas seulement sur les milliers et les deux injections à trois semaines d’intervalle, il ne sera pas possible de vacciner facilement toute la population en un rien de temps. Il ne faut rien attendre de concret avant la fin du printemps, voire l’été, à mon avis. Il reste que c’est la biotechnologie allemande qui a créé le premier une réponse vaccinale au Covid-19 ; l’industriel américain Pfizer n’est là que pour produire et commercialiser, toute la recherche est bien chez BioNTech l’européen.
- Aux élections présidentielles américaines, Trump a été viré. Quelle que soit la politique suivie par son successeur, ce ne sera que meilleur pour l’humanité et pour la planète.
Une voisine et son mari, parents d’une lumineuse petite fille, ont quitté l’Île-de-France pour un village près de Nantes. « Nous avons changé de vie » me dit-elle.
Bonne année !




































































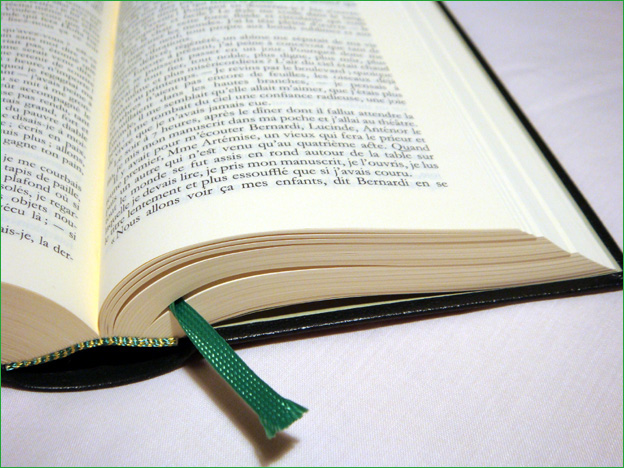

































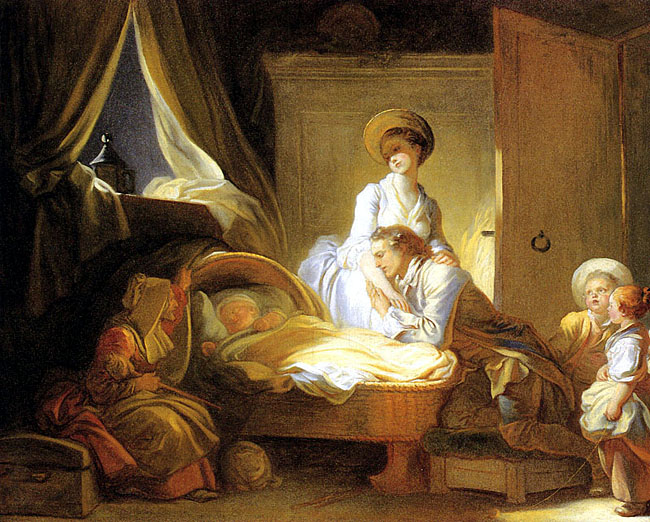






















Commentaires récents