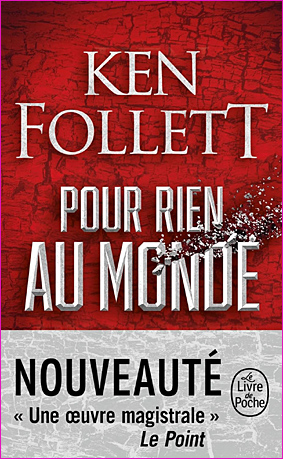
Personne n’a vraiment voulu la Première guerre mondiale, écrit l’auteur en préambule ; et pourtant, l’enchaînement des causes l’a fait advenir. Et si, en 2024, nous revivions la même chose ? Poutine sera vexé, mais Ken Follet ignore carrément la Russie, un pays marginal dans la géopolitique des forces réelles d’aujourd’hui. Le rival systémique est la Chine, qui manipule l’Occident et est manipulée par ses « alliés » de circonstance, le tyran psychopathe de la Corée du nord et l’éternel général au pouvoir au Tchad – sans parler de ces « djihadistes » qui sont surtout des trafiquants de droit commun.
L’auteur part de la lutte antidrogue et antidjihadiste (c’est la même chose) dans le désert du Sahara. Deux agents secrets, français et américain, pistent des terroristes tandis que la CIA surveille. Abdul, américain d’origine libanaise se fait passer pour un immigrant cherchant à gagner l’Europe via des passeurs – qui sont les djihadistes et passeurs de drogue. Tout en pistant la came, piégée par une puce au Brésil, il protège une jeune veuve des bords asséchés du lac Tchad dont le mari a été tué par les djihadistes, et son enfant de deux ans. En suivant la piste des ballots, il va découvrir un camp caché d’exploitation aurifère, un trafic d’êtres humains, une cache d’armes de gros calibre et « le » terroriste du Sahel le plus recherché. Bien documenté, l’auteur montre les liens multiples qui relient la manipulation géopolitique au trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains, sous le prétexte religieux du djihad.
Mais tout part en quenouille : le général tchadien vaniteux veut se venger d’un tir djihadiste sur le pont frontière du Tchad avec le Soudan et bombarde un chantier de construction chinois dans ce pays, en tuant une centaine de Chinois, dont les deux enfants jumeaux de 10 ans de l’architecte. Il a pour cela piqué un drone américain soi-disant « perdu ». Pékin s’émeut, riposte par le meurtre de deux Américains, géologues dans un bateau de prospection pétrolière vietnamien dans les eaux territoriales de ce dernier pays, mais revendiquées par la Chine. La présidente américaine républicaine tente d’apaiser les tensions par la diplomatie, mais l’exaspération des uns et des autres, la montée aux extrêmes des populistes dans chaque pays, les désirs belliqueux des communistes réactionnaires comme des républicains obscurantistes, vont faire déraper la situation.
L’apocalypse viendra de la Corée du nord, en faillite perpétuelle et au bord de la famine. Des généraux se révoltent contre le guide psychopathe et tiennent des bases de missiles nucléaires. La Chine ne veut pas intervenir, bien qu’elle ait fermement déclaré au tyran de la Corée du nord que toute utilisation d’armes chimiques ou biologiques terminerait à jamais toute aide de la Chine à son pouvoir. Le satrape taré s’en fout et en use, la Chine ne réagit pas comme elle l’avait dit. Les États-Unis se posent la question de la riposte – jusqu’à ce que la Corée du sud, alliée des États-Unis mais avide de réunification sous l’égide de sa présidente, décide d’attaquer le nord. Les rebelles balancent un missile à tête nucléaire sur Séoul… C’est le début d’une escalade – fatale. La Chine riposte, les États-Unis sont liés… le Machin (l’ONU) ne fait rien, l’Europe criaille mais se terre – vous imaginez la suite.
Dans chaque pays des gens raisonnables tentent de négocier, de régler par la diplomatie les rodomontades des machos. Ainsi en Chine un « petit pince » rouge, fils de compagnon de Mao, qui lutte contre les vieux vrais faux-cons. Ou aux États-Unis la présidente raisonnable contre les piques et les affirmations gratuites du matamore trumpiste qui brigue la présidence à sa place. Les préjugés et la propagande empêchent de raisonner juste.
L’auteur rend compte implacablement du jeu des escalades, des manœuvres complexes et de l’engrenage des alliances, mais il assaisonne de façon un peu trop facile ce thriller d’espionnage par des romances mièvres entre chacun des protagonistes : Abdul le libano-américain désire la veuve tchadienne Kiah, l’arabe français de la DGSE Tab désire la juive de Chicago de la CIA Tamara, le petit prince rouge Chang Kai sous-directeur de l’espionnage chinois désire sa star de feuilleton d’épouse, la présidente des États-Unis Pauline Green désire son conseiller à la Maison-Blanche noir Gus… On sent le procédé, la facilité convenue usée de la série télé, le politiquement correct avec son métissage obligé, « naturellement ». Ce qui gâche le plaisir de l’analyse.
Ce thriller se lit bien mais ses ficelles sont bien grosses. S’il a le mérite de montrer la complexité des liens entre pays et de démonter les idéologies et religions qui masquent les gros intérêts égoïstes des uns et des autres, la montée aux extrêmes est caricaturale. La présidente américaine se laisse entraîner « naturellement » vers la trique, « à cause » d’un connard populiste à la Trump qui menace sa réélection ; en Chine se rejoue le ballet des faucons et des colombes déjà usé à propos de l’URSS – et dont on a vu qu’il déguisait surtout l’absence d’analyse stratégique.
Les jeunes chinois sont plus nationalistes que les vieux, restés méfiants, donc prudents. Dézinguer d’un missile américain un porte-avion chinois en représailles à trente militaires japonais pulvérisés sur un îlot contesté est peu crédible : envoyer une frégate pour les déloger et les faire prisonniers serait plus réaliste ; balancer une torpille sur le gouvernail du mastodonte aussi – pas besoin de grimper aux rideaux nucléaires pour cela ! On sent que l’auteur était pressé de conclure.
Malgré l’intérêt d’actualité du thriller, ce sont les limites réalistes du sujet, trop vite et trop mal traité, sans même fouiller un peu les personnalités.
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Ken Follett, Pour rien au monde (Never), 2021, Livre de poche 2023, 924 pages, €11,90, e-book Kindle €11,99


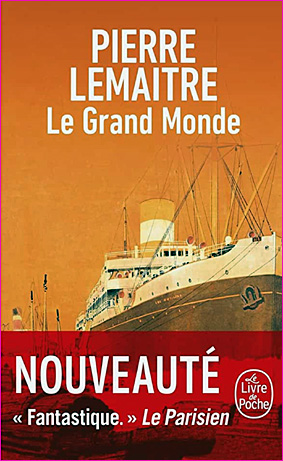
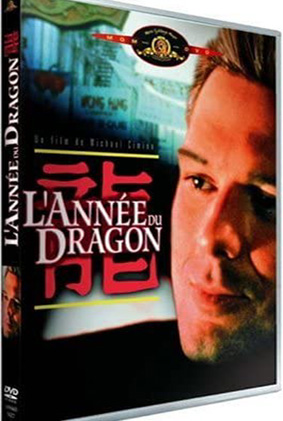






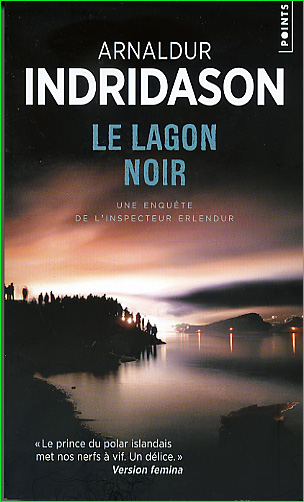




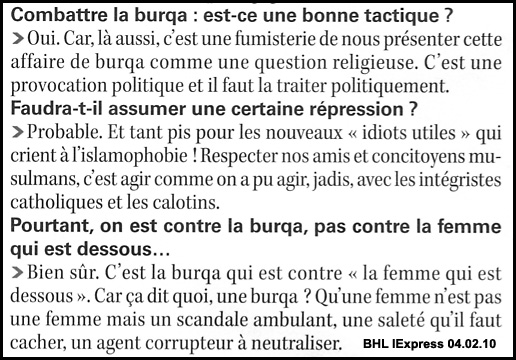


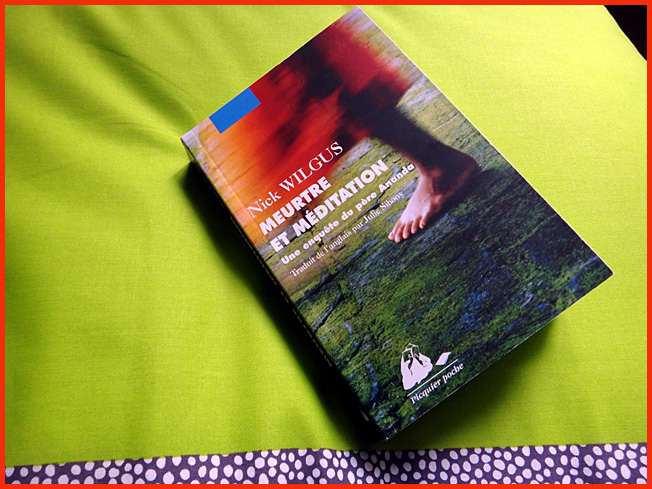






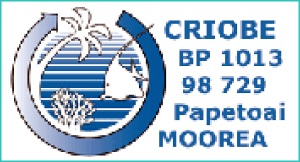
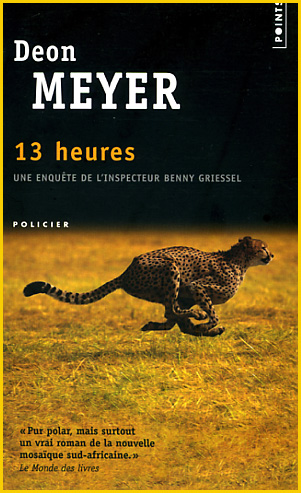

Commentaires récents