Nous avons changé d’époque, en voici encore un indice : les cartes de vœux.
Au début des années 2000, j’en envoyais à chaque fin d’année une vingtaine. Il n’y avait que très peu de téléphones mobiles et encore moins d’Internet.
Huit ans plus tard, c’était fini : les courriels et les textos avaient remplacé près de neuf envois sur dix. Il était même très snob d’envoyer des bons vœux dès le 1er janvier à zéro heure une minute de n’importe où – jusqu’à cet embouteillage qui a mis fin à la mode.
Aujourd’hui, huit autres années plus tard, c’en est quasiment fini des souhaits de bonne année : si vous n’en envoyez pas, vous n’en recevez aucun. J’ai fait le test.
Les Anglo-saxons, Américains, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais et Anglais, en envoient toujours : mais la niaiserie française est de n’adopter jamais le meilleur des modes anglo-saxonnes mais le pire (les cadenas d’amour « pour la vie » qui dure jusqu’au divorce imminent, la fête des citrouilles en guise de halle au vin – prononcer allo ouine – la fête des mères, des pères, des maîtresses, des anniversaires, des happy ci ou ça).
Nous pouvons constater, banalisation et habitude aidant, une moindre utilisation des nouveaux jouets technologiques avec les années. Ils deviennent des outils et moins des jouets, des usages courants et moins des exceptions de branché. Ils remplacent sans espoir de retour la succession de tâches fastidieuses qui consistait à trouver de bonnes cartes de vœux, à acheter le bon format d’enveloppe, à acquérir des timbres au bon tarif (les augmentations s’effectuant justement au 1er janvier), à mettre à jour le carnet pour avoir les bonnes adresses, à écrire un mot personnalisé voire un bon mot, à prendre le temps d’aller à la poste – et enfin de prier pour qu’il y ait ni grève, ni je-m’en-foutisme administratif et que « le contrat » de faire parvenir le courrier partout en France en 48 heures soit bien respecté.
Plus rien de tout cela : il suffit d’allumer l’ordinateur.
Je ne suis pas un nostalgique du passé mais je réfléchis au changement qui intervient.
Hier, la cérémonie des vœux était un moment de silence dans une soirée. Comme un recueillement. On pensait aux amis en choisissant la carte et en préparant les mots dans le silence de la plume et le soin de l’écriture à l’encre.
Aujourd’hui, tout est standardisé et raccourci : pas de longs discours en courriels, quelques phrases seulement, encore plus bref en tweet ou en texto – d’où le besoin du téléphone pour appuyer le message parfois auprès des proches. Mais tout cela avec des phrases moins longues et des idées plus courtes, une expression moins réfléchie et plus spontanée. Un immédiat peut-être plus sympathique mais plus superficiel. Hier, on gardait les cartes de vœux, elles donnaient des nouvelles ; aujourd’hui, on jette à la poubelle numérique les tweets, textos et courriels, ils ne disent que des banalités.
C’est ainsi que la vie va et il est vain d’en regretter le cours. Je n’ai envoyé qu’une seule carte cette année, à des plus vieux que moi qui, jamais, ne se mettront à Internet. Pour le reste, la préséance de l’âge traditionnelle m’a fait attendre des plus jeunes que moi un geste : il n’en a rien été. A l’exception des plus proches pour cause d’affection, d’amis chers soucieux de prendre des nouvelles, de rencontres fortuites dans la rue et de deux courriels intéressés à demander quelque chose, tout en souhaitant accessoirement une bonne année.
L’usage est donc de balancer l’envoi des vœux comme non pertinent de nos jours dans les relations sociales « mélangées » de nos cultures « métisses » d’un monde « globalisé ». Puisque cela ne se fait pas partout sur la planète, il serait dominateur de le faire, au risque de choquer les musulmans, les juifs, les hindous, les chinois, les bantous, les inuits et « nos amies les bêtes » – dont aucun n’envoie de vœux. Il est donc politiquement correct de s’abstenir. Une fois de plus. Quand le climat se réchauffe, les relations humaines se refroidissent.


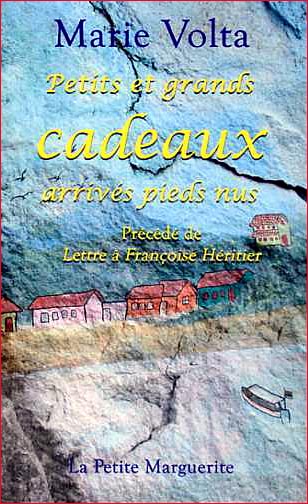

Commentaires récents