
Né un an après le siècle, Michel au prénom d’archange (ce qui ne laisse pas de l’impressionner enfant), tente de découvrir durant les années d’Occupation le code de son savoir-vivre. Tentation structuraliste du système unique ? Jeux de mot comme une règle d’associations d’idées surréaliste ? Inconscient lacanien comme un langage ? Leiris voit dans la littérature un usage de la parole comme moyen d’affûter la conscience non par narcissisme, ni pour gagner de l’argent, ni pour obtenir un statut social – mais pour être plus. Mieux encore : bien vivant.
Ce premier tome autobiographique n’a rien de mémoires de la quarantaine. Il est une recollection de souvenirs comme ils viennent, tirés par les mots qui deviennent images ou métaphores. Le titre Biffures est tiré de l’expérience militaire de l’auteur, durant son service un temps dans les chemins de fer. Les panneaux « bifur » résumaient « bifurcation », ce qui signifiait aiguillage et échangeur. La ligne se poursuivait, mais pas toujours sur la même voie. Michel Leiris écrit de même, comme un chemin de fer : il va, badaboum ! badaboum ! badaboum, rythmé par les rails sous lui, un brin obsessionnel de dire et toujours dire, dans l’ordre, sans précipiter le mouvement. Puis brusquement bifurque sur une affiliation d’idées, un jeu de mot, une image qui surgit, « boussole affolée, dont l’aiguille est successivement attirée par le nord changeant de toutes espèces de mots, qui me guident (ou m’égarent) dans ce voyage à l’intérieur de moi-même où les jalons sont des souvenirs d’enfance » p.96 édition Pléiade. Écriture étrange, parfois lassante, d’autres fois surprenante, de ramifications en ramifications.
Inspiré surtout par Marcel Proust, dont il a lu Le temps retrouvé durant la drôle de guerre passée au bord du désert saharien, et par Raymond Roussel, ami de son père, il dévide des souvenirs plus qu’une autobiographie, une introspection inquiète de savoir dans quel tissu il est taillé, comment le langage, les parents, les frères et la sœur, les amis, les études – et les livres ! – ont façonné sa personne, sa façon de penser, de voir le monde autour de lui. Il écrit d’après fiches, jouant avec le jeu du je. « Je prétends formuler des souvenirs pour augmenter la science que je puis avoir de moi » p.256, « grouper en un même tableau toutes sortes de données hétéroclites relatives à ma personne pour obtenir un livre qui soit finalement, par rapport à moi-même, un abrégé d’encyclopédie comparable à ce qu’étaient autrefois, quant à l’inventaire du monde ou nous vivons, certains almanachs… » p.269. Vaste programme qui plaît aux commentateurs dont les gloses peuvent se multiplier à l’infini.
Bien souvent la recherche prend le pas sur l’objet même de la recherche, la méthode sur le fond. D’où cette impression du lecteur de subir un ressassement, des tâtonnements avant une fulgurance par réminiscence. L’auteur évoque lui-même dans le chapitre Perséphone le « difficile commerce que je m’efforce de nouer avec le réel, paralysé que je suis par les mouvements les plus contradictoires et m’attardant en maints détours, justifiés seulement par la répugnance irraisonnée que j’éprouve à aller droit au fait… » p.75.
Son écriture est plus raisonnante que résonante, bien que l’effet des vibrations de certains mots ou de certaines scènes pousse les échos parfois loin : gramophone-métaux-voix… Mais il s’agit de langage, pas du lecteur. « C’est en me répétant certains mots, certaines locutions, les combinant, les faisant jouer ensemble, que je parviens à ressusciter les scènes ou tableaux auxquels ces écriteaux, charbonnés grossièrement plutôt que calligraphiés, se trouvent associés » p.110. L’auteur tend à s’enfermer dans les mots, considérés comme la vie même, la seule conscience humaine. Par là Leiris est bien de son époque, marqué par le Surréalisme, l’Existentialisme et le Structuralisme : les rêves sont la réalité, les mots sont les choses, les déterminants ne se manifestent que par le langage car tout est signe…
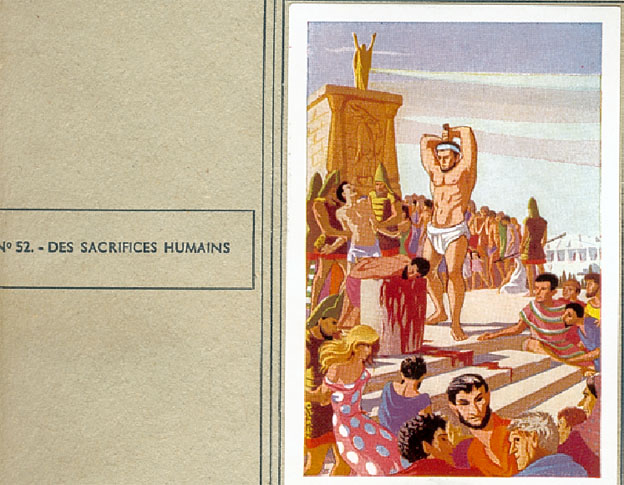 Cette démarche est intéressante, éminemment littéraire, un peu datée. Le lecteur d’aujourd’hui aura quelque mal à pénétrer ce vocabulaire parfois cérébral, ce dévidement souvent obsessionnel de la plume, entre les scènes fraîches qui restent à la mémoire. Mais il appréciera la forte impression que lui fit à Lannion en 1933 un couple de baladins sur échasses habillés de haillons bariolés, flanqués de leurs deux mômes de même, sorte de famille idéale pour Michel, petit dernier. Ou l’humour involontaire à propos de Dieu, sur la réminiscence qu’un curé lui disait à 12 ans qu’il ferait un bon prêtre: « Si Dieu représentait encore pour moi à cette époque quelque chose de vivant, digne d’être désigné par un nom que sa majuscule initiale classait parmi les noms de personne alors que je ne vois plus guère en lui maintenant que le pivot d’un certain nombre de jurons… » p.207.
Cette démarche est intéressante, éminemment littéraire, un peu datée. Le lecteur d’aujourd’hui aura quelque mal à pénétrer ce vocabulaire parfois cérébral, ce dévidement souvent obsessionnel de la plume, entre les scènes fraîches qui restent à la mémoire. Mais il appréciera la forte impression que lui fit à Lannion en 1933 un couple de baladins sur échasses habillés de haillons bariolés, flanqués de leurs deux mômes de même, sorte de famille idéale pour Michel, petit dernier. Ou l’humour involontaire à propos de Dieu, sur la réminiscence qu’un curé lui disait à 12 ans qu’il ferait un bon prêtre: « Si Dieu représentait encore pour moi à cette époque quelque chose de vivant, digne d’être désigné par un nom que sa majuscule initiale classait parmi les noms de personne alors que je ne vois plus guère en lui maintenant que le pivot d’un certain nombre de jurons… » p.207.
Le lecteur d’un certain âge reconnaîtra sans peine les attitudes des milieux d’hier qui l’ont fait tel qu’il est, les mots et les façons de dire, les lectures cruciales pour former sa personnalité lorsqu’il n’y avait ni télévision, ni Internet. J’y ai retrouvé pour ma part quelques traits, le désir de collectionner des articles sur ce qui m’impressionnait ou me faisait penser, le peu d’intérêt pour la compétition, le goût des autres et de l’ethnologie, le processus lent mais irréversible de décroyance, le chant des mots et des images (Londres/ombres), la sexualité diffuse de prime enfance au travers de la Bible illustrée et de l’évocation par les textes des scènes antiques, l’encyclopédisme du dictionnaire Larousse grand format – sans parler du 53bis Quai des Grands Augustins, fort proche d’un de mes lieux de vie, où Michel Leiris a habité au quatrième étage, façonné dès 1942 par le quartier…
Michel Leiris, Biffures – La règle du jeu 1, 1948, Gallimard L’Imaginaire 1991, 322 pages, €9.50
Michel Leiris, La règle du jeu, 1948-1976, Gallimard Pléiade, édition Denis Hollier 2003, 1755 pages, €80.50

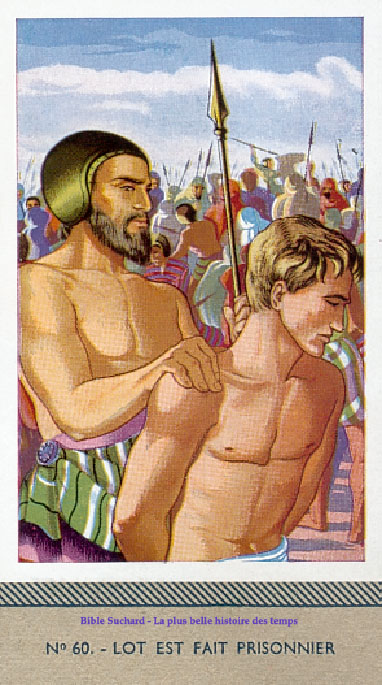

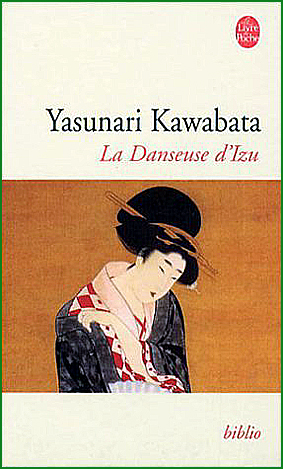
Commentaires récents