Le mode de vie contemporain a bouleversé les relations humaines traditionnelles : celles du couple, de la parenté, de la famille, de l’amitié, des affaires. Le film aborde tout cela.
Il commence comme un Truffaut des années 1960, montrant un jeune homme et une jeune femme au début de leur union. Mais le personnage principal, contrairement à Truffaut, est ici la femme : fraîche, ingénue, décidée. Plus de chichi bourgeois victorien, elle dit oui ou non directement, sans fioritures ni faux-semblants. Première leçon de la modernité : les relations entre les êtres sont désormais directes, immédiate ; elles veulent se fonder sur la vérité et la sincérité des désirs.
Le mari de la jeune femme est au chômage depuis un an ; il ne cherche pas de travail, il s’en fout, il survit – tant que ça dure… Sa moitié cumule les temps partiels ici ou là, dans la saisie informatique, la mise en page, la vente en boulangerie. Seconde leçon de la modernité : les relations stables sont terminées, on vit le temps du provisoire et chacun se débrouille dans des activités éclatées. Le couple, bâti pour un autre temps où l’avenir pouvait se tracer, ne résiste plus au zapping contemporain. Chacun doit changer de peau comme il change de métier, de chemise ou d’habitudes. Les relations évoluent comme l’existence. Pour les deux jeunes gens, c’est la séparation, puis le divorce.
Nelly (Emmanuelle Béart) en parle à une amie plus âgée (Claire Nadeau), dont le mari a divorcé d’un premier mariage pour l’épouser et lui donner deux enfants. Cela ne l’empêche pas de revoir son ex–femme et de jouer les étalons au point qu’elle attend un autre enfant de lui. Troisième leçon de la modernité : le zapping imposé par l’existence contemporaine est plus facile aux hommes. Il est en phase avec leur tempérament explorateur et volage. Seules les femmes doivent s’inscrire dans la durée pour cause de maternité et d’enfants à élever.
L’amie présente Nelly à Monsieur Arnaud, l’un de ses anciens amants, un vieux magistrat entré dans les affaires. Quatrième leçon de la modernité : la succession des générations à l’image de celle des saisons, c’est terminé. On s’aime désormais transversalement, sans durée, sans projet, vieux et jeunes mêlés, les ex entre eux ; rien n’empêche plus rien, les tabous sociaux traditionnels ont sauté.
Monsieur Arnaud est incarné sur la toile par Michel Serrault, très français, très chic, humaniste et ronchon. C’est un sage, toujours critique mais attentif, tout à fait dans la culture française. Il se met à préférer brusquement les êtres aux livres, après avoir fait l’inverse toute sa vie. Cela parce qu’il passe de l’autre côté du miroir et se met à écrire lui-même un livre. Il vend tout ce qu’il ne lit plus parce qu’il crée : il rédige ses mémoires. Il embauche Nelly pour lui taper son texte. Cinquième leçon de la modernité : l’aujourd’hui exige de ne vivre qu’au présent. Lorsque l’avenir n’est plus écrit nul part, nul ne lit plus les histoires du passé et n’existe plus que dans l’instant. Et l’on prend les êtres tels qu’ils viennent, ici et maintenant, voire sur le tapis, dans le tout, tout de suite caractéristique de l’époque post-68.
Plus de livres donc plus de destin mais la vie telle qu’elle se présente, au hasard. Les mémoires ne sont plus des leçons pour l’histoire mais un recueil vivant d’anecdotes, d’instants humains dont on aime à se souvenir. Il y a peut-être ici une sixième leçon de la modernité concernant la littérature.
Monsieur Arnaud sera amoureux de Nelly mais la respectera. Elle n’aura de liaison qu’avec l’éditeur du magistrat, jeune et fringant célibataire qui veut « s’établir » comme dans la tradition (Jean-Hugues Anglade). Mais elle rompt, elle « est bien comme ça » dans l’éphémère, l’adolescence prolongée qui correspond si bien à l’époque au prétexte de « liberté ». Monsieur Arnaud a été mauvais époux et mauvais père, magistrat colonialiste puis homme d’affaires impitoyable. En écrivant ses mémoires, il revient sur lui-même, se juge, assume son existence à l’aide de sa vaste culture. Il apparaît comme un phare, une référence morale dans la tempête moderniste pour une Nelly à la dérive. Septième leçon de la modernité : la culture est ce qui reste quand tout a été emporté. La culture humaniste française permet de vivre, de s’accorder au monde tel qu’il va, de trouver le bonheur même dans les bouleversements chaotiques contemporains.
Monsieur Arnaud va aider Nelly à mûrir, il reprendra sa femme après un divorce de 20 ans parce qu’elle se retrouve brutalement seule à la mort de son second mari. Il soutiendra son adversaire en affaires, ruiné par lui. Il fera un voyage pour revoir son fils, informaticien à Seattle, que tout sépare en termes de conception de la vie. Huitième leçon de la modernité : la sagesse est avant tout de se préoccuper des êtres, non des choses. Mais l’on ne devient sage qu’une fois bien avancé dans l’existence.
Avis aux jeunes couples tentés de s’éclater avant d’éclater leur union : l’égoïsme sacré est une impasse. C’est un signe d’adolescence prolongée, une crispation névrotique sur la jeunesse. Dans le couple, la paternité, l’amitié, les affaires, le chacun pour soi, tout cela apparaît comme un leurre. Sauf à avoir la force de rester solitaire, il faut accepter le compromis, l’éternel compromis avec les êtres, où chacun met du sien, pour que perdure un semblant d’ordre humain.
Mais Claude Sautet est optimiste : même prolongée, attardée, l’adolescence finit par passer, et l’on découvre les valeurs de l’âge mûr, celles que l’humanisme classique a rendu éternelles.
DVD Nelly et Monsieur Arnaud, Claude Sautet, 1995, avec Michel Serrault, Emmanuelle Béart, Jean-Hugues Anglade, Claire Nadeau, Michael Lonsdale, Françoise Brion, Michèle Laroque, Charles Berling, StudioCanal 2001, 1h42, €12.49





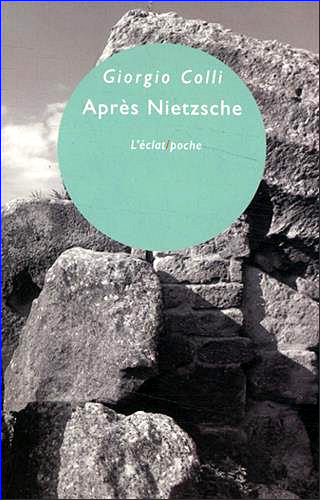






Commentaires récents