Un western bancal avec Clint Eastwood dans le rôle-titre. Il incarne Joe Kidd, l’éleveur de chevaux pionnier, individualiste, qui considère les lois mais avec une marge. Il a été mis en prison par le shérif (Gregory Walcott) pour avoir tué un daim dans une réserve où c’était interdit. « Mais le daim ne savait pas où il allait et je ne savais pas où je me trouvais », dira-t-il au juge à cheval sur la loi.
Il le condamne à payer 10 $ d’amende ou à effectuer 10 jours de travaux d’intérêt général dans la petite ville. C’est à ce moment que surgit une bande de Mexicains armés qui réclament leurs droits. Ils ont été spoliés de leurs terres ancestrales occupées depuis des générations (mais piquées elles-mêmes aux Indiens) parce que les titres de propriété ont brûlé. « Il y a eu un grand incendie à Santa Fe et les archives sont parties en fumée ». Le gouverneur attribue donc les terres aux colons blancs. Luis Chama (John Saxon), à la tête du mouvement de résistance, somme le juge de rétablir le droit et, comme celui-ci ergote sur les papiers, pénètre dans le tribunal pour brûler les actes de propriétés des Blancs. Ainsi chacun se retrouve à égalité et ce sera le droit du plus fort ou du plus nombreux.
Joe Kidd reste en spectateur dans cette querelle qui ne le concerne pas. Il est Blanc mais parmi les Mexicains, aussi petit qu’eux, et n’occupe la terre que pour y élever des chevaux. Sauf que le racisme, qui n’est jamais à sens unique, incite l’un des sbires de Chama à lui faire une mauvaise affaire lorsque Joe fait sortir le juge par une porte arrière pour lui éviter d’être enlevé. Kidd tue le sbire au moment d’être tué.
Un gros propriétaire et spéculateur nommé Frank Harlan (Robert Duvall) débarque dans la ville avec un groupe de « chasseurs » munis de fusils techniquement perfectionnés. Nous sommes au début du XXe siècle, comme en témoigne la date de fondation de la ville de Sinola, affichée sur la gare (1896), et l’Amérique connait un essor industriel sans précédent, conduisant à l’orgueil qui subsiste jusqu’à nos jours. Tout doit plier devant la volonté du plus apte, et la loi du plus fort s’appliquer à tous et partout. C’est ainsi que le gros achète le petit pour 1000 $ plus prime afin de traquer et abattre Luis Chama. Joe Kidd refuse, en bon individualiste qui n’aime pas les puissances mauvaises de l’argent et du pouvoir – thème classique.
Mais lorsqu’il retourne à sa ferme, il trouve ses chevaux volés et son contremaître torturé, ligoté avec du fil barbelé à la clôture : les Mexicains de Chama ont fait le coup, en particulier un certain Ramón que Joe n’oubliera pas. Kidd décide alors d’accepter la proposition Harlan et se retrouve à la tête de la petite troupe de chasseurs sur la piste qui mène vers les montagnes où se sont enfuis les rebelles.
En route, ils trouvent dans une ferme Helen, une Mexicaine qui était avec Chama au tribunal (Stella Garcia). Elle dit ne pas savoir où se trouve le Mexicain mais est enrôlée par ce macho de Harlan pour faire la soupe et servir le café (on s’étonne qu’elle n’ait pas été violée mais certaines allusions permettent d’en douter). Dans un village de la montagne, le spéculateur excédé de ne rien trouver prend en otage les habitants et menace officiellement Chama, dont la bande tire depuis les rochers, d’exécuter cinq personnes le lendemain à midi s’il ne s’est pas rendu, et encore cinq autres s’il persiste. Ce sont des femmes, des enfants et des vieillards, mais la force rend fou et hitlérise les comportements. Devant cette brutalité d’hubris (le film date de 1972 et le Premier ministre suédois compare à cette époque la guerre du Vietnam aux massacres nazis), Joe Kidd reprend son indépendance et joue en solo.
Enfin de l’action ! La séquence où il retrouve une arme grâce au padre du village, descend sans un coup de feu du haut du clocher le sbire le plus con au revolver à crosse longue portée (Don Stroud), puis la sentinelle derrière l’église d’un coup de jarre remplie d’eau, s’évade avec Helen en piquant un fusil à lunette, est un grand moment. Les deux chassent les chevaux de Harlan et consorts puis vont retrouver Chama dans la montagne. La cause des rebelles est perdue si le Mexicain ne va pas plaider sa cause devant un tribunal, comme l’a dit le juge. Ils devront tuer, sinon, tous ceux qui viendront les pourchasser et ils savent que c’est un combat désespéré. Est-ce pour cela qu’il ne faut pas le mener ? Non, mais si une solution existe, il faut la saisir selon la bonne maxime chrétienne : aide toi, le Ciel t’aidera.
C’est ainsi que Kidd clame à Harlan qu’il retrouvera Chama à la ville. En chemin, un « chasseur » les vise à lunette mais Joe Kidd use de l’arme équivalente qu’il a dérobée et, malgré un montage maladroit et fort lent du fusil, descend le tireur. Signe que les occupants et les résistants se trouvent bien à égalité. Tout se jouera donc à Sinola, à l’arrivée.
Et c’est un autre moment d’action qui voit la troupe de Harlan se positionner aux endroits stratégiques pour descendre le Mexicain avant qu’il parvienne à faire entendre ses droits, puis la bande de Chama être licenciée par son chef qui veut livrer ce combat seul, enfin Joe Kidd utiliser le petit train à vapeur pour éviter les rues sous le feu des balles et entrer au saloon où se tiennent les chasseurs. Tout se terminera comme il se doit, non en droit mais en résistance, le combat moral individuel comptant plus que la loi collective car étant, selon la mentalité pionnier, d’une essence supérieure – biblique. Les musulmans qui mettent le Coran au-dessus des lois humaines ne disent pas autre chose que les chrétiens américains persuadés d’être les Élus pour fonder la Cité de Dieu sur la terre promise du nouveau monde.
C’est un peu primaire, curieusement moral, et respectueux des Mexicains – mais pas un grand western tant l’intrigue est mince, l’action dispersée et les personnages convenus. Y aura-t-il un amour véritable entre Joe et Helen ? Le droit sera-t-il rétabli par le juge ? Nul ne saura jamais. Mais on ne s’ennuie pas et l’on s’amuse parfois.
DVD Joe Kidd, John Sturges, 1972, avec Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Stroud, Stella Garcia, James Wainwright, Paul Koslo, Gregory Walcott, Universal Pictures France 2003, 1h28, standard €7.98 blu-ray €8.16

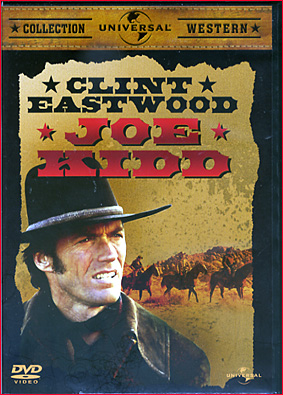



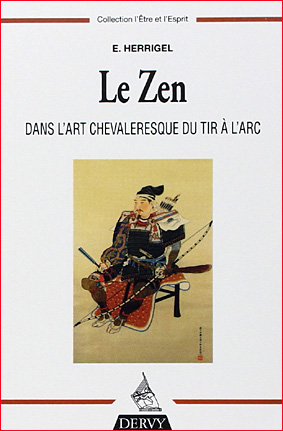

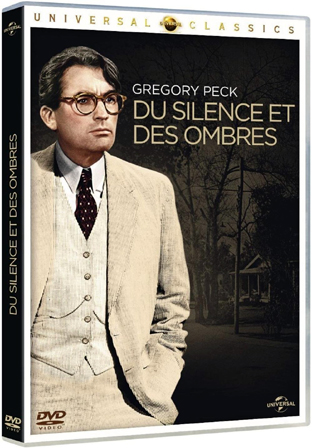






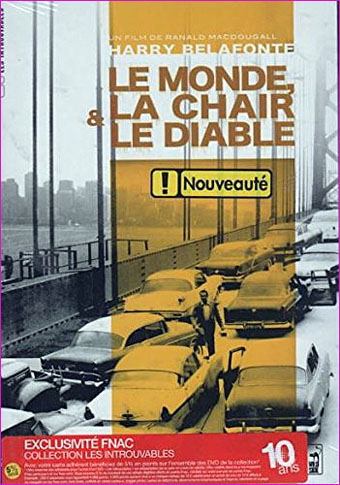


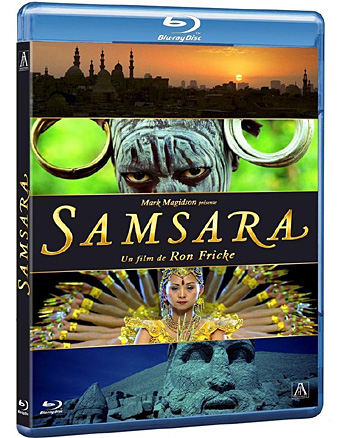








Commentaires récents