Un film aux trois oscars et aux trois Golden globes, tiré d’un roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, qui eut le prix Pulitzer, enfin étant parmi les 50 films « à voir avant l’âge de 14 ans » du British Film Institute… Les raisons d’un tel succès sont à chercher dans l’année de sa sortie : 1962. Outre la crise des missiles soviétiques de Cuba et un krach boursier, l’année est marquée par l’entrée en force du premier étudiant noir James Meredith, imposée par le président John Kennedy lui-même à l’université d’Ole Miss au Mississippi, état raciste du sud. La lutte contre les inégalités sociales et raciales était au programme de la Nouvelle frontière du jeune président tout juste élu. Des marches pour les droits civiques et des Freedom rides furent organisés dès 1961 pour protester contre les discriminations des Noirs par les Blancs. Les USA se libèrent l’année même où l’URSS construit son Mur : l’espoir change radicalement de camp.
L’histoire du film se passe dans les années 30, durant la Grande dépression, dans la petite ville de Maycomb dans un état du sud. Elle est contée en voix off par une petite fille de 6 ans (Mary Badham) devenue adulte et qui se souvient de cet été-là. Son père, avocat respecté dans la ville pour son humanité et son bon sens (Gregory Peck), est chargé par le juge du tribunal d’assurer la défense d’un « nègre » (Brock Peters) accusé de viol sur une blanche (Collin Wilcox Paxton), parce que tous les autres se récusent. Il va donc faire son devoir, plaçant le droit et l’égalité affirmée de la Constitution fédérale avant les préjugés raciaux et les affinités communautaires. Ce n’est pas facile à vivre, tant la communauté vous enserre dans de multiples liens personnels et sociaux. L’avocat Finch, que ses enfants appellent de son prénom, Atticus, plutôt que papa, donne l’exemple de la droiture morale et du devoir civique. Il les élève seul, sa femme étant morte après avoir accouché de Scout.
Le fait que l’histoire soit vue par les yeux d’une enfant assure de ne pas tomber dans les bons sentiments qui pavent trop souvent l’enfer des bonnes intentions. Atticus est plus un personnage dans la cité qu’un parent charnel, bien qu’il prenne dans ses bras sa petite fille qui entre à l’école et parle avec son fils. Les deux enfants ne font pas leur âge affiché, ce qui gêne un peu : Jean Louise « Scout » Finch fait plus que 6 ans (de fait, elle avait 10 ans) et son frère Jeremy « Jem » Finch moins que 12 ans (il avait pourtant 14 ans) ; seul leur copain de vacances Charles Baker « Dill » Harris (John Megna) qui déclare 7 ans est à peu près dans les normes (il a 10 ans au tournage).
L’enfant, dans la mythologie américaine, est censé être innocent comme s’il était un ange issu du paradis. Mais, par le péché originel, il doit perdre cette innocence en grandissant afin de devenir citoyen patriote entrepreneur. Le moyen de découvrir le mal est la transparence : il faut tout dire, tout déballer, agir spontanément. Le regard « vierge » est celui de la vérité, donc du bien. Atticus élève ses enfants avec franchise et honnêteté, expliquant les choses telles qu’elles sont en fonction de leur âge, sans masquer la réalité au prétexte de les en « protéger ». Jean Louise est surnommée Scout parce qu’elle fait très garçon manqué, comme on disait avant le féminisme. Toujours en salopette, comme son frère qu’elle suit partout, elle peut se traîner dans la poussière et ramper dans les jardins sans abîmer ses vêtements. Le jour de la rentrée à l’école où elle va pour la première fois, elle doit se mettre en robe pour se conformer aux normes sociales et elle en a honte. Elle doit aussi ne plus se battre comme un garçon et « discipliner sa violence » comme lui serine son grand frère. Sur l’exemple de son père – qui s’est vu confier un fusil à 14 ans (mais pas avant) et a été autorisé à tirer sur les geais et les pies qui pillent les jardins, mais pas sur l’oiseau moqueur (traduit en français par rossignol) lequel se contente de chanter.
C’est qu’Atticus, sous ses airs bonhommes à tendre l’autre joue (notamment quand un bouseux lui crache au visage comme le Christ), est du côté de la force. Il surmonte sa propension instinctive à riposter par un bon poing sur la gueule (ce que j’aurais fait aussi sec, je l’avoue), mais tire parfaitement au fusil sur un chien enragé, mieux que le shériff avec qui il a été à l’école. Scout sait déjà lire car il lui a appris avant l’école, et le plus grand plaisir de la fillette est de faire la lecture à son père chaque soir : l’inverse de « tu me lis une histoire » marque combien elle est en avance sur ses condisciples, mais aussi sur la société des années 30, rendue volontairement autonome par son éducation. Elle représente la future femme qui votera Kennedy trente ans plus tard – tout comme le scout est l’éclaireur d’une armée.
Le film est construit sur ce passage de l’ombre à la lumière, la première scène opposant l’ombre rassurante de l’arbre de la maison (symbole protecteur de la famille) à la lumière crue des rues de la ville (où se déroule la vie sociale sous l’œil des commères). Mais l’apparence masque la réalité : le social transparent cache des peurs communautaires, le soleil de la raison n’éclaire pas les préjugés, et la blancheur de la peau peut renfermer de noirs desseins. Scout et Jem (diminutif de Jeremy) sont fascinés par la maison voisine, dont la rumeur amplifie les bruits et les secrets. Nathan Radley (Richard Hale) y cache et peut-être enchaîne son fils un peu demeuré Boo (Robert Duvall), qu’on ne voit jamais au grand jour comme s’il était le mal incarné, véritable croque-mitaine capable de poignarder avec des ciseaux son propre père comme on le répète.
Les enfants jouent à se faire peur, à explorer comme de bon pionniers américains la frontière – mais celle entre le réel et l’imaginaire. Car la menace, si elle est invisible, est bien réelle, bien que pas où l’on croit. Le simple d’esprit se révélera vertueux, les « honnêtes » gens pas toujours francs, la violée une harceleuse, son père en colère (James Anderson) un véritable sale type, et ainsi de suite. Si les peurs instinctives sont le fait de l’enfance, nombre d’adultes n’ont jamais dépassé ce stade d’ignorance et d’inculture. Le racisme et les préjugés en sont la conséquence : on a peur de ce qu’on ne connait pas et de ceux à qui l’on prête des mœurs animales pour se distinguer socialement – bien que l’on vive en fermier aussi pauvrement. Seule l’école, la lecture de livres, le respect du droit (et l’étude de la Bible) peuvent, selon le message du film, faire passer de l’ombre à la lumière, de l’état d’enfance à l’état adulte.
Toute l’histoire est donc le combat de l’innocence contre la cruauté, ce qui est particulièrement touchant lorsque des enfants sont impliqués. Car ces robustes et délurés gamins n’ont ni la langue dans leur poche ni la couardise attendue de leur âge tendre. Ils osent de nuit aller espionner la maison hantée par le demeuré, malgré le fusil du père ; ils rejoignent leur avocat de père qui campe devant la prison où « le nègre » Tom Robinson attend son procès et où les « honnêtes » gens, fermiers ignares sachant à peine lire et écrire, se rassemblent pour le lyncher ; la petite fille rappelle à l’un des fermiers sa dette vis-à-vis de son père qui lui a fait gagner un procès en usant du droit comme il se doit ; ils se font insulter à l’école, agresser ou effrayer par des adultes ; ils n’hésitent pas à traverser une forêt où des bruits inquiétants les suivent… jusqu’à la scène finale que je vous laisse découvrir – évidemment une apothéose dans le droit fil du message.
Les enfants sont plus vrais que les adultes dans cette histoire, ce pourquoi le film réussit à passer les années. Le bon sens humain, attisé par l’exemple du père défenseur du droit, est supérieur en conviction au simple exposé rationnel des faits et de la loi.
La plaidoirie de l’avocat au tribunal, pour convaincre les jurés de l’innocence du prévenu, m’a parue trop intello pour ce public de bouseux quasi illettrés. Comment des arguties de procédure ou des subtilités de témoignages pourraient-elle aller contre la force des préjugés ? Il aurait fallu mettre les points sur les i et montrer par exemple que le poing gauche du père poivrot a bien plus probablement poché l’œil gauche de la fille que le poing droit du nègre serviable, inapte de la main gauche depuis l’âge de 13 ans, plutôt que de le suggérer. Et insister plus lourdement sur la pulsion sexuelle de la fausse violée (aucune preuve médicale n’a été demandée, on « croit » une blanche sur parole) qui l’a fait embrasser un nègre après l’avoir attiré jour après jour sous des prétextes futiles. Cette plaidoirie s’adresse au public éclairé et intellectuel de 1962 plutôt qu’à la réalité agricole de 1932, c’est à mon avis la faiblesse du film (et peut-être du livre).
DVD Du silence et des ombres (To Kill a Mockingbird), Robert Mulligan, 1962, avec Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford, John Megna, Brock Peters, James Anderson, Collin Wilcox Paxton, Robert Duvall, Estelle Evans, Rosemary Murphy, Richard Hale, Frank Overton, Universal Pictures 2016, 2h04, standard €6.99 blu-ray €13.46

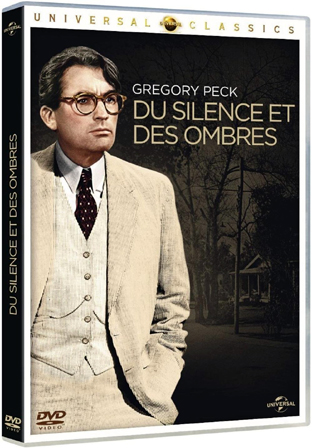






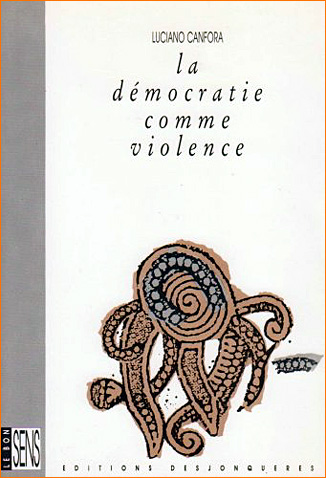

Commentaires récents