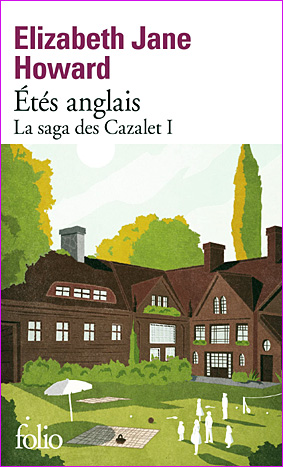
Voici un gros roman anglais comme les aime, bizarrement non traduit depuis 30 ans. Les petits-bourgeois sous François Mitterrand couraient plus après le fric qu’après la culture. Édité en 1990 en Angleterre, il a fallu attendre 2020 qu’il paraisse en français. Il évoque une époque disparue de la splendeur de l’empire, l’entre-deux-guerres où les familles fortunées, pas forcément aristocratiques, allait passer l’été dans leur grande maison de famille à la campagne. Les parents recevaient leurs enfants adultes et leurs épouses, leurs petits-enfants, les pièces rapportées comme les amis, ainsi que les nounous et femmes de chambre.
C’est toute une vie sociale qui se déploie, chacun étant saisi dans son jus avec un luxe de détails, du patriarche nommé le Brig pour brigadier et sa femme la Duche pour duchesse, jusqu’aux derniers-nés, bébé vagissant ou candide de 6 ans. Les garçons se développent, plein d’énergie, s’entraînant sur le court « en seuls tennis et short », et la raison vient aux filles tandis que la guerre, la seconde mondiale, se profile.
Mari adultère, père incestueux, sœur lesbienne, épouse jeune trop séductrice, grande fille qui explore son pouvoir sur les hommes, fils adolescent malheureux d’être incompris, fille rêvant d’être bonne sœur, garçon de 13 ans terrorisé par sa prochaine pension… les petits événements du quotidien cachent de véritables tragédies parfois. Il n’est pas facile d’aimer les hommes quand on est une fille élevée dans les principes victoriens, tout comme il n’est pas facile aux garçons d’aimer les filles lorsqu’on est élevé de 7 à 20 ans dans l’atmosphère exclusivement masculine des collèges. Tous les enfants ont, comme tous les adultes, leurs problèmes. Leurs parents les ont connus mais rien ne change, car la société est ainsi faite et elle doit se reproduire. Dans l’esprit victorien, ce qui est contrainte est bon, ce qui frustre et restreint dresse une éducation. Une bonne idée a été de mettre l’arbre généalogique de la famille Cazalet dans les premières pages et d’ajouter les domestiques pour chacun des enfants. Il y a en effet plus de 40 personnages entre les trois fils leurs épouses et leurs enfants, leurs domestiques et la famille de la sœur de la Duche qui vient aussi passer l’été avec quatre enfants.
L’autrice donne sur chacun des détails minutieux, presque maniaques, les vêtements qu’ils portent, les bijoux, la pratique du bain, le mobilier des pièces, l’architecture de la bâtisse, les recettes de cuisine. À propos, connaissez-vous les huîtres à l’anglaise ? Appelée angel horse back, chaque huître est pochée dans son eau puis enveloppée dans une fine tranche de bacon avant d’être grillée comme un vulgaire pruneau apéritif. En revanche, je n’ai pas trouvé la recette du pâté « traksir » ; il semble que ce soit un pâté en croûte comme les Anglais les aiment, peut-être une recette inspirée de l’orient indien pour les épices, mais je n’en sais pas plus.
La maison de famille est une ancienne ferme à colombages à laquelle deux ailes ont été ajoutées au siècle précédent, puis des cottages aménagés par l’actuel propriétaire. Le tout se situe au sud-est de Londres, dans le Sussex, près d’Hastings où l’on va à la plage, en face de Boulogne-sur-Mer. Le souci du patriarche est de protéger tout le monde, ses quatre enfants et ses huit petits-enfants, en plus des bébés orphelins de la première guerre dont s’occupe sa fille célibataire Rachel. Cette préoccupation, à la fois touchante et romaine, est proche des inquiétudes que nous pouvons ressentir durant notre pandémie, ce qui fait des personnages presque des membres de notre famille.
Très bien écrit et addictif, ce gros roman se lit à grandes goulées ; c’est nécessaire si vous ne voulez pas perdre le fil et vous souvenir de qui est qui (livre que doivent éviter les zapettes contemporaines de tous sexes incapables d’attention plus de 40 secondes d’affilée). L’attachement aux personnages nait du ton neutre employé par la narratrice, qui traite les pires moments comme les meilleurs, avec ce détachement qui fait son charme. L’autrice pratique un humour anglais fort réjouissant, appliqué aux enfants comme aux adultes, et même aux chats : « c’était une chatte écaille et blanc, au pelage rustique, qui, comme l’avait un jour fait observer Rachel, ressemblait à la plupart des Anglais bien nourris, en cela qu’elle ne chassait que pour le sport et se montrait très déloyale dans ces méthodes » p.196.
La traduction par Anouk Neuhoff, en général de qualité, fait curieusement l’impasse sur certains mots qui existent en français tels que la Sarre, livré dans son jus comme « Saar », et le préfet de collège, présent pourtant chez nos jésuites et oratoriens, écrit à l’anglaise « prefect » on ne sait pourquoi.
Ce premier tome commence à l’été 1937 et se termine à l’été 1939, à la veille de la guerre. Chamberlain vient de rentrer de Munich et tout le monde espère que la paix est enfin assurée malgré Monsieur Hitler. Deux tomes supplémentaires sont déjà écrits – et semble-t-il traduits, mais pas encore en poche.
Elisabeth Jane Howard, Etés anglais – La saga des Cazalet 1 (The Light Years), 1990, Folio2021, 597 pages, €9.40 e-book Kindle €8.99

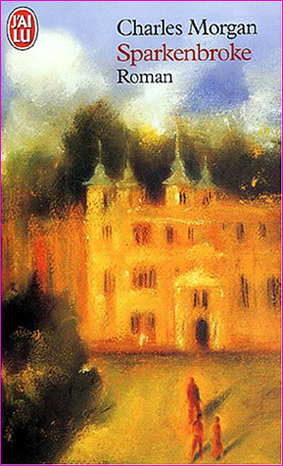

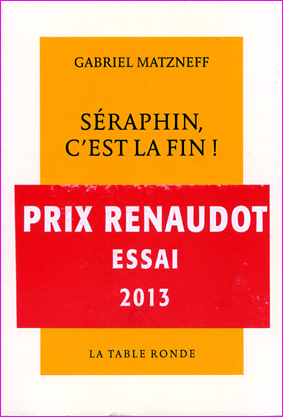







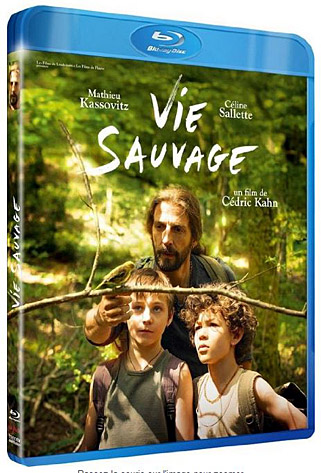



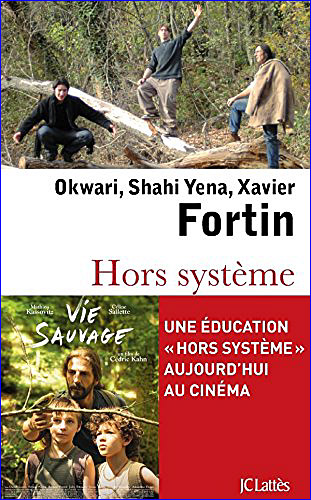
Commentaires récents