Eugen Herrigel était Allemand et philosophe, né en 1884, mais il a vécu au Japon de 1924 à 1929 où il a étudié l’art du tir à l’arc avec le maître zen Awa Kenzō. Il raconte son chemin.
Le zen est l’esprit de tous les jours : dormir quand on a sommeil, manger quand on a faim, boire quand on a soif. Dès que nous réfléchissons, délibérons, conceptualisation, la spontanéité se perd. La conscience submerge l’inconscience originelle qui agit naturellement. Quand la pensée s’interpose, nous ne mangeons plus quand nous mangeons mais nous appliquons des concepts de goût aux aliments et un imaginaire culturel autour. Pour le zen, il nous faut redevenir comme des enfants par de longues années d’entraînement à l’oubli de soi. Il ne s’agit pas de se nier, mais de retrouver le naturel en nous. Lorsque cela est réalisé, l’être humain pense et pourtant il ne pense pas : il cogite comme les vagues déferlent sur l’océan, il est l’océan, il se met à la place des choses et reste en même temps extérieur. Il existe plutôt que d’être pensé par des représentations en lui.
L’action n’est que le reflet d’une attitude mentale. Le zen est l’expérience du fond insondable de l’être que l’entendement ne peut concevoir. Chacun doit surmonter sans cesse ses expériences, retraverser ses triomphes et ses échecs aussi longtemps qu’ils sont « les siens ». Le tout qui est décrit comme « le soi » doit s’annihiler, car le moi ou le soi (le petit moi et la conscience préexistante) ne sont que des agrégats. Il s’agit de retrouver une vie qui n’est plus sa propre vie particulière mais le battement de toutes les choses avec lesquelles nous sommes en rythme.
Le tir à l’arc est une voie de progression zen comme une autre. Il existe la voie des fleurs et la voie du sabre, comme celle des haïkus et des arts martiaux à mains nues. Le détachement de soi commence par celui de son corps, et la méthode, dit Herrigel, est la respiration. Pour se décontracter, il faut expirer longuement, se concentrer sur le mouvement de l’air dans ses poumons avec l’impression d’être respiré. C’est alors que l’esprit devient comme de l’eau : elle cède sans jamais s’éloigner, elle s’adapte au terrain, investit tout car elle se plie à tout. Penser est un obstacle, il faut devenir comme l’enfant qui serre le doigt puis le lâche sans secousse car il est sans raisonnement ; il joue avec les choses.
« L’art véritable est sans but, sans intention. Plus obstinément vous persévérez à vouloir apprendre à lâcher la flèche en vue d’atteindre sûrement un objectif, moins vous y réussirez, plus le but s’éloignera de vous. Ce qui pour vous est un obstacle, c’est votre volonté trop tendue vers une fin ». Chaque tireur vit cette expérience, que ce soit avec un arc ou avec un fusil : lorsque vous pensez à la cible, votre corps n’est plus en accord avec votre esprit, il se fatigue, il tremble, il tire à côté. J’avais un capitaine, lors de mon service militaire, qui nous disait que les intellectuels étaient les moins bons tireurs que les plus cons. Pour nous rendre con, il nous faisait courir quelques centaines de mètres avec un sac de 10 kg sur le dos et nous faisait tirer à plat ventre dans la foulée sur une cible à 200 m. Nos résultats étaient nettement meilleurs que lorsque nous étions sans fatigue. L’exercice physique avait dompté notre pensée et l’avait mise à l’écart, ce qui était bon pour les réflexes coordonnés de l’œil et de la main.
« Libérez-vous de vous-même, laissez derrière vous tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, de sorte que de vous il ne reste plus rien, que l’attention sans aucun but. » Il faut détendre son esprit en vue d’être non seulement un esprit mobile, mais tout entier libre, disponible à l’incertitude originelle qui est une disposition à céder sans résistance pour mieux agir et à réagir sans réfléchir pour la meilleure efficacité opportune.
« Mais pour que réussisse d’instinct ce comportement passif, il faut à l’âme une armature interne ; elle s’acquiert en se concentrant sur l’acte de respirer. Cette concentration s’opère en pleine conscience, en y apportant une sorte de pédantisme : inspiration et expiration exécutées séparément et avec soin. »
Il s’agit de laisser pénétrer dans l’esprit ce qui apparaît ; c’est alors que l’on regarde les événements avec équanimité. Cet état détendu est proche de l’état de pré-sommeil, mais avec un sursaut de vigilance. L’esprit est omniprésent mais nul part il ne s’attache en particulier. Il est toujours prêt à agir comme une eau prête à se déverser, et sa force inépuisable vient de ce qu’il est libre, apte à s’ouvrir à toutes choses. « Toute création convenable ne peut réussir que dans l’état purement désintéressé, état dans lequel le créateur est absent en tant que lui-même. Seul l’esprit est présent en une sorte d’état de veille qui ne se colore pas précisément de l’atteinte du « moi » et qui est plus capable de pénétrer tous les espaces, toutes les profondeurs. » Notons que la traduction en français de l’allemand est toujours laborieuse, les phrases sont lourdes dans l’original.
Mais tel est l’art de la vie originelle, pénétrée du « regard de Bouddha ». L’acte pur est vide de pensée, libre et fulgurant, engageant tout l’être d’un coup comme s’il était lui-même l’arc, l’épée ou le poing.
L’adepte avancé connaît alors parfois l’état mental de satori, cet état d’éveil parfait à toutes choses. C’est une intuition qui saisit à la fois la totalité et l’individualité des choses. C’est un fait d’expérience qui outrepasse les limites de l’ego. En logique, c’est voir la synthèse de l’affirmation de la négation à la fois. En métaphysique, c’est savoir par intuition que le devenir est l’être et l’être le devenir – que rien n’est jamais absolu ni immobile mais sans cesse changeant, et qu’il faut s’y adapter.
Dans ce petit livre, l’auteur replace le jeu du tir à l’arc dans toute une philosophie japonaise bouddhiste. La voie du zen permet d’emprunter ce chemin, il est long et ardu, comme toute progression dans une voie quelconque, mais permet de sortir de soi. De quitter sa petite individualité centrée sur ses bobos particuliers et transitoires, de s’ouvrir aux autres, amis ou ennemis, comme au monde naturel qui nous entoure. Ainsi devient-on en accord avec la nature et ses rythmes cosmiques – et avec soi-même.
Eugen Herrigel, Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, 1936, Dervy 1998, 131 pages, €9.00 e-book Kindle €6.99

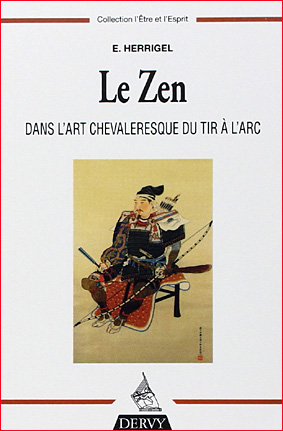

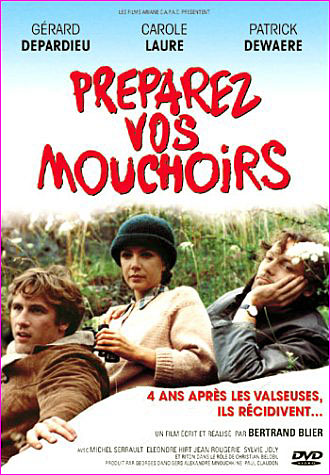





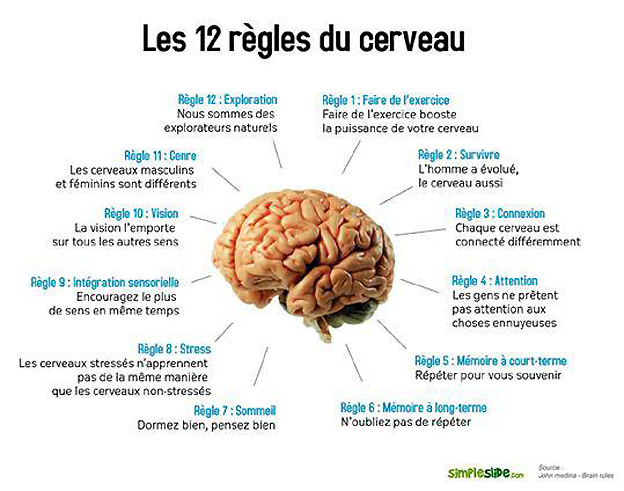
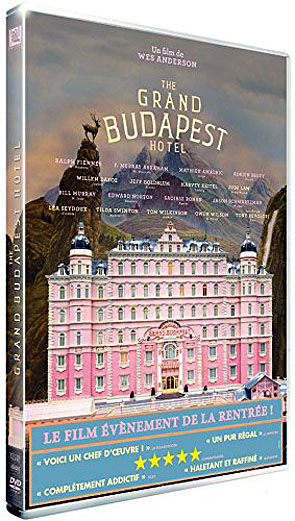




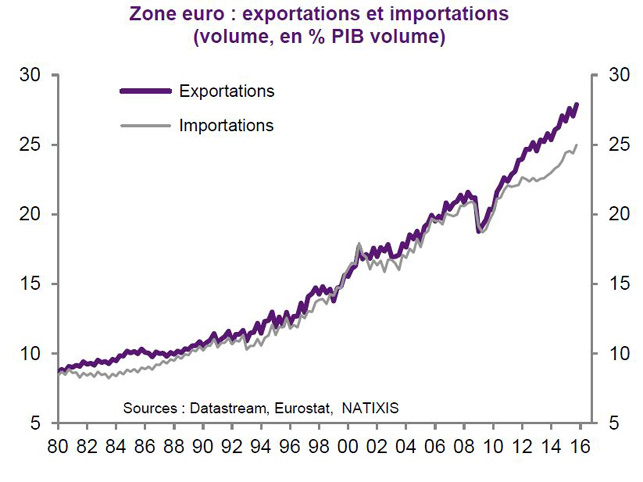
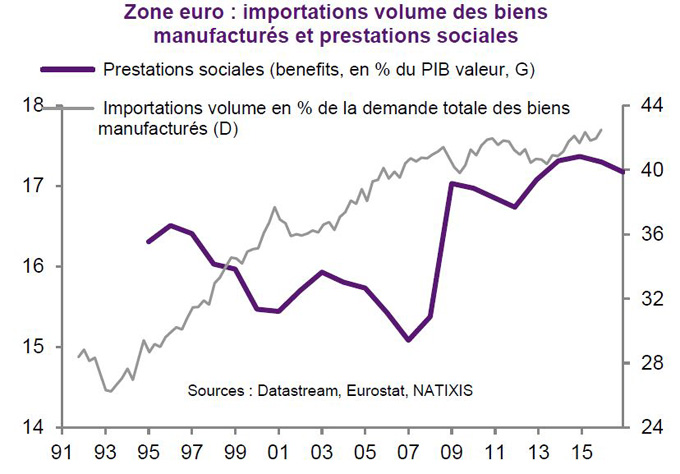
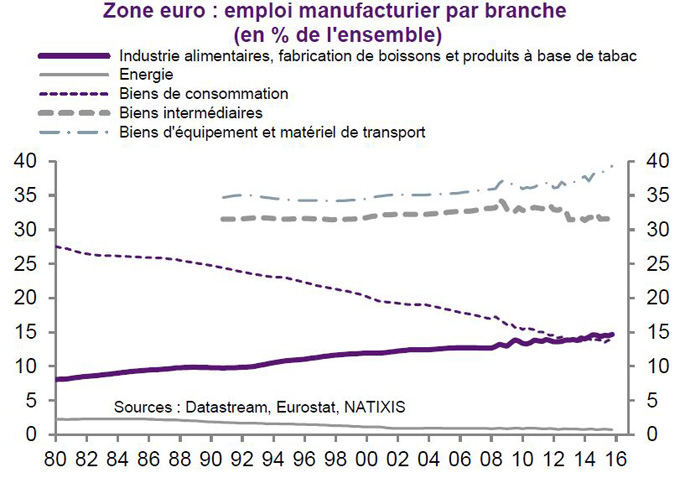
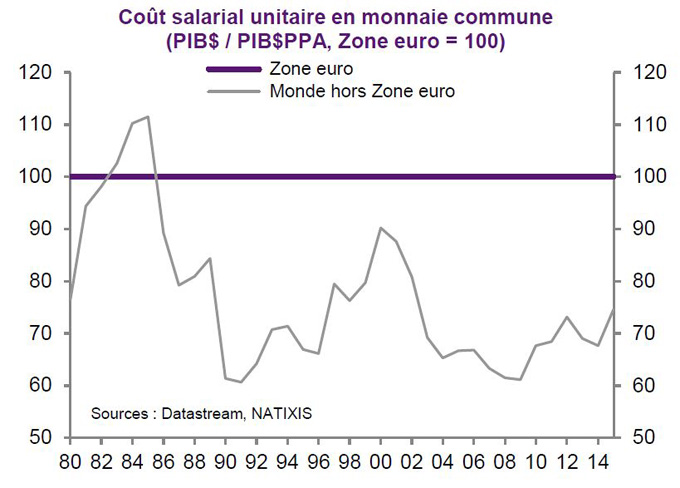

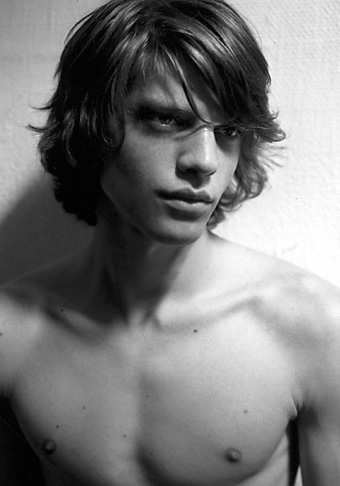


Commentaires récents