
Répétons-le, le libéralisme n’est pas le capitalisme :
- Le capitalisme est une technique d’efficacité économique qui vient de la comptabilité née à la Renaissance italienne et qui recherche l’efficience maximum, prouvée par le profit.
- Le libéralisme est une doctrine politique des libertés individuelles, née en France et en Angleterre au 18ème siècle contre le bon plaisir collectif aristocratique, et qui s’est traduite dans l’économie tout d’abord par le laisser-faire, ensuite par la régulation.
Le libéralisme économique a utilisé le capitalisme comme levier pour démontrer sa croyance. Laissez faire les échanges, l’entreprise, l’innovation – et vous aurez les libertés, la richesse et le progrès. Mais s’il est vrai que l’essor des découvertes scientifiques, des libertés politiques et du capitalisme économique sont liés, il s’agit d’un mouvement d’ensemble dont aucune face n’est cause première.
Comme il est exact que la compétition des talents engendre l’inégalité dans le temps, le libéralisme politique cherche un permanent rééquilibrage : d’abord pour remettre en jeu la compétition, ensuite pour préserver la diversité qui est l’essence des libertés. Toute société est organisée et dégage des élites qui la mènent. Les sociétés libérales ne font pas exception. Ce sont ces élites qui sont en charge du rééquilibrage. Mais elles sont dégagées selon la culture propre à chaque pays :
- l’expérience dans le groupe en Allemagne,
- l’allégeance clanique au Japon,
- l’efficacité financière et le bon-garçonnisme aux Etats-Unis,
- l’appartenance au bon milieu social « naturellement » compétent en Angleterre,
- la sélection par les maths dès la 6ème et l’accès social aux grandes écoles en France…
Tout cela est plus diversifié et moins injuste que le bon vouloir du Roy fondé sur la naissance aux temps féodaux, ou la cooptation et le népotisme fondé sur le respect des dogmes aux temps communistes. Pour appartenir à l’élite, il ne suffit plus d’être né ou d’être le béni oui-oui du Parti, il faut encore prouver certaines capacités. Le malheur est que la pente du népotisme et de la conservation guette toute société, notamment celles qui vieillissent et qui ont tendance à se figer. Ainsi de la France où le capitalisme devient “d’héritier”, tout comme la fonction politique.
C’est là qu’intervient la « vertu » dont Montesquieu (après Aristote) faisait le ressort social. La « vertu » est ce qui anime les hommes de l’intérieur et qui permet à un type de gouvernement de fonctionner sans heurt.
- la « vertu » de la monarchie serait l’honneur, ce respect par chacun de ce qu’il doit à son rang ;
- la « vertu » du despotisme (par exemple communiste ou Robespierriste jacobin) serait la crainte, cette révérence à l’égalité imposée par le système ;
- la « vertu » de la république serait le droit et le patriotisme, ce respect des lois communes et le dévouement à la collectivité par volonté d’égale dignité.
Cette « vertu », nous la voyons à l’œuvre aux Etats-Unis – où l’on explique que la religion tient lieu de morale publique. Nous la voyons en France – où le travail bien fait et le service (parfois public) est une sorte d’honneur. Nous la voyons ailleurs encore. Mais nous avons changé d’époque et ce qui tenait lieu de cadre social s’effiloche.
C’est le mérite du psychanalyste Charles Melman de l’avoir montré dans L’homme sans gravité, sous-titré « Jouir à tout prix ». Pour lui, la modernité économique libérale a évacué l’autorité au profit de la jouissance. Hier, un père symbolique assurait la canalisation des pulsions : du sexe vers la reproduction, de la violence vers le droit, des désirs vers la création. Freud appelait cela « sublimation ». Plus question aujourd’hui ! Le sexe veut sa satisfaction immédiate, comme cette bouteille d’eau que les minettes tètent à longueur de journée dans le métro, le boulot, en attendant de téter autre chose au bureau puis au dodo. La moindre frustration engendre la violence, de l’engueulade aux coups voire au viol. La pathologie de l’égalitarisme fait de la perversion et de la jouissance absolue des « droits » légitimes – bornés simplement par l’avancement de la société. Les désirs ne sont plus canalisés mais hébétés, ils ne servent plus à créer mais à s’immerger : dans le rap, le tektonik, la rave, la manif, le cannabis, l’ecstasy, l’alcool – en bref tout ce qui est fort, anesthésie et dissout l’individualité. On n’assume plus, on se désagrège. Nul n’est plus responsable, tous victimes. On ne se prend plus en main, on est assisté, demandant soutien psychologique, aides sociales et maternage d’Etat (« que fait le gouvernement ? »).
Il y a de moins en moins de « culture » dans la mesure ou n’importe quelle expression spontanée devient pour les snobs « culturelle » et que toute tradition est ignorée, méprisée, ringardisée par les intellos. L’esthétisme est révolutionnaire, forcément révolutionnaire, même quand on n’en a plus ni l’âge, ni l’originalité, ni la force – et que la « transgression » est devenue une mode que tous les artistes pratiquent… Le processus de « civilisation » des mœurs régresse car il est interdit d’interdire et l’élève vaut le prof tout comme le citoyen est avant tout « ayant-droit ». Il élit son maître sur du people et s’étonne après ça que ledit maître commence sa fonction par bien vivre. La conscience morale personnelle s’efface, seule l’opinion versatile impose ce qu’il est « moral » de penser ici et maintenant – très influencée par les séries moralistes américaines (plus de seins nus, même pour les garçons en-dessous de 18 ans) et les barbus menaçants des banlieues (qui va oser encore après le massacre de Charlie dessiner « le Prophète » ?).
Je cite toujours Charles Melman : plus aucune culpabilité, seuls les muscles, la thune et la marque comptent. A la seule condition qu’ils soient ostentatoires, affichés aux yeux des pairs et jetés à la face de tous. D’où la frime des débardeurs moule-torse ou des soutien-gorge rembourrés, du bling-bling si possible en or et en diamant qui brillent à fond et des étiquettes grosses comme ça sur les fringues les plus neuves possibles (une fois sale, on les jette, comme hier la voiture quand le cendrier était plein). Quand il n’y a plus de référence à l’intérieur de soi, il faut exhiber les références extérieures pour exister. On « bande » (nous étions 20 ou 30) faute d’être une bande à soit tout seul – Mandrin contre Renaud. La capacité à se faire reconnaître de son prochain (son statut social) devient une liste d’objets à acheter, un viagra social. En permanence car tout change sans cesse.
Pour Charles Melman, cet homme nouveau est le produit de l’économie de marché. La marchandisation des relations via la mode force à suivre ou à s’isoler. D’où le zapping permanent des vêtements, des coiffures, des musiques, des opinions, des idées, de la ‘morale’ instantanée – comme la soupe. Les grandes religions dépérissent (sauf une, en retard), les idéologies sont passées, il n’y a plus rien face aux tentations de la consommation. D’où le constat du psychanalyste : « La psychopathologie a changé. En gros, aux ‘maladies du père’ (névrose obsessionnelle, hystérie, paranoïa) ont largement succédé les ‘maladies de la mère’ (états limites, schizophrénie, dépressions). »

Il nous semble que cette réflexion, intéressante bien que « réactionnaire », est un peu courte. Charles Melman sacrifie à la mode « de gauche » qui fait de l’Amérique, de la consommation et du libéralisme anglo-saxon le bouc émissaire parfait de tous les maux occidentaux – et surtout français.
L’Amérique, Tocqueville l’avait déjà noté à la fin du 19ème siècle, est le laboratoire avancé des sociétés modernes car c’est là qu’on y expérimente depuis plus longtemps qu’ailleurs l’idée moderne d’égalité poussée à sa caricature. Egalité qui permet le savoir scientifique (contre les dogmes religieux), affirmée par la politique (contre les privilèges de naissance et de bon plaisir), assurée par les revenus (chacun peut se débrouiller en self made man et de plus en plus woman). Cet égalitarisme démocratique nivelle les conditions, mais aussi les croyances et les convictions. Big Brother ne s’impose pas d’en haut mais est une supplique d’en bas : le Big Mother de la demande sociale.
L’autorité de chacun est déléguée – contrôlée mais diffuse – et produit cette contrainte collective qui soulage de l’angoisse. On s’en remet aux élus, jugés sur le mode médiatique (à la Trump : plus c’est gros, plus ça passe), même si on n’hésite pas à les sanctionner ensuite par versatilité (attendons la suite). Ceux qui ne souscrivent pas à la norme sociale deviennent ces psychopathes complaisamment décrits dans les thrillers, qui servent de repoussoir aux gens « normaux » : blancs, classe moyenne, pères de famille et patriotes un brin protectionnistes et xénophobes (le contraire même du libéralisme).
La liberté est paternelle, elle exige de prendre ses responsabilités ; l’égalité est maternelle, il suffit de se laisser vivre et de revendiquer. « Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l’acheter par quelques sacrifices, et ils ne s’en emparent jamais qu’avec beaucoup d’efforts. Mais les plaisirs que l’égalité procure s’offrent d’eux-mêmes. Chacun des petits incidents de la vie privée semblent les faire naître et, pour les goûter, il ne faut que vivre. » (Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique II.1) La marchandisation, c’est le laisser-aller groupal des modes et du ‘tout vaut tout’. Y résister nécessite autre chose que des slogans braillés en groupe fusionnel dans la rue : une conscience de soi, fondée sur une culture assimilée personnellement. On ne refait pas le monde sans se construire d’abord soi-même. Vaste programme…
Charles Melman, L’homme sans gravité, 2003, Folio essais 2005, 272 pages, €7.20
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique tome II, Garnier-Flammarion 1993, 414 pages, €7.00


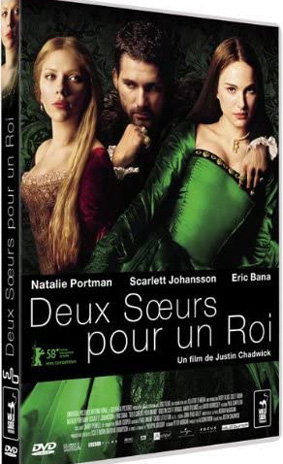









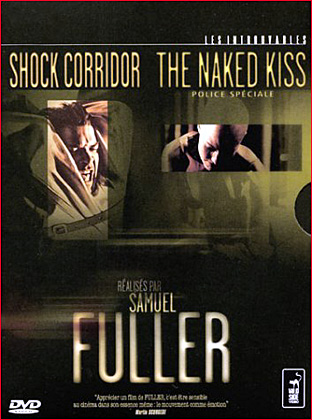










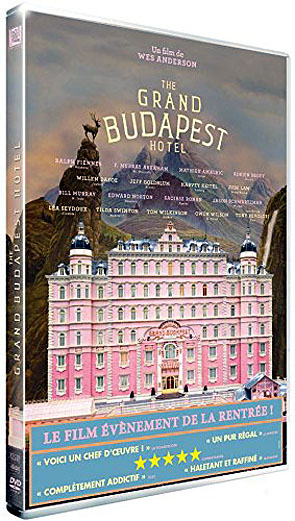








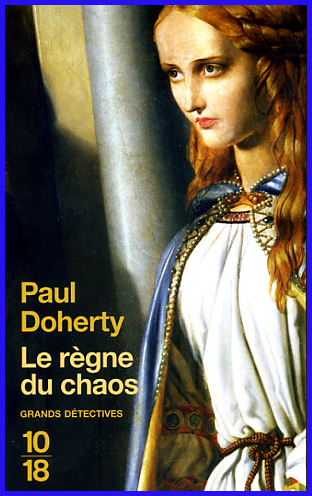


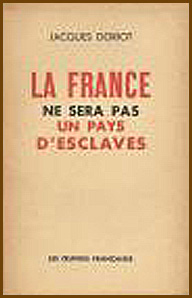


Commentaires récents