Un bon film d’aventures à la gloire des affaires, tourné juste avant le krach retentissant de 2008 qui fait encore des vagues. Il est tiré des seize volumes de la bande dessinée inventée par Jean Van Hamme au début des années 1980 avant Thorgal et dessinée par Philippe Francq.
Nerio Winch, « métèque » parti de rien, a réussi à bâtir un conglomérat mondial. De double nationalité suisse et américaine, il a établi son siège social à Hong Kong « parce que la Chine lui promettait un grand développement ». Le spectateur trouve ici l’acmé du mondialisme sans scrupules, le pur intérêt privé allant là où les profits allèchent, sans aucun lien personnel. Ce monde, qui disparait dans l’hubris affairiste et la concurrence féroce des nationalismes qui ressurgissent, est une curiosité. Le scénariste introduit des passions humaines shakespeariennes dans le monde froid de l’économie.
Car Nerio (Miki Manojlovic), qui croque une pomme vespérale sur le pont de son yacht ancré dans les eaux de l’île Victoria à Hong Kong, se penche sur un bruit d’eau qui provient de la mer. Il est happé par un plongeur tout en noir qui le noie tout simplement. Il est déclaré mort par accident. Qui va capter son empire ? La belle et glacée Ann Fergusson (Kristin Scott Thomas) aux crocs aiguisés et à la volonté de fer ? L’ex-trafiquant d’armes Mikhaïl Korsky (Karel Roden), épave camée, alcoolisée et pas rasée à la Houellebecq ?
Coup de théâtre : un fils est révélé. Adopté mais réel, élevé en secret en Croatie puis en Suisse, probablement aimé mais devenu routard chic au Brésil après sa rébellion ado contre son « père ». Le garçon se prénomme Largo, terme venu de nulle part mais qui a été fortement donné aux petits garçons après la sortie du film. Un prénom de crise ? Une façon bobo d’exorciser la mauvaise fortune ? L’acteur qui joue le jeune homme de 26 ans, Tomer Gazit, en a 33 ans au tournage. Il représente la quintessence du cosmopolitisme façon XXe siècle : né en Allemagne de parents juifs israéliens mais élevé en France dès 9 ans, il aurait des grands-parents biélorusses et lituaniens côté paternel et yéménites côté maternel. Rien de bien grave à titre personnel, mais une charge symbolique forte dans le film. Emacié et peu émotif il va, comme poussé par les circonstances, ballotté par les affaires.
La performance de casting a été de découvrir des acteurs crédibles pour jouer Largo bébé, enfant puis adolescent. Jake Vella, Kerian Mayan, Benjamin Siksou ressemblent tous à un Tomer Sisley à 1 an, 11 ans, 20 ans.
Tandis qu’il se fait tatouer un scorpion sur l’épaule par un Chinois du Brésil pour se rendre « invincible » (sic !) il entend une femelle se faire violenter par de gros mâles flics. Il vole à son secours et à coup de krav maga les met en fuite ; il s’échappe torse nu sur une moto avec la blonde (Mélanie Thierry), ce qui donne une course poursuite haletante dans les favelas. La fille se révélera une pute au sens capitaliste, une fille de haut vol qui loue son sexe sans affect pour de l’argent, beaucoup d’argent, n’hésitant pas à jouer les agents doubles et même triples si elle peut gagner de tous les côtés. En bref après la baise (évidemment torride mais surjouée), le bel étalon endormi est piqué par l’hétaïre et se retrouve serré par les flics à côté de deux paquets de cannabis bien épais. Il est condamné à 50 ans de prison. Exit donc l’héritier, même s’il ne sait pas que son père adoptif vient de mourir.
Mais il a appris à se débrouiller seul. Il joue donc au camé et maîtrise sans problème les deux geôliers qui viennent le tirer de sa cellule ; il les y enferme et va récupérer son passeport chez le chef… où il trouve Freddy, le garde du corps de son père qu’il connait bien et qui l’a tiré de mauvais pas, adolescent. Freddy (Gilbert Melki) a posé un paquet de dollars pour acheter sa libération mais Largo n’en a pas besoin ; il assomme le chef, empoche les dollars et saute dans un 4×4 avant de défoncer les voitures et motos de flics qui peuplent la cour (« c’est ma méthode ») puis la porte de la prison.
Le spectateur en aura dès lors pour tous ses yeux : si la psychologie est sommaire et les expressions d’acteurs réduites au minimum, les scènes d’action sont réussies, rythmées par une musique adaptée comme dans James Bond. Trahisons et finance font bon ménage, l’intelligence consistera à les contrecarrer, mais surtout le culot comme au poker (dont l’acteur Tomer est un adepte fini).
L’héritier aura du mal à se faire reconnaître des grosses têtes qui composent son Conseil d’administration – mais il possède 65% des parts dans une Ansalt du Lichtenstein (trust privé très utilisé pour l’évasion fiscale) qui évite les droits de succession car les titres sont au porteur. Mais lorsqu’il faut les produire, tout est bon pour pister l’héritier qui sait et mettre la main sur les papiers… Largo s’abouche avec Korsky, Freddy joue les traîtres, Fergusson ordonne et contrôle – jusqu’à l’assemblée générale du groupe où tous les coups tordus se révèlent aux actionnaires ravis.
DVD Largo Winch, Jérôme Salle, 2008, avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlovic, Mélanie Thierry, Gilbert Melki, Karel Roden, Steven Waddington, Anne Consigny, Radivoje Bukvic, Nicolas Vaude, Benjamin Siksou, Kerian Mayan, Jake Vella, Wild Side vidéo 2009, 1h44, standard €4.70, blu-ray €11.94










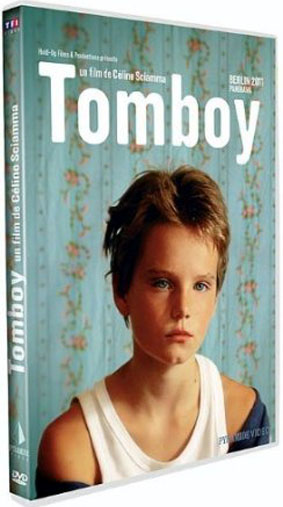


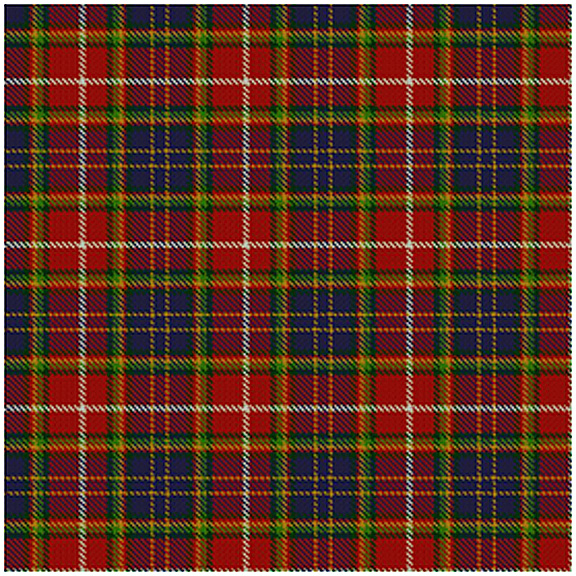

Commentaires récents