Ce recueil de chroniques polémiques qui s’étalent de 1964 à 2012 a reçu le prix Renaudot essai en 2013 – et suscité l’ire envieuse de l’ex-maitresse Vanessa, une trentaine d’années après ses premières frasques. Le titre, un brin gamin, est emprunté à Edmond Rostand dans L’Aiglon. Ce fils de Napoléon 1er cherche à se définir face à son père : ainsi fait Gabriel face aux pères de substitution que furent les grands auteurs qu’il affectionne et les pères de l’église orthodoxe à laquelle il se complait à demeurer fidèle.
L’auteur se dit « par indifférence aux modes, obstinément lui-même » p.10 – ce qui déplaît aux moralisateurs qui voudraient que tous fussent réduits à leur austérité étriquée. Matzneff se veut « écrivain épris de liberté » en un siècle qui en a fort manqué. Le XXe, avec la militarisation des mœurs due à la guerre de 14 « célébrée » par Hollande, le lénino-stalinisme des camps et de la pensée partisane célébrés par Sartre et les intellos compagnons de route, le fascisme et le nazisme suivi par d’autres intellos activistes, le conservatisme chrétien de Franco, Horthy et Pétain suivi par la majorité silencieuse, la pensée unique « de gauche, forcément de gauche » scandait la Duras, qui empoisonna la politique des années soixante à deux mille dix, l’hygiénisme moral au prétexte de « social » ou « d’écologique » qui tend à savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous et à vous l’imposer par injonction sans débat, le retour à l’ordre moral que véhicule la mondialisation yankee – rien de cela ne penche pour un siècle de liberté ! En bref, l’auteur bien de son temps est opposant à son siècle. Il a épousé la révolution libertaire de mai 68 – à déjà 32 ans – par haine de la famille (la sienne surtout qui l’a laissé écartelé enfant entre parents divorcés) et du confort paisible bourgeois. Il n’a pas perçu que cet anticonformisme de santé est devenu avec les années un conformisme de plus, celui de la transgression permanente.
Le plus cocasse dans l’affaire Vanessa Springora, est que Matzneff, orateur invité à la librairie bordelaise Mollat le 13 décembre 2007 dans un colloque sur « le viol », ait déclaré : « J’ai publié chez Gallimard le journal intime de mes amours avec cette jeune Vanessa, La prunelle de mes yeux, amours pleines de péripéties avec lettres anonymes de dénonciation à la brigade des mineurs et tout le saint-frusquin. Vanessa me disait : « S’ils te mettent en prison, j’irai me jeter aux pieds du président de la République, je lui dirai que je t’aime à la folie, je le supplierai de te libérer ». p.91. Mais ni en 2007, ni en 2013 à la parution de Séraphin, la Springora ne s’est manifestée. Ce n’est qu’à la toute fin de 2019, pressée par la moraline ambiante et exigeant plus de rigueur qu’elle n’a eu personnellement pour sa fille de désormais 13 ans, elle porte l’affaire dans l’édition d’abord, puis en justice. Lorsque l’on a une telle « morale » à éclipse, lorsque l’on « croit » que le plaisir pris jadis avec délices « doit » être qualifié d’inqualifiable et que l’on retourne sa veste, reniant ce qu’on a adoré, peut-on encore faire la leçon aux autres ? Je trouve une telle attitude pitoyable et la personne qui l’incarne méprisable. Le « moi aussi » à la mode a encore frappé : être comme la horde, être « une victime », quel bonheur moral !
Si Gabriel Matzneff se dit « révolutionnaire » comme tant d’autres, c’est moins en politique et encore moins en économie : c’est avant tout sur les mœurs. Après tout, la « révolution de mai » a débuté à la fac de Nanterre lorsque les garçons ont voulu rejoindre le dortoir séparé des filles au printemps 68. Les laisser baiser aurait été une mesure d’ordre et de conservatisme politique, tout changer pour que rien ne change ; il n’en a rien été et les barricades dans la rue, la contestation de toutes les institutions, l’épithète « fasciste » appliquée à toute contrainte (y compris de la langue) a été la réponse à la répression sexuelle. La liberté est devenue la licence, puis le « droit obligatoire » de baiser en tout temps, n’importe où, avec quiconque. Comme Michel Houellebecq l’a excellement montré, cette liberté-là est devenue contrainte. Il fallait faire comme tout le monde, un « tout le monde » générique fantasmé. Pour exister, il fallait donc sans cesse en rajouter dans la « libération », aller plus loin que ce fameux « tout le monde ». Gabriel Matzneff, par solitude et carence affective s’est intéressé adolescent à ses pairs plus jeunes puis, à peine adulte, aux très jeunes filles pubères. Il s’en est vanté auprès de ses amis, s’est étayé de références littéraires romaines et Renaissance, a chanté le soleil et la chair, les corps et la bonne chère, célébré Vénus, Priape et Bacchus. Il a fait des jaloux, les aigris qui n’avaient pas son talent lui sont tombé dessus sous des prétextes « moraux ». Car la morale (qui est opinion commune fluctuante) sert à vilipender qui ne vit pas comme vous, ne pense pas comme vous, ne baise pas avec autant de plaisir que vous, a plus de talent que vous. L’envie réclame l’égalitarisme : si je ne parviens pas, que personne n’y parvienne !
Ces chroniques rassemblées sont inégales et souvent répétitives : mettez une pièce dans la machine à écrivain et tout un paragraphe vient en entier, d’un coup, réitéré tel quel de chronique en chronique. L’auteur se défend au prétexte de pédagogie qui exige de répéter les idées, au prétexte qu’une chronique est un tout qui ne peut être amputé : n’empêche, le lecteur commence à se dire qu’il radote.
Leur intérêt tient surtout au style, qui est le propre de l’écrivain. Et Matzneff en est un, qui écrit d’une langue solide et littéraire, avec des élans primesautiers à la Montherlant lorsqu’il devient familier. « Je ne suis pas un politique », avoue-t-il p.32 et ça se voit. Ses notes sur les Palestiniens laïcs, un Kadhafi troisième voie entre américanisme et soviétisme, les vertus d’un Saddam Hussein et d’un Bachar El Hassad pour tenir les communautés et protéger « les chrétiens d’Orient » sont des prises de position un peu naïves et hors de tout contexte. Son antiaméricanisme primaire est estampillé extrême-droite et tradition française, il hait moins la domination économique et l’impérialisme politique que la contrainte morale puritaine qui contamine désormais plutôt la gauche « de gouvernement » avide de l’opinion des ménagères de 50 ans gavées de téléfilms partiaux, féministes et moralistes (voir TF1 !). Elles font le gros de l’opinion selon les datas. Les goûts de Matzneff vont vers le plaisir et « Camus n’a jamais été un de mes auteurs de chevet », avoue-t-il p.43. Dommage, ce méditerranéen l’aurait peut-être fait réfléchir.
« Ma génération aura vécu une brève période d’euphorie libertaire qui, en France, dura une douzaine d’années – de 1970 à 1982 environ – au cours de laquelle, pour ce qui me concerne, je pus écrire et publier des romans tels qu’Isaïe réjouis-toi et Ivre du vin perdu, des essais tels que Les moins de 16 ans et Les passions schismatiques, mon journal intime d’adolescence, Cette camisole de flammes. (…) Ce printemps de liberté ne dura pas. Promptement, Tartufe et Caliban revinrent au pouvoir, se faisant spécialement bruyants, contraignants. Dans les médias on n’entendait qu’eux » p.221. Il faut dire que son cercle d’amis tournait autour du sexe, des déviances à la bien-pensance morale, de la « libération » des mœurs : « Carole et Paul Roussopoulos, Georges Lapassade, Guy Hocquenghem, René Schérer, ces noms sont indissolublement liés à la part la plus enthousiasmante, heureuse, de ma vie d’écrivain, de citoyen engagé dans les luttes et les espoirs de son temps » p.144. Il était surtout engagé à fond dans la bouche, le cul et le con de ses mignons et mignonnettes. Matzneff écrit en 1981 déjà, à propos de Heidegger – mais cela peut s’appliquer à son cas : « Un écrivain est comptable de tout ce qu’il signe, et son œuvre est une » p.63. Sauf qu’il pointe aussi une chose très juste : « Ceux qui, dans mes romans, mes essais, mes poèmes, mon journal, s’appliquent à ne retenir que les passages libertins, scandaleux, et font silence sur tout le reste, pour mieux me condamner, me clouer au pilori, ne font que révéler les passions inavouées qui dévorent leurs méchants cœurs, ils dévoilent leur propre infamie » 2012, p.218.
« Nous étions convaincus que nos livres pouvaient contribuer à rendre la société plus lucide, et donc plus libre ; nous voulions convaincre nos lecteurs de ne pas avoir peur de leurs passions, nous voulions leur enseigner le bonheur » 2011 p.196. Ce temps libéral libertaire a passé – et le prix Renaudot essai marque sa borne miliaire. Il récompense un bilan révolu, dont le « c’est la fin ! » du titre dit l’essentiel. Une fin qui s’étire puisque le Journal est définitivement clos « le 31 décembre 2008 » selon la page 113. « L’originalité de mon journal intime est de ne pas être le journal de ma vie intellectuelle et sociale, mais essentiellement celui de ma vie érotique, de mes amours. Dieux du ciel ! cette imprudence (certains de mes amis la nomment « inconscience ») fit scandale » 2009, p.125. Eh oui… pour vivre heureux, vivons caché. Casanova a publié ses mémoires à la toute fin de sa vie, quant à Gide, il n’a publié qu’un journal expurgé, le reste étant réservé au demi-siècle qui suivrait. Peut-être étaient-ils moins narcissiques ou pressés d’engranger une provende sonnante et trébuchante à claquer ?
Gabriel Matzneff, Séraphin c’est la fin ! 2013, La Table ronde, 267 pages, €18 e-book Kindle €12.99























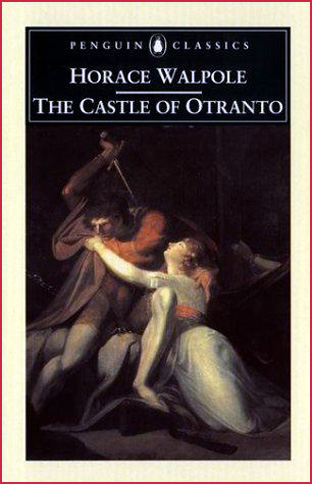




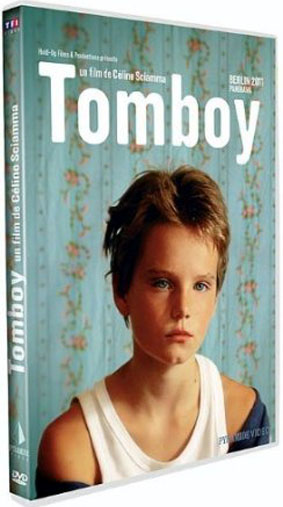

Commentaires récents