Dionysos est un dieu dialectique. Ambivalent, il unit aussi les contraires. C’est un dieu de synthèse, entre le monde d’en bas et celui de l’Olympe, entre l’avant et l’après. Ancien professeur d’histoire ancienne à l’université de Paris-VIII, Maria Daraki nous offre dans ce petit livre une étude d’anthropologie historique passionnante sur la pensée sauvage et la raison grecque.
Il est lumières et ténèbres. Un éclair marque sa naissance. Lorsqu’il sort de la cuisse de Zeus, où il a parachevé sa gestation commencée dans le ventre d’une mortelle, il est armé de deux torches. Il est gardien du feu, rôdeur de nuit, assurant la jonction des ténèbres et de la lumière. Sa couronne est de lierre, plante de l’ombre, soporifique, et il porte la vigne, plante solaire, enivrante, qui pompe les sucs de la terre pour les faire chanter au soleil. Union de la surface terrestre et du monde souterrain, Dionysos circule entre le monde des morts et celui des vivants. C’est pourquoi il est le maître de l’élément liquide, l’eau qui sort de sous la terre puis y retourne. La mer, dit Maria Daraki, n’est « couleur de vin » selon Homère que dans sa fonction dionysiaque d’antichambre du monde ténébreux. Le serpent est l’animal du dieu car il joint le terrestre et le souterrain. Il joint aussi la saison ; par les offrandes alimentaires aux morts, les rituels de végétation relancent la circulation entre sous terre et sur terre. L’abondance est un cycle de dons et de contre don entre Gaïa et ses fils. Le milieu est magique, non humanisé par le travail. Le « sacrifice » de Dionysos, en ce sens, n’est pas une passion souffrante comme celle du Christ, mais un cercle qui traverse la mort pour renaître comme celui d’Osiris.
Pour cela même, Dionysos intègre les enfants à la cité. Il dompte par les rites, dont celui du mariage, les poulains et les pouliches sauvages que sont les jeunes garçons et les jeunes filles. C’est la « culture » qui établira la distinction entre enfants légitimes et bâtards, dont dépend la citoyenneté. Le mariage dompte la virginité (Artémis) et le désir (Aphrodite). Il humanise parce qu’il juridise la sexualité brute. Mais, toujours ambivalent, le dieu instaure les Dionysies qui sont une fête de transgression dans une Athènes très masculine. C’est un carnaval qui lève toutes les barrières. Les temples des dieux sont tous fermés sauf celui de Dionysos. La civilisation est mise entre parenthèses pour se ressourcer et renouveler, comme chaque année, l’alliance du dieu et de la cité. Comme rite d’intégration, on offre au garçonnet dès trois ans des cruches de vin, on fait s’envoyer en l’air les petites filles sur des balançoires, symbole sexuel rythmique. Moitié divin, moitié animal, l’enfant est un petit satyre dionysiaque qui se passe de déguisement. Freud, plus tard, a retrouvé cette intuition en le qualifiant de « pervers polymorphe ». Dionysos lui-même est un amant, un séducteur, pas un satyre. Ni homme, ni enfant ; ni humain, ni taureau ; il se propose à la reine en amant–fleur. Il est l’éphèbe fugace, beauté fragile, triomphe du printemps entre enfance et virilité, inachevé mais en devenir. Une fois de plus, le dieu unit les contraires dans les catégories comme dans le temps.
Car l’humanité grecque antique se pense en catégories collectives : masculin, féminin, enfant. L’union sexuelle est le miracle ou les trois se rejoignent pour perpétuer l’espèce. Homme et femme sont des instruments de la terre, non des agents. Ils doivent subir l’épreuve de médiation pour récolter ce qu’ils attendent, des nourritures et des rejetons. Les figurines « d’enfant–phallus » symbolisent les pères qui renaissent en fils, transmettant au-delà des personnes la catégorie collective mâle. Maria Daraki conclut, dans ce contexte, que l’inceste n’est pas transgression sexuelle mais transgression du temps de filiation. Œdipe est la tragédie des deux logiques : l’une, collective, de reproduction de la catégorie mâle, l’autre de quête d’identité ; le désordre filial produit par l’inceste est insupportable.
Le but d’un homme est de produire un fils, voir un petit-fils s’il n’a que des filles. La continuité de la filiation masculine importe, les femmes ne sont que des vases de nutrition. De même, les femmes sont une race à part, issue de Pandora. Pour les Grecs, la somme des âmes est stable et tourne. Dès que la terre a repris son « germe fécond », l’aïeul devient fécond à son tour et un petit-fils peut surgir du sol. Pour que le groupe humain se perpétue, il faut que s’épanouisse l’ensemble du règne vivant, espèces sauvages comprises. C’est l’activité procréatrice équitable de la terre. L’écologie aujourd’hui en revient à cette conception du tréfonds très ancien de l’esprit occidental.
La religion grecque est séparée en deux ensembles : céleste et chtonien. Les Olympiens conduits par Zeus sont personnes juridiques. Les divinités collectives patronnées par Gaïa sont anonymes et polyvalentes (Erinyes, Heures, Grâces, Titans, Nymphes). Elles sont des valeurs vitales dont l’orientation est la reproduction de tout ce qui vit, et sa nutrition. Les hommes, par l’institution civilisée de la société, se donnent comme milieu. Ils s’adaptent à la nature magique par le culte et le rituel, car la terre enfante tout, enfants, bêtes et plantes. Le monde est circulaire, la vie naît de la mort, les opposés sont également nécessaires au système. Les rituels ne sont pas des événements mais l’éternel retour du même, l’aller–retour cyclique des échanges vitaux entre sur terre et sous terre. Au contraire, la raison des dieux use exclusivement des oppositions. Elle est « logique de non–contradiction », selon Aristote. Le vote à l’Assemblée, la décision du tribunal, doivent trancher. La religion olympienne distingue un espace civilisé – ou règnent les rapports contractuels – et un espace sauvage – ou règnent les rapports magico-religieux. L’homme doit choisir, et cette capacité de choix est à la base de l’invention de la morale, de la logique, de l’histoire.
Coexistent donc deux systèmes, deux « intelligences adultes » : la pensée circulaire et la pensée linéaire ; les valeurs vitales et les valeurs politiques ; les rapports magico-religieux au milieu et les rapports de travail sur le milieu ; la logique circulaire « éternelle » et la logique linéaire du « temps » ; le culte et le droit ; Gaïa avec les divinités chtoniennes et Zeus avec les Olympiens ; le mariage reproduisant tout le règne vivant et le mariage reproduisant la cité politique et mâle ; le oui ET le non comme le oui OU le non ; le cercle d’éternel retour et le linéaire du progrès. La tragédie va naître de la transition entre ces deux logiques, et Dionysos va émerger comme médiateur.
« C’est l’athénien qui est tragique au Ve siècle. Mais tragique dans l’euphorie. La nouvelle société, celle de la cité démocratique, est une société profondément voulue. Nul n’a exprimé l’attachement général à la polis plus ardemment que les tragiques. Et ce sont eux qui, en même temps, ont mesuré dans toute sa profondeur le plus épouvantable des gouffres : l’écart entre le social et le mental que nous appelons désadaptation » p.188. L’émergence du dionysisme coïncide avec la carte des cités en Grèce. Le contrat politique importe plus que l’origine ethnique autochtone. L’hellénisation engendre un sentiment de supériorité plus que l’origine. On ne naît pas grec (donc civilisé), on le devient par l’éducation de la cité.
Présent en Grèce depuis le IIe millénaire, fils de Zeus et d’une princesse mortelle, Dionysos s’éveille brusquement vers la fin de l’époque archaïque. C’est le moment où le démos s’oppose aux nobles, où se fixent les cités et les rapports juridiques. La fonction de Dionysos est de gérer l’antique passé en tant que dieu olympien nouveau. Un Olympien atypique car il permet à tous les autres grands dieux de l’être dans les normes. Dionysos subordonne le système de reproduction au royaume du père, dieu du politique. La religion de terre fut repoussée du côté des femmes et des cultes à mystères. Le dionysisme participe à la fois à la religion de la terre et à la religion civique. Féminin et secret d’une part, masculin et public de l’autre, son culte a deux volets qui se déploient sur deux univers religieux. Il est un médiateur entre deux mondes étrangers. Il aménage l’âme sauvage sans l’altérer, il ménage la raison et l’éthique.
Entre la logique du logos et celle qui l’a précédée en Grèce, il n’y a pas eu passage mais affrontement, puis négociation. Dès que la nouvelle pensée surgit, l’ancienne dispose d’un pôle de comparaison qui lui permet de se penser depuis « l’autre ». La culture grecque que nous aimons est « fusion de deux modes logiques. Celui, linéaire et exclusif, qui est conforme aux besoins de la Grèce du politique, et cet autre exprimant une Grèce sauvage qui avait pensé le monde en cercle et développé une autre logique, circulaire et inclusive, qui traite les oppositions par oui et non. C’est pour avoir superposé le cercle et la ligne que la Grèce a pu réussir cette combinaison des deux qui en est le plus beau produit : non « la raison » mais la raison dialectique. C’est elle qui est en œuvre dans tout ce qui en Grèce est beau, le dionysisme, la tragédie, la dialectique spéculative, les mythes dont l’intrigue inclut son propre commentaire, et la beauté des formes qui, dans l’art, nous donne à voir la greffe de l’abstraction sur les valeurs anciennes, elle, corporelles… » p .230.
La synthèse dialectique est équilibre instable, sans cesse remis en cause. Le débat grec dure encore. « Dans le cas de la Grèce, nous serons précis : c’est la construction de la « personne », de l’identité individuelle, qui introduit contrainte et intolérance, et ouvre une guerre sans merci à « l’âme sauvage ». On ne peut pas être à la fois individu et sujet collectif, avoir et n’avoir pas de contours. Mais comme cela mène loin ! La vraie « personne » est au centre de l’ordre olympien, au centre de la filiation linéaire, au centre du temps irréversible, au centre du tribunal et de la citoyenneté active. En d’autres termes, elle est au centre de toutes les composantes de la « raison grecque ». » p.235.
Le dionysisme a surgi comme une protestation contre le prix à payer. Elle a été protestation organisée, formalisée en fête. Zeus, dieu juste, a eu deux enfants-dieux seulement, qu’il a pris la peine d’engendrer tout seul : Athéna, déesse de la raison, et Dionysos, dieu de la folie. Le nouveau et l’ancien coexistent en nous comme les deux cerveaux de notre évolution et en notre culture avec la science et le sacré. Et nul besoin d’avoir la foi pour ressentir du sacré. Dionysos est un dieu complexe, intéressant les origines de notre civilisation, et que nous devons connaître.
Maria Daraki, Dionysos et la déesse Terre, 1985, Champs histoire 1999, 287 pages, €9.00



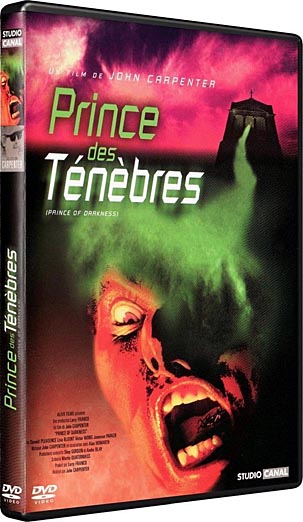





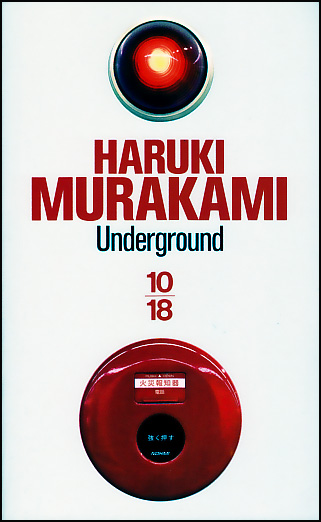
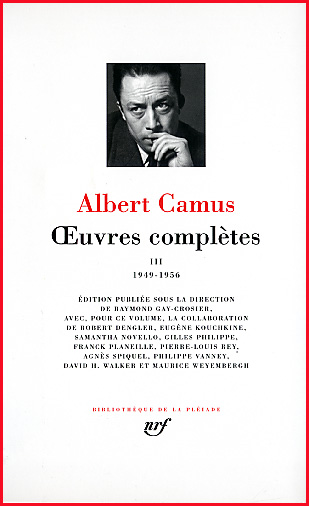



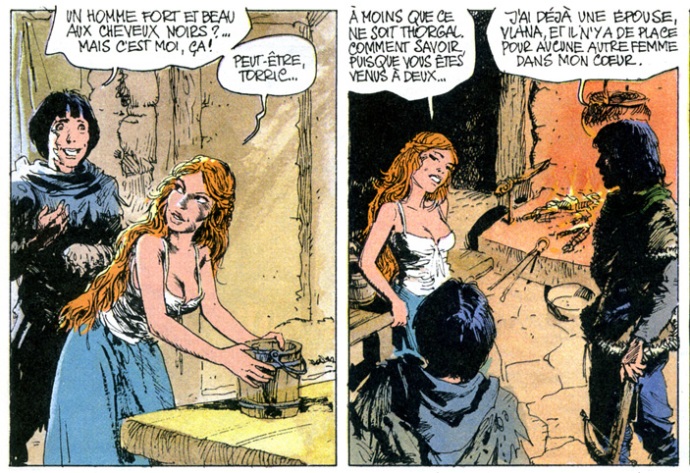

Commentaires récents