Marx est, selon Raymond Aron, « avant tout l’auteur du Capital », dont seul le Livre premier a été publié par lui (les deux autres sont restés des brouillons inachevés, publiés ensuite par Engels). Partant de la philosophie, passant par la sociologie politique, Marx se veut économiste scientifique héritier du courant anglais. Les lois économiques capitalistes ne sont pas pour lui universelles mais liées à un régime économique particulier. Tout régime économique ne peut être pris qu’en regard de sa structure sociale, insérée dans l’histoire (Marx est ici héritier du rationalisme de Hegel).
L’essence du capitalisme est la recherche du profit avant tout. La raison à cela est qu’il est fondé sur la propriété privée des moyens de production et qu’il incite à l’appât du gain.
Elevons ici une objection (que Raymond Aron, pris dans l’ambiance unanimiste de son temps, ne formule pas) : Marx fond en un seul concept capitalisme et régime de domination politique fondé sur l’économie. C’est sa méthode philosophique d’embrasser le tout, mais un analyste scientifique se doit de distinguer l’outil de son utilisation – et la philosophie n’est pas « scientifique ». Le capitalisme au sens strict est une méthode de gestion efficace qui consiste à produire le plus et le mieux avec le moins en capital, en matière et en compétences. L’origine du capital et l’appropriation du profit ne sont pas du ressort de cet outil d’efficacité. Marx appelle ‘capitalisme’ l’outil et son usage, ce qui n’est pas scientifique. C’est l’idéologie libérale, qui est celle de la bourgeoisie, qui fait du désir individuel la mesure de toute chose, donc de la propriété privée du capital et de l’incitation du profit un « bien ». Rien n’empêcherait un groupe associatif, menés par une autre idéologie, par exemple le souci collectif écologique, de produire le mieux avec le moins – par souci d’empreinte humaine minimum sur l’environnement. Le capitalisme serait alors un outil utilisé pour d’autres fins que l’appropriation privée. Mais il demeurerait cette technique issue de la comptabilité (et qui remonte aux Etats antiques d’Asie pour raisons fiscales et militaires) de produire aux moindres coûts – sachant que tous les coûts sont à considérer (y compris humains et environnementaux).
Pour Marx, tout rapport d’échange de marchandises serait un rapport d’égalité. En revanche, quand l’échange est constitué d’argent (tout en portant sur in fine la marchandise), le rapport devient inégal, il recherche du surplus d’argent : le profit. Marx élabore donc une théorie de la valeur, une théorie du salaire et une théorie de la plus-value.
- La valeur de la marchandise serait proportionnelle à la quantité de travail nécessaire à la produire, tout en oscillant selon l’offre et la demande.
- La valeur du travail se mesurerait comme toute marchandise. Le salaire est un minimum vital qui varie suivant les époques (les marchandises dont on a besoin pour survivre), avec un aspect social et psychologique (relatif au niveau de vie acceptable et au souci de tenir son rang dans son milieu).
- La plus-value serait la quantité de travail non payée aux salariés, captée par l’entrepreneur, pour payer l’Etat, ses actionnaires et lui-même, après la rémunération des employés, des impôts et des investissements de production et d’innovation. Le ratio plus-value/valeur ajoutée mesurerait le « taux d’exploitation ». Il y a hausse de la plus-value quand la durée du travail ou l’intensité du travail (la productivité) augmente sans que les salaires bougent.
Comme le taux de profit est remis en cause par la concurrence, le moteur du capitalisme est l’innovation. Elle permet de produire plus avec moins et reconstitue, pour le temps limité du brevet, un monopole hors d’atteinte de la concurrence.
Ici s’arrête le Livre premier du ‘Capital’, seul publié par Marx lui-même. Les Livres 2 et 3 l’ont été par Engels sur les brouillons de Marx et contiennent nombre de contradictions. Marx y esquisse une théorie macro-économique sur l’innovation, une théorie des crises cycliques fondée sur la concurrence, une théorie sur le devenir du régime économique capitaliste fondée sur la baisse tendancielle du taux de profit. La concurrence permanente oblige à innover pour être toujours en avance d’un potentiel de profit. Mais le rattrapage des concurrents exige d’être plus compétitif, donc de prélever une plus-value croissante sur la part ajustable des coûts que sont les salaires. La baisse du pouvoir d’achat engendre surproduction, ce qui aboutit aux récessions périodiques où les faillites permettent d’assainir le paysage des producteurs. Marx théorise une baisse tendancielle du taux profit qui devrait aboutir à la paupérisation croissante du plus grand nombre, ce qui inciterait à changer de régime par une révolution. Ce qui n’est pas avéré depuis qu’il l’a écrit.
Depuis un siècle et demi que cette théorie a vu le jour, aucune révolution politique ne s’est produite pour ces motifs. Au contraire, le régime d’efficacité capitaliste a été employé comme outil avec succès par des régimes non libéraux (parti communiste chinois, Etats jacobins ou dictatures éclairées). Ce qui a permis aux pays « sous-développés » de devenir « en développement » avant d’être désormais clairement « émergents ». Ce n’est pas à une paupérisation croissante que l’on assiste dans le monde entier mais à une hausse générale du niveau de vie. Il ne subsiste des poches de pauvretés que là où l’outil d’efficacité capitaliste n’est justement pas employé : Cuba socialiste, Corée du nord social-dictature, chefferies africaines en guerre permanente, régimes claniques du Moyen Orient et de Russie. Raymond Aron, avec les exemples qu’il avait en 1967, écrivait qu’il n’y avait aucune « démonstration concluante de l’autodestruction du capitalisme ».
Il ne reste que des raisons morales théoriques, prolétarisation et paupérisation, qui ne sont ni « scientifiques », ni même économiques, mais philosophiques et politiques. Que la collectivité régule les égoïsmes et que les groupes sociaux revendiquent une part du gâteau, c’est la démocratie (idéal philosophique) et toute la politique des groupes d’intérêts (réel pratique) : qu’y aurait-il de « scientifique » en cela ? Comment pourrait-on en déduire une « loi de l’Histoire » déterministe ? Marx partageait avec Ricardo l’idée (archaïque, propre aux sociétés paysannes) que plus le niveau de vie augmente, plus le taux de natalité augmente. La réalité sociale, depuis lors, va exactement à l’inverse : plus le niveau de vie augmente, plus les couples règlent leur nombre d’enfants vers l’équilibre de reproduction, autour de deux enfants par femme. Et cela dans le monde entier, quelle que soit la culture ou la religion : voir l’excellent livre de Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations.
La crise récente, issue de la spéculation et des mauvaises politiques de contrôle des Etats, change l’idéologie dominante ; elle ne change en rien l’outil capitalisme. Il s’agit toujours – et plus que jamais pour des raisons de rareté des ressources et des compétences humaines – de produire le plus efficacement possible (le plus et le mieux avec le moins), ce que seul l’outil capitalisme sait bien faire. En revanche, le libéralisme se reprendra des dérives égoïstes propres à sa version anglo-saxonne pour retrouver ses racines plus communautaires d’Europe occidentale, du Japon ou de l’Inde.
Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, 1967, Tel Gallimard, 659 pages, €18.00 e-book Kindle €12.99
Raymond Aron, Le marxisme de Marx (son cours des années 1970), de Fallois 2002, 600 pages, €29.00
Karl Marx, Le Capital livre 1, Folio essais 2008, 1056 pages, €12.10

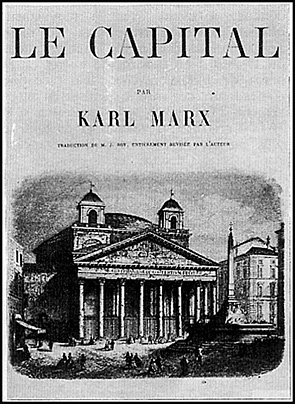
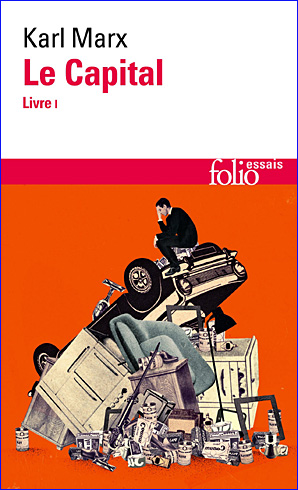



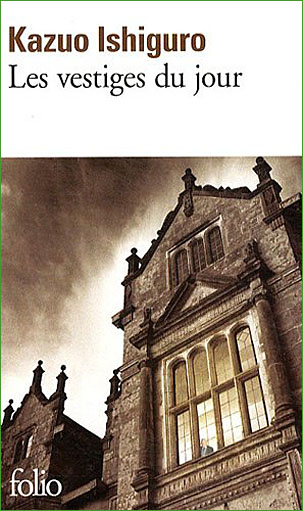
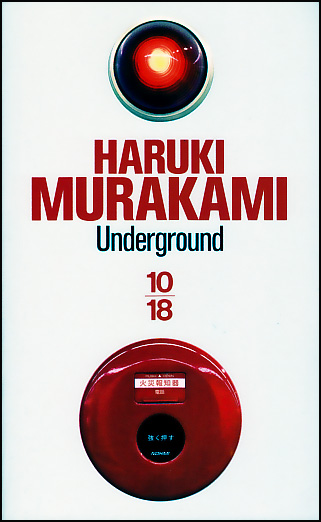
Commentaires récents