1929, (…) 1987, 1998, 2001, 2008… Tous les dix ou douze ans un krach imprévu survient, venu de nulle part, anticipé par personne ou seulement par ceux qui crient au loup pendant des années et ont un fois sur dix ans raison. Or c’est dans la panique que l’on fait les meilleures affaires parce que la raison est lâchée et que tout le monde crie sauve-qui-peut. Mais il n’y a jamais urgence à intervenir car une panique s’étend par vagues comme un incendie et qu’elle ne s’éteint pas de suite, pas avant que les « mains faibles » aient éradiqué jusqu’à la dernière trace de risque en vendant tout ce qui leur est possible. Trump trompe les Etats-Unis en déclenchant une suicidaire guerre commerciale (surtout à ses alliés) et booste artificiellement la croissance par des baisses massives d’impôts – au détriment de l’équilibre budgétaire et de l’endettement d’Etat. Mais Trump s’en fout, il ne joue qu’à court terme : les élections à mi-mandat puis sa réélection dans deux ans –– et que crève l’Amérique du moment que la Vérité qui est la sienne, l’histoire qu’il se raconte, est crue par les gogos.
Nous vivons dans un monde tragique. Contrairement au monde platonicien où tout est dans l’ordre – hors du monde – le monde tragique est mi-figue mi-raisin, toujours. Il n’y a pas « d’autre monde possible » ni de Dieu salvateur, ni de souverain Bien, ni de Loi de l’Histoire, ni de Vérité qui n’attend que d’être « révélée » comme si elle existait déjà, sous-jacente : il y a au contraire l’infini complexité du monde naturel et des profondeurs humaines. Le pire et le meilleur – toujours. Le yin et le yang, mêlés, ce petit point de couleur opposée dans la virgule de l’autre. Le tragique est notre monde ; le monde des Idées (de Platon, de Hegel, de Marx et des marxistes, du Pape et des croyants de la finance) n’est pas le monde réel mais le monde rêvé.
Si la crise financière a été si grave et si longue depuis 2007-2008, qu’un moment rien n’a valu plus rien, c’est à cause de la croyance souveraine en la Vérité en soi, la Modélisation et la Sophistication.
La vérité
Lehman Brothers, la banque qui a fait la retentissante faillite dont on fête les dix ans ces temps-ci et qui a déclenché la panique financière globale en quelques semaines dans le monde entier, a fait comme toutes les entreprises : elle a parqué des engagements dans le hors-bilan. Enron avait fait pareil (ce pourquoi elle a elle aussi fait faillite en 2002) et cela continue. Pourquoi ne pas changer le modèle comptable ? Pourquoi croire tellement en la Vérité – la transparence, la confession publique, le grand déballage pipole à l’américaine – qu’il faille autoriser que certaines dettes ne figurent pas au bilan et évaluer en comptabilité tous les engagements à terme au seul prix de marché instantané ? Cela fonctionne tant qu’un marché fonctionne ; mais quand il n’y a plus que des vendeurs (dans les situations de panique) le meilleur actif ne « vaut » plus rien ; il n’a « pas de prix » parce que personne n’est capable de proposer un quelconque prix – personne ne veut acheter ! La Vérité platonicienne n’a que faire des pauvres larves qui se traînent sur le sol : pas de prix, pas de valorisation – et que tous les Lehman du monde fassent faillite du moment que la Vérité comptable et immuable rayonne.
Les modèles mathématiques
Se souvient-on encore du fonds LTCM, en faillite virtuelle en 1997 avant que la Fed n’appelle à la rescousse un pool de banques (dont Lehman…) pour le sauver ? Ce fonds qui spéculait sur l’avenir avec un effet de levier colossal avait été fondé par des prix dits « Nobel » d’économie et était alimenté de modèles mathématiques qui tournaient dans de jeunes têtes bien pleines. Sauf qu’un modèle n’invente rien : il ne sort que ce que vous lui avez entré, la moulinette en plus… Or, rien de ce qui est humain n’obéit aux lois impeccables de la physique – ce pourquoi on désigne les sciences en question d’« humaines ».
Si vous entrez dans un modèle des données passées, il vous sortira la probabilité que le passé ressemble à l’avenir – jusqu’à ce qu’une aile de papillon engendre un cyclone (ce qu’on appelle par euphémisme les « queues de distribution »). Le risque est très peu « probable » mais, lorsqu’il survient les 1 % du temps calculé, vous le subissez à 100 % ! Où a-t-on modélisé le comportement de foule et la panique des marchés ? Si, chez les analystes, le risque disparaît si volontiers qu’ils projettent à l’infini le taux de croissance long terme évalué aujourd’hui (oui, à l’INFINI !) – dans le monde réel, humain, qui a une fin, le risque existe. On ne fait pas boire un âne qui n’a plus soif, mais un analyste ou un modélisateur, si. Il a « raison » puisque le calcul le démontre – et que tous les Lehman du monde fassent faillite du moment que le Modèle mathématique immuable rayonne et que les procédures de théoriques sont rigoureusement appliquées.
La sophistication financière
L’économie, au fond, c’est assez simple : faire avec ce qu’on a pour produire plus que les éléments épars. Mais l’économie est trop simple, trop vulgaire de bon sens pour les sectateurs de Vérité armé du Modèle mathématique. Tout est calculable, disent-ils, et du moment que tout est Vrai (transparent, étalé, disséqué, oublié à force d’être sous votre nez) – rien de faux ne peut arriver. Tous les établissements financiers (banques, assurances, fonds de pension) qui détiennent des actifs ont procédé à des échanges de ces actifs par swaps et autres opérations à terme ; à de la titrisation de prêts plus ou moins risqués, au mélange dans des produits sophistiqués des risques pour offrir une façade acceptable ; à des ventes et des couvertures de ces mêmes produits dans un sens et dans l’autre.
Tout cela théoriquement se calcule, volatilité historique et risque instantané, perte maximum probable. Avec cela, on se croit invulnérable. Voire… comme les opérations sont complexes, très nombreuses et conclues pour des années, toute situation de panique fait entrer dans le brouillard. Plus personne ne sait qui a quoi et qui doit quoi à qui. Il y a pour des années de cadavres dans les placards, subprimes, asset-backed security (ABS), Special Purpose Vehicle (SPV), Special Purpose Company (SPC), Structured Investment Vehicle (SIV), Asset-backed security (ABS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Collateralised debt obligation (CDO), Collateralised Bond Obligation (CBO), Collateralised Loan Obligation (CLO), Collateralised Commodity Obligation (CCO), Collateralised Fund Obligation (CFO), Collateralised Foreign Exchange Obligation (CFXO), Whole Business Securitisation (WBS), etc. Trop compliqué, trop répandu, trop abstrait. Il suffit de seulement 8 % de l’actif en réserve pour obtenir des agences la meilleure notation AAA…
Une grande banque française que je connais bien, farcie de tête d’œuf formatées aux seuls maths dans leur courte existence, ne craignait pas d’affirmer que leur « modèle des spreads de swap » avait « recours à un modèle de corrections d’erreurs qui permet de distinguer les tendances de long terme des chocs court terme éphémères. » Et d’assurer, un peu plus loin dans le texte que « la modélisation offre une robustesse et un pouvoir prédictif élevé. » Certes… quand toutes choses sont égales par ailleurs. Ce qui justement n’est jamais le cas dans les périodes de panique mais qu’importe – et que tous les Lehman du monde fassent faillite du moment que la Sophistication raffinée de la finance rayonne.
Vérité, Modélisation et Sophistication sont la rançon de la Raison pure, ce tropisme platonicien qui sépare le souverain Bien (toujours hors du monde, dans l’abstrait des idées) de la dégradation réelle, concrète, terrestre. A long terme ? « Mais nous serons tous mort ! » s’écriait John Maynard Keynes. Lui, au moins, était un économiste qui avait compris que la science humaine n’est pas mathématisable de part en part et que subsistera toujours cette incertitude du risque : justement parce que nous sommes mortels et que nous n’avons pas le temps. Keynes fut l’un des rares économistes à être devenu riche en investissant personnellement en bourse. En 1929, il a élaboré sa fameuse Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie que tout le monde cite encore sans probablement l’avoir lue.
L’excès de dettes pourrait engendrer une panique, donc un retrait de tous de tout, et un krach. Pas l’équivalent de 1929 ou de 2018, qui n’a lieu semble-t-il qu’une fois par siècle, mais quand même. Et avec le paon gonflé d’ego à la tête de la (pour l’instant) première puissance mondiale, le risque croit très fort. Soyez-en avisé !


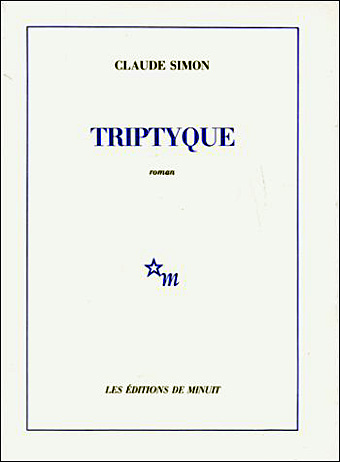




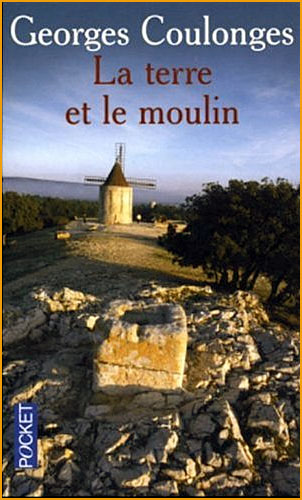
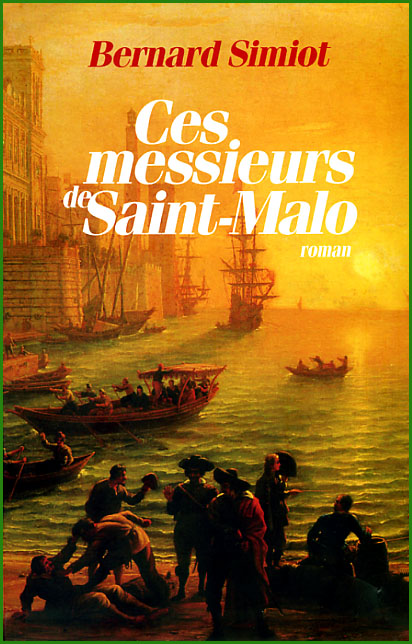
Commentaires récents