Zarathoustra s’abîme en poésie « avant le lever du soleil ». Il frissonne de désirs divins en contemplant le ciel profond, abîme de lumière. Car le ciel donne une idée de l’infini – et du hasard incalculable. Il est un abîme de lumière parce que seule la lumière « est » dans cet infini de l’espace.
La lumière est le soleil, le dieu Apollon dont le nom signifie puissance, dans sa gloire de jeunesse éternelle et sa raison qui tranche comme un rayon. Il est la clarté de l’intelligence grecque en contraste avec la passion obscure de Dionysos, ce dieu de l’ivresse et des forces biologiques, venu d’Asie. Nietzsche fera de la synthèse de ces deux dieux mythiques le socle de son affirmation philosophique. L’instinct vital commande, mais la « volonté » vers la puissance d’être est du ressort de l’esprit autant que du corps.
« Le dieu est voilé par sa beauté : c’est ainsi que tu caches tes étoiles. » Il est pur et implacable, comme la vie dans sa volonté d’être. « Tu ne parles point : c’est ainsi que tu m’annonces ta sagesse ». Qu’est-il en effet besoin de « parler », de ratiociner sur l’évidence ? Vivre est une évidence ; elle est sagesse en soi, elle n’a pas besoin d’être justifiée par la parole ou le raisonnement.
Le dieu de Nietzsche est son ami : « N’es-tu pas la lumière comme je suis le feu ? N’es-tu pas l’âme sœur de mon intelligence ? Ensemble nous avons tout appris ; ensemble Nous avons appris à nous élever au-dessus de nous, vers nous-mêmes et à avoir des sourires sans nuages. » Tel Apollon, « avec des yeux clairs » et « de très loin » comme avec l’arc et les flèches qui sont ses attributs.

« Au-dessous de nous se concentrent comme la pluie, la contrainte et le but et la faute. » Apollon est au-dessus, comme se voudrait Zarathoustra le prophète de Nietzsche, qui n’a pas encore accompli son ultime métamorphose : l’innocence. Il n’est encore que lion en révolte contre le monde et la société de son temps, minée de christianisme coupable, soumise au Dogme moral et velléitaire. « Toute ma volonté n’a d’autre but que de prendre son vol, de voler vers toi. Et que haïssais-je plus que les nuages qui passent et que tout ce qui te ternit ? »
Ces nuages sont les ratiocinations qui empêchent de vouloir, ces normes de moraline qui inhibent l’action, cet esclavage religieux qui régente la vie. « J’en veux aux nuages qui passent, à ces chats sauvages qui rampent : ils nous prennent à toi et à moi ce qui nous est commun, notre affirmation, notre acceptation de tout. » L’affirmation est celle de la volonté de vie, l’acceptation celle du hasard de vivre.
« Nous en voulons à ces médiateurs et à ces mêleurs, les nuages qui passent : à ces êtres mixtes et incertains qui n’ont appris ni à bénir, ni à maudire du fond du cœur. » Autrement dit, à tous ceux qui ne savent pas ce qu’ils veulent parce qu’ils ne savent pas qui ils sont, qui n’osent pas s’affirmer, qui ont peur de la vie et de ses dangers. Notons le mépris nietzschéen pour tout ce qui est mélangé, pas clair, assis entre deux chaises, métis. Nietzsche aurait abhorré la « culture métisse », le « multiculturel », le grand métissage idéaliste pour abolir les différences – aujourd’hui rejeté en réaction par les woke, qui affirment au contraire leur infime différence pour en faire un drapeau militant. Ce qui n’empêchait pas Nietzsche d’assimiler des cultures étrangères, tel le bouddhisme ou certains aspects du judaïsme – mais il ne s’agissait pas de mélange, de « en même temps », mais de faire sien, d’absorber et de transformer selon soi-même pour se changer, ce qui n’est pas la même chose.
Nietzsche préfère la confrontation franche et le débat sans concession à l’hypocrite relativité intellectuelle qui met tout sur le même plan. « Car je préfère le bruit et le tonnerre et les outrages du mauvais temps à ce repos de chats circonspects et hésitants ; et, parmi les hommes, je hais surtout ses êtres incertains marchant à pas de loups, ces nuages qui passent, en doutant et hésitant. » La vie est une affirmation, pas un atermoiement. La volonté tranche et ne reste pas à se demander quoi faire.
Ainsi de « l’État de droit » dont nous rebattent les oreilles les belles âmes impuissantes – et au fond heureuses de le rester. Quel est ce « droit » qui ne serait appliqué qu’aux citoyens et pas aux « sans papiers » ou « expulsables » qui disparaissent dans la nature ? Qui ne sanctionnerait que les manquements des citoyens hors des « zones de non-droit » qui se multiplient par lâcheté dans les banlieues gangrenées par le salafisme et le trafic de drogue ? Comment, face aux meurtres terroristes ou aux règlements de comptes du seul droit du plus fort et pas celui de la République, rester sans rien faire et se dire impuissants ? Ne faut-il pas agir, au risque de bousculer la machinerie bureaucratique française, européenne et le droit-de-l’hommisme abstrait ? Est-il un autre premier « droit de l’Homme » que de celui de vivre ? Il serait peut-être bon, comme nous y invite Nietzsche, de clarifier notre ciel et d’affirmer nos « valeurs » (ce qui vaut pour nous) sans culpabilité.
« Et voici ma bénédiction : être au-dessus de chaque chose comme son propre ciel, son toit arrondi, sa cloche d’azur et son éternel certitude : et bienheureux celui qui bénit ainsi ! Car toutes choses sont baptisées à la source de l’éternité par-delà le bien et le mal ; mais le bien et le mal ne sont eux-mêmes que des ombres fugitives, d’humides afflictions et des nuages fuyants. » Car ce qui vaut fluctue, les valeurs inscrites dans le droit évoluent, les sociétés changent et la nôtre aussi, n’en déplaisent à ceux qui voudraient figer les gens en un seul dogme – qu’il soit monothéiste, tradi ou ethnique. « Sur toutes choses, se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. ‘Par hasard’, – c’est là la plus ancienne noblesse du monde, je l’ai rendue à toutes choses, je les ai délivrées de la servitude du but. » La vie n’est pas voulue, elle est : hasard et nécessité, sortie des molécules agitées sur une planète particulière en conditions favorables. Il n’y a pas de Projet ni de but, la vie va comme elle va, avec sa volonté vers la puissance de chaque être et les obstacles qu’elle se crée parfois elle-même et qu’elle doit surmonter (comme, pour l’humain, la prolifération démographique, le gaspillage des ressources limitées et le réchauffement climatique).
« J‘ai enseigné qu’au-dessus d’elles, et par elles, aucune ‘volonté éternelle’ – n’affirmait sa volonté. » L’être humain est seul sur une planète infime, dans l’infini de l’univers ; il poursuit aveuglément son propre chemin, accomplit sa propre volonté vers la puissance en affirmant sa vie. C’est folie, mais Nietzsche a enseigné que la vie n’était pas « raisonnable » – elle ne se raisonne pas, elle se vit comme un état de fait.
Nietzsche ne nie pas la raison. « Un peu de raison cependant, un grain de sagesse, dispersé d’étoiles en étoiles, ce levain est mêlé à toutes choses : pour l’amour de la folie la sagesse est mêlée à toutes les choses ! » Mais la certitude est avant tout le hasard, sur lequel danser, qu’on le veuille ou non. Il est trop facile de se réfugier comme l’autruche dans le sable, dans un quelconque dogme qui expliquerait tout depuis les commencements du monde : nous n’en savons rien, et pas plus les prêtres que les scientifiques. Sauf que les seconds cherchent alors que les premiers croient avoir déjà tout découvert, « révélé » une fois pour toutes.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

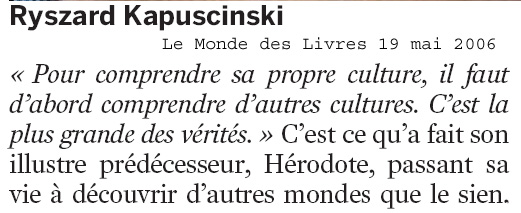

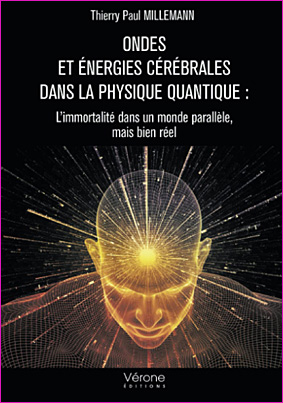

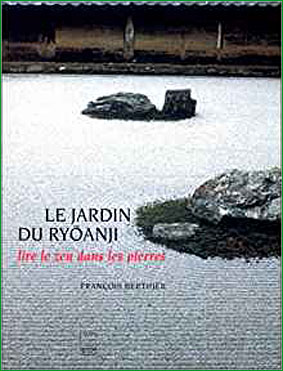





































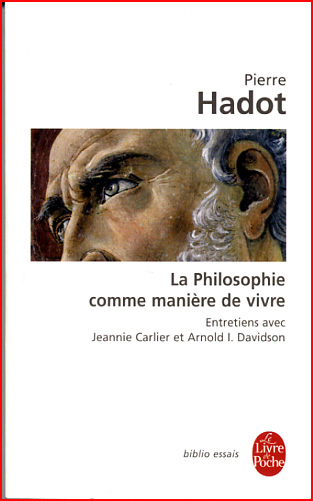

















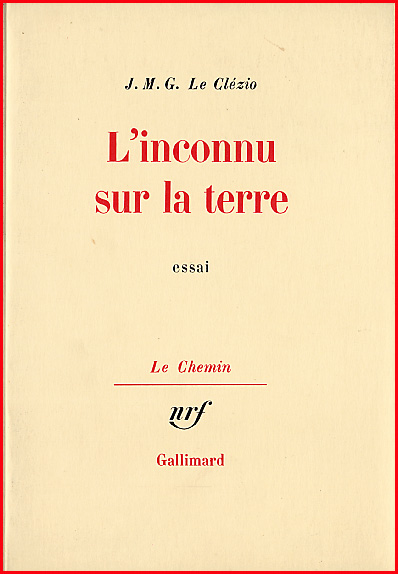




Commentaires récents