Plum plum péplum ! Revu XXIe siècle mais bel et bien péplum avec héros invincible et musculeux, amour impossible et victorieux, épreuves inouïes vite évanouies. La mode n’étant plus à la civilisation ni à la morale, les Romains sont les méchants qui ont massacré les gentils Celtes si délicieusement sauvages, les gens de Rome sont des gens de la capitale qui méprisent les bouseux de province, et le sénateur est un arrogant officiel qui ne se sent plus aucune probité face à la femelle qu’il convoite.
En face, Milo le Celte qui porte curieusement un nom gréco-latin (Kit Harington). Il a vu enfant son père tué à l’épée au combat et sa mère décapitée par le sénateur Corvus – qui signifie corbeau – (Kiefer Sutherland), alors tribun en Bretagne (l’actuelle « Grande » Bretagne). Fuyant sous la pluie dans la forêt, le gamin inoxydable est récupéré par un marchand d’esclaves qui le baffe, l’élève à la dure et le fait gladiateur. Le jeune homme, qui n’a plus rien à perdre, vainc sans problème tous les adversaires qu’on lui oppose car il est vigoureux et habile. Bardé de muscles comme d’une cuirasse, il manie l’épée courte des Romains comme personne.
Un imprésario des jeux plein d’ennui en province le voit combattre et l’achète pour l’arène. Il le produira à Pompéi, sa ville, où le cirque tient sa réputation intacte depuis un siècle. Sur le chemin, la colonne d’esclaves enchaînés en haillons voit un chariot s’embourber dans une ornière et l’un des chevaux de l’attelage s’écrouler en hennissant, blessé. Milo le Celte, qui aime les chevaux pour les avoir fréquentés quand il portait encore tunique et cheveux longs, demande qu’on le déchaîne pour achever l’animal. Sur les instances de la belle Romaine qui occupe le chariot, Cassia (Emily Browning), le bellator y consent.
Cassia est la fille d’un riche campanien promoteur immobilier qui veut bâtir une ville nouvelle à Pompéi avec un nouveau cirque et attend de l’empereur Titus qu’il l’encourage et le finance pour sa gloire. Mais ce dernier envoie un sénateur dans la lointaine province du sud à l’automne de l’an 79, au moment des Vinalia, la fête du vin – et ce sénateur est Corvus. Il est toujours flanqué de son âme damnée Proculus, soldat costaud et vrai Romain qui l’a aidé à mater la rébellion celte (Sasha Roiz). Corvus se moque de Pompéi, il y voit une occasion d’y faire de l’argent mais surtout d’obtenir contre sa participation au projet du père, la main de sa fille qui se refuse à lui et qui a quitté Rome pour le fuir.
Pour flatter le sénateur, le père fait venir les deux plus beaux esclaves gladiateurs comme décor érotique à la réception officielle du projet. Cassia revoit donc les muscles et l’amoureux du cheval qui lui avait tapé dans l’œil. Milo calme la jument qui a pris peur des signes avant-coureurs d’un tremblement de terre ; il la calmera de nouveau lorsqu’elle revient sans son palefrenier parti la débourrer le soir aux abords du Vésuve. Le volcan gronde comme si la débauche, l’orgueil et les méfaits des Romains devenaient insupportables aux dieux. Pline le Jeune le décrira, cité dès les premières images.
Corvus sénateur est jaloux de l’aura de Milo et exige de l’impresario qu’il le fasse combattre en premier aux jeux du cirque et le tue. Ce n’est pas ce qui était prévu car le bellator (qui a donné bellâtre) désirait garder le jeune homme pour Atticus, un gigantesque Noir (Adewale Akinnuoye-Agbaje), dans le dernier combat – attendu grandiose – entre deux montagnes de muscles rusées dont le prix sera en théorie la liberté. Telle est la loi romaine, mais qui peut y croire, opérée par des arrogants qui se croient tout permis ? Atticus s’en aperçoit très vite lorsqu’il se retrouve enchaîné à la colonne centrale du cirque, aux côtés de Milo, jouant avec leurs compagnons les Celtes rebelles contre une centurie de gladiateurs déguisés en soldats romains. Rejouer devant lui la victoire du sénateur Corvus sur la rébellion celte est destiné à le flatter et le chœur en rajoute lourdement (pour ceux qui n’ont pas compris).
Mais Milo et Atticus réussissent à résister, Atticus abat la colonne fait de mauvais plâtre armé (signe que le promoteur immobilier est véreux) et Milo parvient à briser l’aigle romaine. C’en est trop pour le sénateur qui, cette fois, impose sa volonté sans nuance : Cassia est renvoyée à la maison malgré son père et enfermée sous bonne garde, tandis qu’il ordonne à Proculus d’aller tuer le Celte. C’est à ce moment que le Vésuve, atterré, se réveille un peu plus et, quoique Corvus tente de récupérer les événements naturels en invoquant Vulcain, le cirque s’écroule (au sens propre et figuré) et les spectateurs des gradins fuient dans une panique indescriptible.
Le port est bombardé de boules de lave volcanique, un tsunami submerge toute l’avant-ville tandis que des cendres incandescentes commencent à dévaler des pentes du volcan dont le sommet explose dans un Grand-Guignol de fin du monde apprécié d’Hollywood. Milo part délivrer Cassia prise sous les décombres du toit de sa maison mais ne peut fuir et retourne au cirque chercher des chevaux. C’est là que Corvus reprend Cassia et l’enchaîne à son char avant de partir au triple galop pour quitter la ville. Milo les poursuit et réussit à les rattraper comme dans un western où l’Indien serait le gentil contre ceux de la diligence, tandis que Cassia se délivre toute seule. C’est au tour de Corvus d’être attaché à son char renversé, puis laissé là par un Milo curieusement magnanime à la vengeance des dieux.
Les deux amants fuient mais ils sont trop lourds pour un seul cheval et la nuée les rattrape. Fin tragique, montrée dès le début : deux amants ensevelis sous les cendres du Vésuve, unis dans un baiser éternel.
Le scénario est primaire mais l’action violente. Les effets spéciaux sont bien redoutables mais le Vésuve en fond de toile fait quand même un peu décor peint. Tout saute, tout explose, la vague engloutit tout et la nuée rattrape le reste. La Pompéi antique est bien reconstituée sur maquettes archéologiques mais le cirque a résisté, on le visite encore… Les caractères sont bien trempés et le spectateur le plus stupide n’a aucun effort à faire pour distinguer sans peine le bien et le mal. Reste le puritanisme anachronique des producteurs américano-germano-canadien qui drape les femmes comme sous Victoria et a grand peine à dénuder partiellement les hommes, même au combat. La musculature de Kit Harington aurait sans conteste mérité mieux et aurait justifié l’excitation d’Emily Browning qui paraît un brin rapide pour être vraisemblable. Mais, vous l’aurez compris, un péplum ne fait jamais dans la nuance depuis Ben-Hur, quand même bien meilleur malgré son âge.
En bref un film pour ados juste avant les boutons ou pour un primaire qui n’apprécie au cinéma que la romance, la bagarre et l’apocalypse. No future !
DVD Pompéi, Paul Anderson, 2014, avec Kit Harington, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss, M6 vidéo, 1h41, standard €7.99 blu-ray €11.81
Pompéi, ce qu’il en reste, sur ce blog

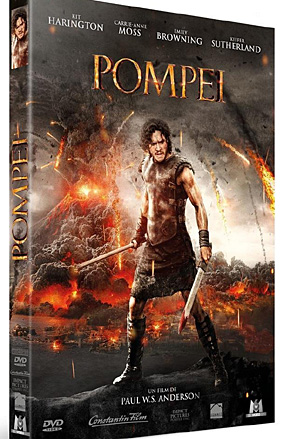

























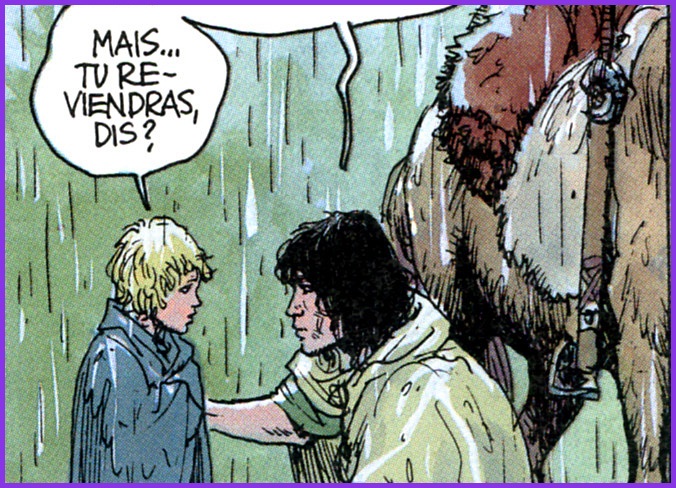






Commentaires récents