Arthur est un roi très connu; il mange autour d’une table ronde.
Arthur est aussi un caleçon pour homme; à rayures ou à petits carreaux, il coûte dans les 35€.
Arthur est encore un petit garçon né en 2006 ; il a rencontré dans un trou les Minimoys (ces mini mois narcissiques d’époque).
Arthur D., comme Desperate Student était une rencontre 2010 ; toujours curieux des autres, je l’ai évoqué dans mon blog Fugues & Fougue aujourd’hui disparu. L’article est encore lisible sur Paperblog et Ideoz (1029 lectures).
Il n’a pas changé aujourd’hui, refusant de grandir. Arthur D. Little prend donc le nom de petit Arthur, homonyme (sans rapport) d’un célèbre cabinet de conseil en stratégie fondé en 1886.
Citations favorites, du temps qu’il était sur un réseau social bien connu : « Philosopher n’est qu’une autre manière d’avoir peur et ne mène qu’aux lâches simulacres. » Où l’on voit qu’intelligence sans caractère n’est que faiblesse de l’âme. Ou encore : « La Grande Crise confirma les intellectuels, les militants, les citoyens ordinaires dans la conviction que quelque chose était foncièrement vicié dans le monde qui était le leur. » Nous y voilà. Arthur Little se sent étranger dans le monde adulte, français, contemporain. Il n’aurait jamais du quitter le giron de l’école, il aurait pu faire une prépa après Louis-Le-Grand parce qu’il y réussissait bien (1er accessit en thème latin), enfin poursuivre sur les rails tracés par l’institution. Cela l’aurait au moins mené quelque part, peut-être jusqu’à la maturation adulte. Mais Arthur n’est pas en phase avec ses condisciples, qu’il juge épidermiques au sens physique et mental ; ils ne songent qu’à se frotter dans les teufs après s’être anesthésiés aux substances alcooliques et poudreuses, avant de reprendre le collier des idées reçues, des habitudes hétéro bien vues et des opinions politiquement correctes. (La satire d’une conversation de café entre une étudiante et un étudiant valait la lecture !)
Arthur D. a tenté une première année de fac en philo par goût de la théorie, puis a laissé tomber pour cause d’enseignants confits en administration (j’arrive, je dicte mon cours, je m’en vais, je ne suis pas payé pour le reste). Aucun copain étudiant, chacun pour soi, le seul attrait éventuel était entre mâles et femelles. Quel avenir ? La seule profitation ? La reproduction fonctionnarisée du système ? No future : « En France, l’université fonctionne pour les profs et l’administration, pas pour les élèves. » Aujourd’hui 25 ans, Arthur D. Little ne fait rien. Que lire des livres, se promener dans Paris, parfois écrire. Ce qui n’est pas si mal, au fond quand on ne sait pas quoi faire.
[La photo ci-contre n’est pas lui, mais il y a un vague air…]
Ces derniers temps, il s’est retiré du réseau social et a supprimé son blog. Ce n’est pas la première fois, il me disait déjà en 2010 : « je crois que je ne vais pas tarder à supprimer le blog (de même que j’ai déconnecté mon compte Facebook) ». Il alterne ainsi entre volonté de s’ouvrir aux autres et de se refermer sur lui. Il veut être reconnu, puis rester ignoré. Peur d’être adulte, d’assumer ses idées, ses relations, son être. Il plutôt goûté en 2010 ce que j’ai écrit après notre première rencontre : « J’ai lu le joli article que vous m’avez consacré sur le blog. Il est bienveillant et fidèle à ma réalité actuelle. Vous m’avez compris. J’aime bien aussi la photo des chaussures adolescentes vertes-grises un peu usées comme une métaphore de mon existentialisme ». Je l’avais senti, il rêve d’abolir le temps pour rester Peter Pan, l’adolescent perpétuel comme le Justin Bieber d’époque qui est un peu son idéal sentimental. Il lui faudrait un père mais ce n’est pas mon rôle. « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé », dit le renard au Petit prince ; je suis responsable, donc « bienveillant ».
Arthur écrit bien, mais au fil de la plume, répugnant à mettre de l’ordre dans l’anarchie du désir et le flux pulsionnel. Cela convient à la littérature où il montre quelque don, moins à la réflexion, bien qu’il tâte de l’essai. Il fait « trop long et trop touffu », comme lui disaient déjà ses profs au lycée. A l’ère du texto et du zapping, cela ne passe plus. Autant n’écrire que pour la secte de plus en plus restreinte des intellos « d’un haut niveau théorique », comme me disait récemment une attachée d’édition. Quel haut niveau théorique ? Je ne crois qu’à la connaissance, pas au jargon qui manipule le savoir. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », disait si justement Nicolas Boileau dans son Art poétique en 1674 ! Le reste est pensée confuse ou cuistrerie.
Arthur D. Little se veut plutôt décalé, un peu à l’écart du monde. Il écrit pour l’abstraction qu’est « l’autre », le lecteur anonyme. Puis parfois prend peur de ce qu’il a livré, et efface, supprime et se retire. Il angoisse parce qu’il a mal au siècle et ne connait pas le diagnostic. D’où ses explorations d’auteurs, ses plongées dans la psyché, son analyse de la « barbarie désirante », puis ses découragements successifs : « Il m’arrive de me dire que je vais tout arrêter, qu’écrire ne sert à rien, que ce blog lui-même n’a pas de validité étant donné qu’il n’est lu que par le cercle restreint… »
Va-t-il revenir ? Son regard manque, le lien s’est distendu mais il subsiste.



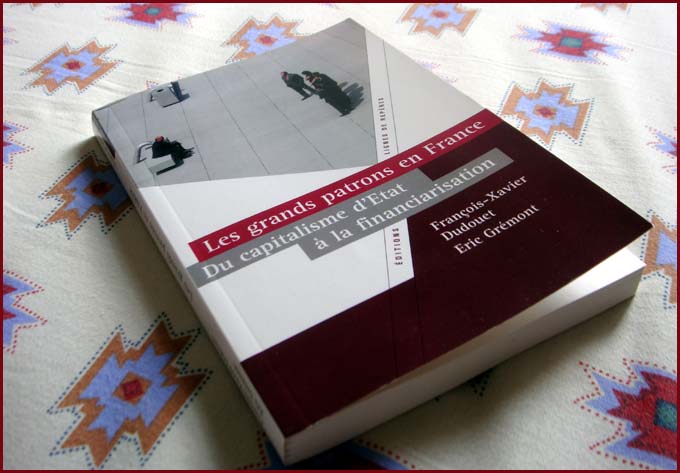
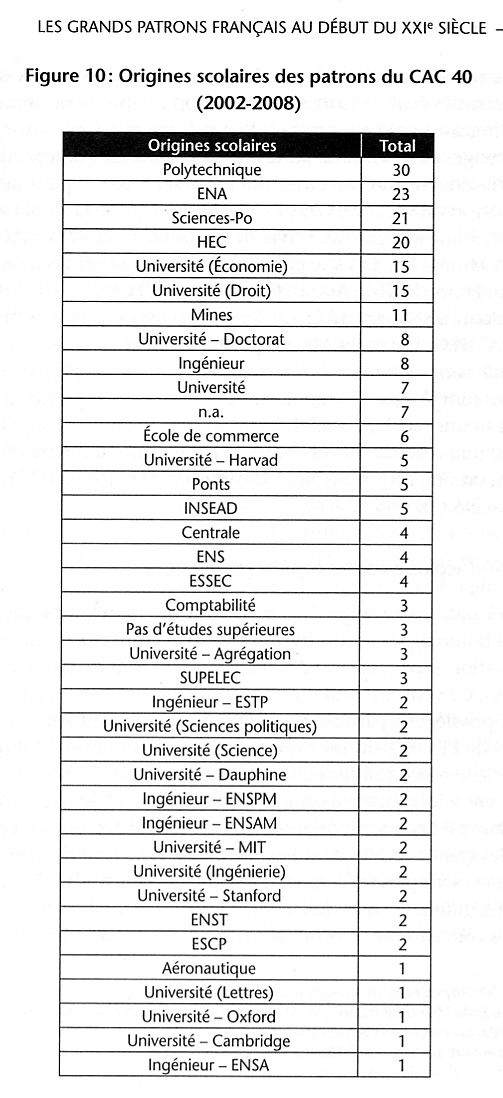
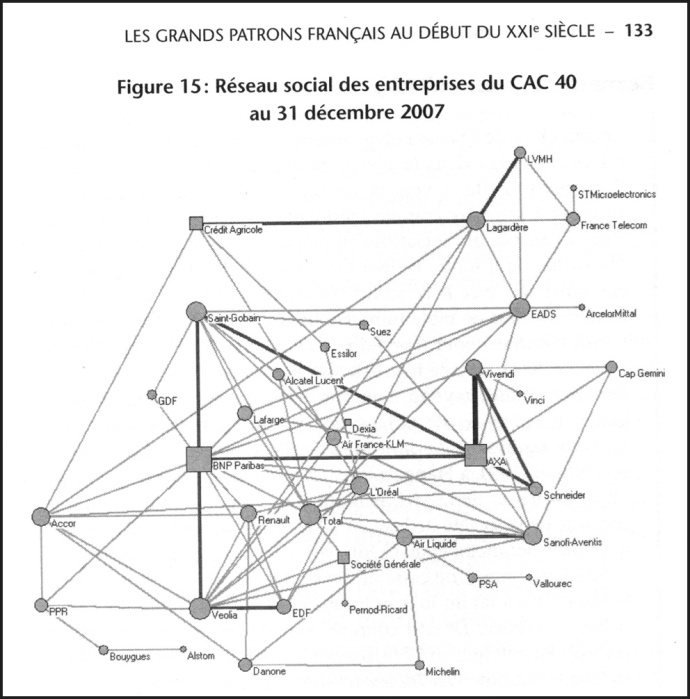
Commentaires récents