Les gilets jaunes veulent exister, se faire reconnaître comme l’œil du cyclone social. L’Europe centrale et orientale veut exister, se faire reconnaître comme un réservoir de la biodiversité blanche préservée. Le Royaume-Uni veut exister, se faire reconnaître comme Etat souverain, lié par rien ou en bilatéral volontaire et provisoire. Est-ce là l’identité que chacun cherche confusément ?
La France est dans l’histoire une mosaïque de régions et d’ethnies rassemblée autoritairement sous la houlette d’un roi parisien. Colonisée (un peu) par les Grecs un millénaire avant notre ère et ouvrant les Celtes au commerce méditerranéen, la France a été romanisée par le sud, puis entièrement sous César faute d’union des Gaules, avant que les « barbares » venus de Germanie ne l’aient franchement conquise. Les Ottomans ont isolé l’empire romain d’Orient, aujourd’hui la Turquie et une grande part des Balkans ; les Mongols ont isolé la Russie ; les Arabes ont isolé le Maghreb autrefois romain. Ces invasions forment les limites de l’Europe au sud, au sud-est et à l’est. La France se situe au carrefour des Germains et des Latins.
Pays catholique qui a choisi le pape alors que la périphérie choisissait de protester, roi absolu qui se prenait pour l’Etat et a révoqué un édit de tolérance pour chasser les forces vives proto-industrielles du pays, révolution qui a essaimé les Lumières mais accouché d’un esprit militaire et d’une bureaucratie jacobine centralisée pour laquelle l’impôt est l’alpha et l’omega plutôt que la prospérité – la France s’est trouvée fort dépourvue au siècle des nationalités. Elle était trop composite elle-même, parlant plusieurs langues en son sein appelées dérisoirement « patois », pour être une nation comme les pays autour d’elle. Ce pourquoi elle a choisi « l’universel », orgueil romain, héritage catholique, mission des Lumières, fantasme communiste. Le retour de l’identité la gêne, l’irrite, la déstabilise. C’est pourtant ce que réclament les gilets jaunes tout comme ceux qui votent Rassemblement national, soit une bonne moitié de la population qui s’exprime dans les urnes.
Déstabilisés dans un monde en mutation, envahis par des cultures étrangères où la religion se confond avec les mœurs et la politique, en prise à la délinquance comme au terrorisme des mêmes, déchu d’industries par la mondialisation et la prédation américaine qui « juge » extra-territorialement à coup de milliards que sa loi est la seule à s’appliquer au monde entier, colonisé mentalement par la loi des séries dites « populaires » (dans les faits commerciales), les Français issus du peuple un peu instruit et surtout de province isolée des grands centres, se crispent. Leur économie, leur culture, leurs mœurs foutent le camp et la régulation rampante de non-élus à Bruxelles les dépossèdent de leur destin.
La faiblesse du libéralisme à l’américaine, qui est la mentalité dominante jusque chez les élites européennes, est la lâcheté envers les frontières et la culture des « autres ». L’Amérique s’en foutait puisqu’elle est elle-même un ramassis de rejetés du vieux continent, issue de peuples divers, jusqu’aux esclaves importés d’Afrique. Depuis que la Chine lui taille de sévères croupières économiques et qu’elle défie sa technologie jusque dans sa pointe, l’Amérique se réveille, se crispe sur son statut et élit un populiste à grande gueule : Trump. Et les Anglais font de même avec un Boris (!) Johnson. Dès lors l’Europe, et la France, et les Français perdus, se disent qu’ils seraient bien bêtes de ne pas prendre le même train. L’Europe centrale et orientale trumpettant était inaudible ; elle le devient.
Ces ex-pays de l’Est connaissent un vieillissement de la population, un effondrement de la natalité et une émigration des forces jeunes qui cherchent un avenir meilleur à l’ouest. Leur panique identitaire est une panique démographique plus qu’économique. La nature ayant horreur du vide, et le filet juridique et réglementaire de Bruxelles enserrant ses membres dans un insidieux avenir multiculturel à l’américaine, ceux qui restent à l’Est ont peur d’une déferlante moyen-orientale ou africaine. Ils n’en veulent pas. Un peu ça va, trop, bonjour les dégâts. L’immigration ethnique est comme l’alcool, mieux vaut ne pas en abuser. Le foie distille sa dose, au-delà il cirrhose.
L’Est est encore homogène, l’Ouest déjà multi-ethnique. Ce sont moins les cultures différentes qui posent problème que l’individualisme exacerbé qui encourage l’universalisme du « tout égale tout » et du » tous pareils ». Les pays d’Europe centrale et orientale honnissent le Grand frère (ex-soviétique) mais lorgnent sur la politique à la Poutine : les immigrés, pas de ça chez nous ! L’identité bien assumée passe par le nationalisme et les frontières.
C’est bien ce à quoi aspirent confusément les gilets jaunes comme les extrémistes de droite et de gauche. Le « capitalisme » est l’autre nom, euphémisé, du colonialisme financier (plutôt connnoté « juif » et « anti-palestinien ») comme de l’impérialisme yankee de la marchandise. Dès lors, protectionnisme et nationalisme sont à essayer, croient-ils. Sur le modèle Poutine, Erdogan, Xi Jinping et Trump – entre autres.
Et la gauche inepte, qui devrait faire avancer l’écologie pratique de proximité et le social dans les territoires, entonne toujours la même incantation aux impôts et taxes pour aider les sans-frontières, sans-papiers, sans-abri, sans-ressources venus des pays « en guerre » (depuis Hollande, ne le sommes-nous pas nous aussi, « en guerre » ?). Les sans futur, qui va les aider ?
La tentation est grande de « l’homme » fort (qui peut être une femme au nom belliqueux comme Marine ou Maréchal). Un recours comme Sauveur – et comme d’habitude. Seuls peut-être, les deux Napoléon et De Gaulle ont réussi à changer les choses et à faire émerger un ordre du chaos. Leur image hante les déserts vides de la France périphérique et des acculturés à la violence. Mais les circonstances étaient à chaque fois exceptionnelles et la volonté du collectif alors très grande. C’est loin d’être le cas aujourd’hui où le chacun pour soi et le victimaire agressif sont la seule réaction des egos blessés.
Pour être, il faut d’abord ne pas se faire avoir. Mais encore ? « L’identité » suffit-elle à créer de la culture, de la recherche, des initiatives d’entreprises ? L’entre-soi est-il meilleur en nation qu’en caste sociale ? S’affirmer, certes, mais pour quoi faire ? et pour qui ?


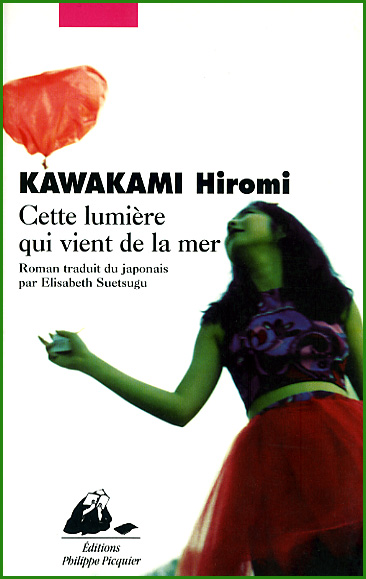

Commentaires récents