L’Amérique se reporte un siècle plus tôt, en 1860, dans la nature vierge des failles du Mississippi proches de la source – et du Canada. Trois cavaliers s’avancent depuis l’horizon dans l’herbe de bison. Ils devisent tranquillement sur la beauté de la contrée et sur la vie qui passe. Le plus vieux est arrivé trente ans plus tôt avec déjà huit mille têtes de bétail et trois mille cinq cents livres dans sa bibliothèque (John McLiam). Le plus jeune, un blond roux de 24 ans à taches de rousseurs nommé Sandy (Hunter von Leer), a été journalier. Dans un bosquet, tout le village semble les attendre, gamins compris. Le vieux demande au jeune s’il doit fouetter son cheval ou s’il l’éperonne lui-même. En un instant, Sandy est pendu haut et court. C’était un petit voleur de chevaux ; le vieux est le plus gros propriétaire de cet endroit sans loi.
La fille du vieux, Jane (Kathleen Lloyd, 28 ans au tournage), quitte la scène ; elle n’apprécie pas cette justice expéditive alors que son père se pique de droit et qu’il possède toute une bibliothèque sur le pénal, dans un pays pionnier où le droit n’a pas encore pénétré. Mais, comme il le dit, il perd « 13% » de bétail chaque année au lieu des 2 ou 3% naturels, cela ne peut durer. Après cette justice privée, rendue en public devant le village avec le « consentement » par omission des fermiers et artisans, il décide d’engager un « régulateur ». Il s’agit d’un tueur à gage qui « régule » les malfrats en les tuant une fois découverts, tout comme les chasseurs « régulent » les populations de loups ou de sangliers.
Ce tueur est Marlon Brando, vieille folle originale, perverse et sans pitié. Affublée d’un blouson à franges sur une chemise blanche, ou d’une tunique noire à col de pasteur, ou encore d’une coiffe de vieille femme comme dans Psychose d’Hitchcock, le tueur solitaire trouve son plaisir dans la traque. Il observe aux jumelles les oiseaux et les gens, interroge ici ou là, « fait parler » ceux qu’il soupçonne, allant jusqu’à les noyer s’ils sont trop bêtes ou ne disent rien. Une fois sa conviction faite, il réalise sa « mission » : nettoyer. Il use pour cela du fusil mythique à longue portée Sharps Creedmore et d’un revolver plaqué d’argent. Maniéré, précieux, affectant (en version originale) l’accent irlandais, parfumé, ce psychopathe probablement homosexuel refoulé prend son plaisir à tuer les jeunes hommes. Notamment lorsqu’ils sont en train de baiser ou de chier, ou à demi-brûlés par ses soins dans l’incendie de leur cabane. Il les tue alors comme des lapins avec un pic de lancer en forme de croix chrétienne tout en chantant doucement « Viande fumée »…
En face de lui le chef du clan des voleurs de chevaux, Jack Nicholson, qui décide pour donner le change d’acheter une vieille ferme à l’abandon juste derrière le ranch du vieux propriétaire pendeur. Il la finance par un hold-up branquignol du wagon postal du petit train asthmatique du lieu. Ce qui était au départ « un relai » pour réunir les chevaux avant de les mener vendre, devient pour lui une sorte de « home » où il prépare le thé « de Chine » et cultive les choux. La fille du vieux est intriguée par ce nouvel arrivant plutôt bel homme viril, et entreprend de le séduire.
C’est casser un peu plus les codes du western classique, habituellement un hymne aux glorieux pionniers installés dans une nature généreuse parmi des animaux et des indigènes hostiles, le Colt dans une main et la Bible dans l’autre. Ici, pas de morale. Le droit est prétexte au propriétaire de ranch pour imposer sa loi, la vieille fille ne pense qu’à perdre sa virginité avec le premier venu non bouseux, la mère de famille qu’à se faire prendre en « cinq minutes, pas plus » par le jeune homme qui a vendu des chevaux à son mari. Ce décalage entre le mythe et la trivialité crue fait peu à peu le charme de ce western au scénario plutôt pauvre.
L’après-68 se moque des convenances et le farfelu côtoie le violent, en rire permet de déchirer les apparences. Le vol de bétail ne mérite pas la mort, mais la bonne conscience mûre pend surtout la jeunesse incontrôlable ; les petits fermiers n’ont pas l’argent pour acheter de la terre, personne ne veut en louer, mais le propriétaire qui a les moyens engage un régulateur de prédateurs qui va tuer sans foi ni loi ; les femmes sont réduites à subir la loi du mâle, père ou mari, mais elles décident d’elles-mêmes de se faire sauter par tout étranger au coin. Car, au fond, le droit est celui du plus fort et la morale celle de la majorité ; elle n’est plus un absolu divin. Jack Nicholson incarne la version positive de ce relatif, Marlon Brando la version négative – mais ils sont tous deux pionniers américains, solitaires et indépendants.
Evidemment le régulateur va descendre tous les membres de la bande ; évidemment le chef de bande devenu fermier va se venger du psychopathe et du pendeur de jeune. Mais il ne restera pas au pays et s’en ira ailleurs, toujours ailleurs, perpétuer l’idéal du pionnier, tandis que la nymphomane qui l’a baisé quittera la cambrousse et vendra ranch et bétail pour la ville, pas plus amoureuse de Jack Nicholson que de ses godemichés.
Le film recèle quelques scènes cocasses, dont celle où la fille se retourne sur la selle et s’enfourche sur le pommeau de la selle que Nicholson a longuement caressé lors de leur première rencontre. Fait-elle semblant ? Son han ! est pourtant révélateur. Il n’y a pas d’amour, seulement du plaisir à deux pour elle, en solitaire pour le régulateur. Les années soixante-dix découvrent l’égoïsme sacré où chacun agit selon ses affaires, homme comme femme, propriétaire comme voleur. Il n’y a pas de héros mais des conditions matérielles et l’astuce de chacun. Cela se passe dans l’ouest, mais ce n’est pas un « western ». Le film en est d’autant plus intéressant, réédité en France cette année.
DVD Missouri Breaks, Arthur Penn, 1976, avec Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid, Kathleen Lloyd, John McLiam, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton, John Ryan, Rimini édition 2019, 2h06, €14.99 blu-ray €19.12

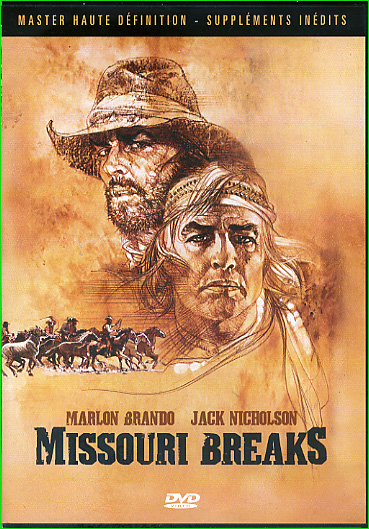





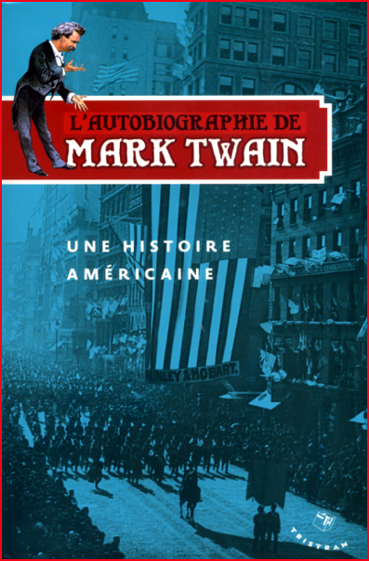


Commentaires récents