Agrégé de philosophie et professeur à la Sorbonne, Marcel Conche fut le maître d’André Comte-Sponville qui le cite plusieurs fois. C’est ainsi que m’est venu le désir de lire ses livres. Celui-ci est très actuel : « la morale se perd » comme dirait la concierge, mais elle n’a pas tort. Notre société ne sait plus très bien où elle en est. D’où l’importance de fonder la morale commune, issue des cultures universelles des Grecs et des Romains, et du christianisme, transmise par la révolution française et les droits de l’Homme.
Fonder la morale, c’est établir le droit de juger moralement, c’est-à-dire de donner valeur humaine universelle aux exigences de la conscience commune. Le fondement n’est pas l’origine, confusion de Nietzsche ; le fondement est « en raison », dans cet absolu qu’est la relation de l’homme à l’homme dans le dialogue. La liberté est le fondement négatif de la morale car elle rend possible l’exigence morale. La méthode donc est celle « du dialogue, la méthode dialectique dans sa forme originelle. Nous n’affirmerons rien d’autre que ce que l’interlocuteur ne peut manquer d’admettre, pourvu seulement qu’il consente à la discussion » p.32. « Ce que nous entendons par dialogue est un échange où le propos de l’un des interlocuteurs est rigoureusement fonction du propos de l’autre » p.34. Chacun présuppose l’autre capable de vérité, c’est-à-dire de dire ce qui est, absolument.
Cela implique la liberté : « quand je dis vrai, je suis libre à l’égard de toute cause de de détermination » p.37. L’égalité de tous les hommes à être capable, par leur raison, de dire la vérité, est un fait universel ; il s’agit d’une égalité de capacité et de droit, une essence (qui n’est ni une « nature » ni une « condition » de chaque homme). « Si le sage est supérieur à l’insensé, c’est en ce sens qu’il est meilleur, plus heureux, plus fort (mais) sur le fond de leur égalité fondamentale » p.46.
Une croyance, une religion ou un système, ne sauraient fonder la morale, qui est universelle – parce qu’eux sont particuliers. « Observons simplement que saint Paul n’est pas un interlocuteur socratiquement valable, car il n’accepte pas de s’en tenir aux vérités impliquées par le fait même d’engager la conversation (ou le dialogue ou la discussion) : il introduit des principes particuliers du bien-fondé desquelles la raison humaine n’est pas seule juge, et dont le sort ne peut se régler par la discussion » p.50. On ne peut que laisser de côté un tel discours qui, ne faisant pas appel à la seule raison, donc à la capacité de chacun de rétorquer, n’a pas de caractère universel. Il est « in–signifiant pour nous, car il n’a de sens que pour les membres d’une secte définie » p.50. L’appel à Dieu, le choc des émotions, la séduction du propos ou la force en guise de légitimité sont tous les moyens du discours pour éviter la vérité, donc pour manipuler les interlocuteurs.
« Chacun pense être, en jugement, aussi bien partagé qu’un autre. Et cela est vrai en droit. En fait, il y a bien des différences, car il y a bien des degrés dans la liberté intérieure et l’indépendance d’esprit. La liberté de jugement n’est possible que par cette énergie intime qui fait le caractère » p.75. Caractère = indépendance d’esprit = regard libre = jugement en raison – tel est l’enchaînement. Cette volonté, issue d’une énergie intime, est à l’origine du « devoir de se rendre libre à l’égard de tous les facteurs de détermination extérieure à la chose jugée, pour bien en juger » p.75. Ce devoir de liberté est la contrepartie nécessaire du droit à la parole. Ce qui fonde le caractère, selon Sénèque et Montaigne, c’est la mort. Elle rend possible le détachement vis-à-vis de l’éphémère et permet de discerner l’essentiel.
Le discours de sagesse est individualiste ; il s’agit de bien vivre par un équilibre moral de la personne, condition de la pensée droite, du bon exercice de la raison. Cette sagesse est le fondement nécessaire à l’homme, mais elle est insuffisante. Le discours moral s’intéresse aussi aux autres ; il est universaliste. Existe en effet un devoir de substitution « qui nous oblige à parler et à agir pour ceux qui ne le peuvent pas » p.57. Par exemple les enfants. Mais, plus généralement, ma propre dignité est intéressée à la dignité d’autrui. « Je dois ne pas m’abaisser par respect pour moi-même, mais aussi par respect pour tout homme ; et je dois vouloir qu’aucun homme ne s’abaisse non seulement par respect pour sa propre dignité, mais aussi pour la mienne » p.48. Ceci fonde la révolte comme droit. Non comme devoir, celui-ci dépendant des conditions : comme il faut toujours vouloir la victoire, il ne faut pas risquer la destruction s’il n’y a pas de chances raisonnables de succès.
« L’égalité de tous les hommes signifie le droit, pour chaque homme, de devenir et d’être homme à sa façon, conformément à sa nature singulière, donc dans la différence et l’inégalité. Chaque homme a droit à son auto-développement » p.91. Ceci condamne par exemple l’avortement, le fœtus étant humain en puissance (mais tout dépend des normes sociales). Les hommes vivent en société. La conscience morale n’est pas un produit de la nature, elle suppose une éducation, une formation morale. L’éducation a pour but de forger la confiance de l’individu en lui-même, en sa raison et en sa volonté, pour en faire un homme capable de dévoiler et de livrer la vérité. S’établit, dès lors, le principe de l’équivalence des services rendus. « L’individu doit (s’il le peut et dans la mesure où il le peut) rendre à la société l’équivalent de ce qu’il en reçoit, où en a reçu. D’autres ont travaillé, travaillent pour lui ; à lui de travailler pour eux » p.92.
Une action ne se justifie que par le bien qui en résulte : le principe du meilleur est le principe de conduite. Punir, c’est infliger une souffrance, ce qui est mal ; cela ne se justifie que si de ce mal peut sortir quelque bien. Ce pourquoi une grève peut être juste, jusqu’à une limite où elle pénalise l’ensemble de la société et de l’économie. La peine de mort par exemple n’est pas pour cela injustifiée : dans une société où cette peine (civile) a été abolie, l’assassin est privilégié, il peut donner la mort sans risque de mort pour lui-même. Sauf la mort sociale qu’est la prison « à vie » (en fait à pas plus de 30 ans), mais que Marcel Conche n’évoque pas.
Une société égalitaire est morale car elle fait ressortir seulement l’inégalité naturelle. « Les individus, dans les limites définies par un cadre social indépendant de leur volonté, peuvent réaliser ce qu’ils portent en eux » p.93. Il ne saurait y avoir d’injustice de la nature, car la nature n’a aucun devoir envers l’homme ; elle n’est pas un être supérieur, elle est indifférente. C’est à la société de compenser ces inégalités en fonction de sa propre morale.
Chacun a le droit de vouloir vivre – et a le droit de mourir. Mais si ce vouloir vivre n’est pas cause suffisante de vie (le bébé, le blessé, dépendent des soins des autres humains), chacun peut à volonté être cause de sa propre mort. Il faut, pour le justifier, de bonnes raisons – qui seront toujours subjectives. « À chaque moment de la vie, on peut faire un bilan. Le bilan est positif si l’on a le contentement de vivre, l’activité, la maîtrise de soi, une santé point trop détériorée, et la capacité de supporter les tracas habituels de la vie, plus quelques autres. À partir d’un certain moment, ou le déclin devient déchéance, la mort, lucidement choisie, semble préférable au sage » p.106.
Le bonheur est une triple proximité : à la nature, aux autres, à soi-même. « Le sage n’a besoin de rien car il comprend le langage des êtres, du monde, spécialement de la nature, des animaux, des arbres, de l’eau et des éléments ; il en saisit la poésie universelle et il est, en quelque manière, toujours heureux. L’ennui est signe d’inculture » p.117. Ce pourquoi une morale sociale est de développer la culture, ce qui permet d’épanouir la liberté de chacun.
L’amour est ce supplément de bonheur de la présence d’autrui. Cette cordialité, cette sympathie, qui fait que l’on est heureux avec quelqu’un, suppose la capacité de rendre justice, de voir autrui honnêtement, avec ses défauts et ses qualités. Ce que ne permet pas l’amour fusionnel ni la passion aveugle.
À tout cela je souscris même si je suis plus attiré par la sagesse, qui est de la personne, que par la morale, qui est universelle. L’amour des autres, de certains autres, est cependant la médiation de l’une à l’autre.
Marcel Conche, Le fondement de la morale, 1993, PUF 2003, 148 pages, €15.50 e-book Kindle €11.99

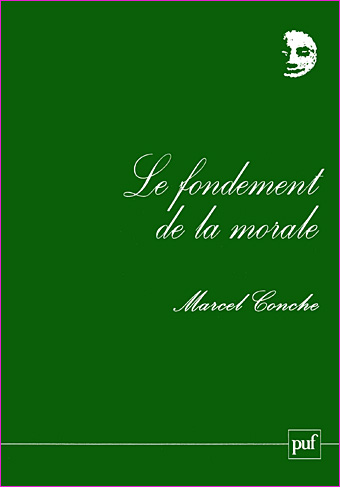
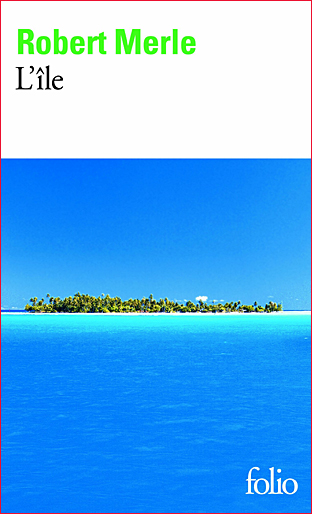

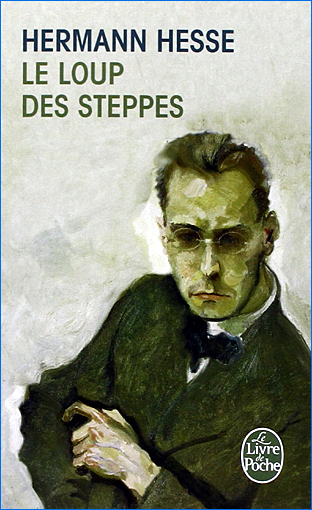
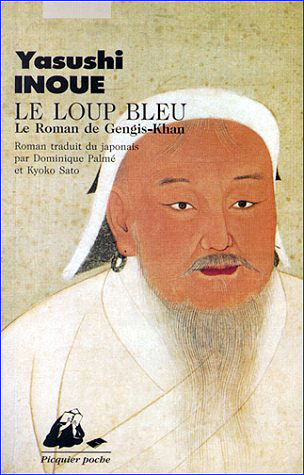
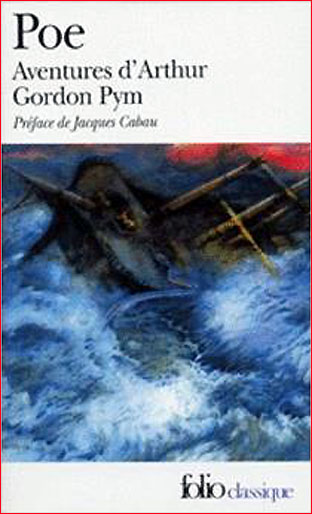


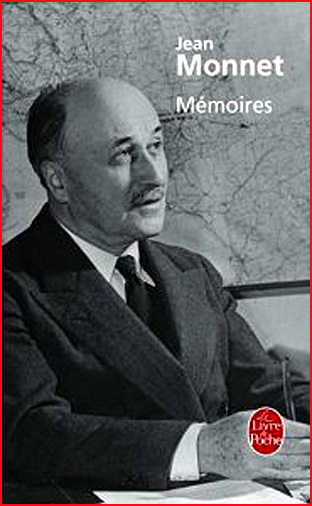

Commentaires récents