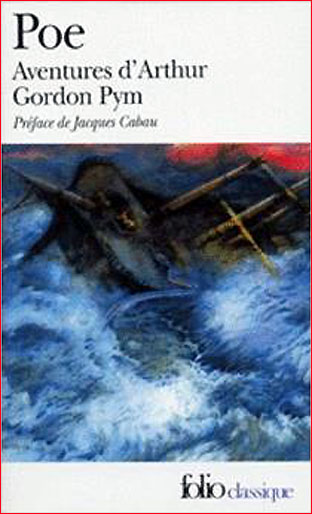
J’ai lu ce livre dans ma prime adolescence. En tant que garçon épris de cartes et d’estampes, il m’a fasciné. Relu récemment dans l’édition Pléiade, mais dans la même traduction littéraire de Charles Baudelaire, j’en ai saisi moins l’aventure que le progressif cheminement vers le fantastique, toujours au bord du monde, là où l’inconnu laisse toute sa place à l’imagination.
Tout commence en effet par deux gamins aventureux (et déjà habitués à l’alcool) : leur périple impromptu en canot durant une nuit où la tempête se lève préfigure ce qui va suivre. Mais les drôles ont un peu plus de seize ans. Ce n’est que vers 18 ans qu’Arthur est embarqué par Augustin, de deux ans son aîné, dans le baleinier de son père, armé pour la pêche hauturière sur plusieurs mois. Arthur n’a rien dit à sa famille, sa mère et son grand-père devenant hystériques à la simple évocation de son désir d’aventures.
L’auteur, né en 1809, a l’âge de son aventurier lorsqu’il écrit le livre, c’est peut-être ce qui le rend si réaliste ; l’âme d’un jeune homme est bien rendue dans sa curiosité insatiable, sa fièvre d’action et son imagination sans limites, au bord de l’affolement.
Tout commence pour Arthur par un enfermement dans la cale, pour contrer son débarquement possible s’il est découvert trop tôt, claustration qui se prolonge mystérieusement, jusqu’aux affres de la faim et de la soif, parce que le navire a été pris par une part de l’équipage qui veut se faire pirate. Le massacre des matelots restés dans le droit chemin n’est que la première étape horrifique de la rude vie adulte que les ados sont avides de connaître bien trop tôt. Ils vont être servis !
Après s’être battus avec les mutins qui restaient et leur avoir fendu le crâne, les deux compères aidés de deux marins fidèles qui ont feint d’être du côté des apprentis pirates, jettent par-dessus bord les barbares qui n’avaient eu aucune pitié pour la vie humaine. Ils sont pris par une violente tempête, le brick est démâté, les cales remplies d’eau. Les quatre survivants se sont attachés sur le pont, trempés et affamés plusieurs jours avant d’ôter leur chemise pour se sécher un peu et plonger par l’écoutille pour tenter de trouver à manger.
Un navire vient droit sur eux ; ils se croient sauvés par la Providence (ce hasard dont l’espérance et l’imagination font une volonté) mais le navire n’est peuplé de que morts d’empoisonnement ou d’une brutale maladie, le seul qui semble bouger étant dévoré par une mouette. Un autre navire passera sans les voir. Il faut donc tirer à la courte-paille pour savoir qui sera mangé. Le sort ne tombe pas sur le plus jeune mais (justice immanente), sur celui qui avait proposé le cannibalisme. Il est promptement expédié, découpé et avalé – sans plus d’état d’âme, nécessité oblige.
Mais le sort ne leur est pas plus favorable : Auguste, blessé par un mutin, est rongé par la gangrène et finit par mourir ; les requins se repaissent de son cadavre dans d’horribles craquements. Arthur l’adolescent découvre alors ce que peut devenir un homme dans les situations extrêmes.
Le bateau ne résiste pas à un autre coup de vent et se retourne, quille en l’air, le lest mal amarré ayant bougé dans la cale. Il ne reste que deux survivants : l’inoxydable Arthur, qui a une fois de plus ôté sa chemise, et Peters, Indien à demi-sensé. Ils sont recueillis in extremis par une goélette qui part explorer le pôle sud en attrapant au passage quelques fourrures. Ils ont l’occasion de se refaire un peu et visitent plusieurs îles australes au paysage désolé avant de se laisser faire par un courant marin qui les conduit plein sud. Cette transition de fausse sécurité amène peu à peu Arthur, comme le lecteur qui s’identifie volontiers à lui, à cheminer vers le légendaire et le maléfique : toute couleur s’estompe, toute humanité régresse, toute vie se fait plus cruelle.
La glace qui s’amoncelle fait soudain place à une étendue d’eau libre et l’atmosphère se réchauffe. C’est alors que surgissent les îles imaginaires dans l’inexploré humain. Rien de paradisiaque malgré les apparences ; même l’eau est gélatineuse. Leurs habitants sont noirs, vaguement descendants des Éthiopiens de la Bible ; ils sont rusés et nourrissent de mauvais desseins. Mais ils savent endormir la méfiance et c’est par miracle (ou plutôt par la curiosité sans cesse en éveil d’Arthur qui voulait explorer une faille de la passe) que le garçon et Peters échappent à l’ensevelissement vivant de l’équipage en marche vers la fête d’adieux, à la prise d’assaut du navire à l’ancre et à l’explosion de la cale.
Ils ne doivent qu’à leur astuce, à leur courage et à leur détermination brutale d’échapper à la horde qui se rue sur eux. Ils volent un canot, détruisent le seul autre disponible, et voguent à force de pagaie. Arthur ne tarde pas à se mettre torse nu – comme chaque fois que le danger presse – pour faire de sa chemise une voile. Cette sensualité un peu masochiste envers sa jeune chair d’apparence vulnérable décrit assez bien les affres des hormones chez les adolescents tourmentés par l’aventure. Arthur semble jouir des épreuves qui le trempent, l’assomment, le meurtrissent, le noient, l’ensevelissent ou l’affament. Ce plaisir pris par le corps dans l’action virile n’est pas pour rien dans l’étrange charme du livre chez les adolescents garçons. Les filles y sont peut-être moins sensibles, mais je n’ai pas d’exemple récent.
Le courant vers le sud emporte le canot tandis que la chaleur de l’air augmente, jusqu’à une brume qui voile l’horizon. C’est alors qu’est évoqué un « Géant blanc » avant que le carnet ne s’interrompe brutalement. Arthur s’échappe de ce pôle sud maléfique mais il n’en dira rien. Tout d’abord parce qu’on ne le croira pas, dit-il à l’éditeur, puis parce qu’il meurt dix ans plus tard sans qu’on sache comment, mais sans avoir achevé le manuscrit de son histoire. C’est du moins ce que l’auteur nous dit.
Devenu sans doute adulte à 29 ans en 1838, date où paraît le roman, il passe à autre chose, ces Histoires extraordinaires où l’imagination se débride mais avec plus de maturité. Jules Verne donnera une « suite » à l’aventure d’Arthur Gordon Pym dans Le sphinx des glaces.
Voici un bon roman de marine ancien mais éternel, empli d’aventures, de courage et d’imagination, analogue à L’île au trésor de Stevenson, à Deux ans de vacances de Jules Verne, et à Moby Dick de Melville. Tous ces romans répondent à la passion adolescente pour l’action et sont à mettre entre toutes les mains dès l’âge de 10 ans.
Edgar Allan Poe, Aventures d’Arthur Gordon Pym, 1838, traduites par Charles Baudelaire, Folio classiques 1975, 305 pages, €7.90
Edgar Allan Poe, Œuvres en prose traduites par Charles Baudelaire, Gallimard Pléiade 1951, 1165 pages, €46.70






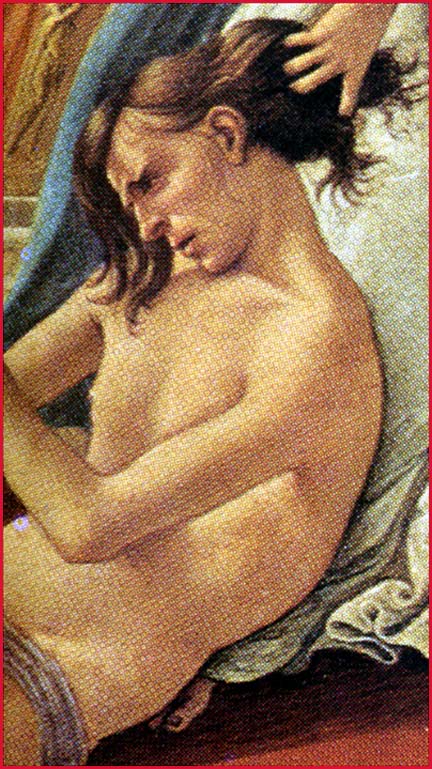



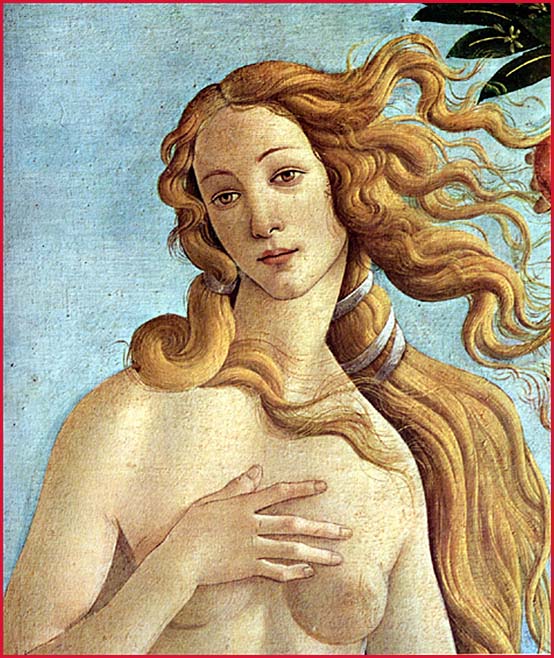
Commentaires récents