 L’année de son Nobel, Le Clézio publie un roman bien dans le ton d’époque. Sa popularité tient à ce qu’il reprend les modes sentimentales pour les traduire en littérature. Dans les années 60, il évoquait l’absurde et la schizophrénie (Le Procès-verbal, 1963) ; dans les années 70 la sensualité et le soleil (Mondo et autres histoires, 1978) ; dans les années 80 l’exotisme de l’ailleurs (Le Chercheur d’or, 1985) ; dans les années 90 les rêves oubliés (Diego et Frida, 1993 ; Gens des nuages, 1997). Dans les années 2000 il revient sur le passé, sur sa famille. ‘L’Africain (2004) évoque son père, docteur de brousse. ‘Ritournelle de la faim’ redonne vie à sa mère et sa jeunesse parisienne. L’écrivain a suivi son temps et en a épousé les lubies. L’aujourd’hui vieillit, s’accroche à son « patrimoine » et valorise son « identité ». Foin de l’ailleurs et du jeune : retour sur soi et ses petits secrets.
L’année de son Nobel, Le Clézio publie un roman bien dans le ton d’époque. Sa popularité tient à ce qu’il reprend les modes sentimentales pour les traduire en littérature. Dans les années 60, il évoquait l’absurde et la schizophrénie (Le Procès-verbal, 1963) ; dans les années 70 la sensualité et le soleil (Mondo et autres histoires, 1978) ; dans les années 80 l’exotisme de l’ailleurs (Le Chercheur d’or, 1985) ; dans les années 90 les rêves oubliés (Diego et Frida, 1993 ; Gens des nuages, 1997). Dans les années 2000 il revient sur le passé, sur sa famille. ‘L’Africain (2004) évoque son père, docteur de brousse. ‘Ritournelle de la faim’ redonne vie à sa mère et sa jeunesse parisienne. L’écrivain a suivi son temps et en a épousé les lubies. L’aujourd’hui vieillit, s’accroche à son « patrimoine » et valorise son « identité ». Foin de l’ailleurs et du jeune : retour sur soi et ses petits secrets.
Mais il s’agit d’un roman, pas d’une biographie. La littérature transpose un destin dans une époque pour en faire ressortir la petite musique. Cette musique du XXe siècle, ce fut la faim. Celle provoquée par la crise de 1929 puis par la guerre de 1940, qui a poussé nombre de gens à manger des épluchures, des racines, des fruits talés, des rognures, des légumes laissés sur le marché. Non sans une certaine dose de démagogie, l’auteur se souvient avoir été lui-même affamé… mais il n’avait que cinq ans en 1945. L’enfance est toute sensation et désirs, et sa faim lui est consubstantielle, même dans l’opulence. Rendons plutôt justice à l’auteur de son empathie et de sa capacité à puiser en lui-même ce que ressentent et ce qui pousse ses personnages.
Car la faim est de façon plus vaste une soif de vivre : dans l’amour, dans le faste, dans le rêve. Le concret s’efface bien souvent sous le poids des chimères.
Dans les allées de l’Exposition coloniale, Ethel à dix ans épouse la volonté de son grand-oncle Soliman. Il a l’utopie de racheter le pavillon de l’Inde pour le mettre sur un terrain dans Paris. Rêve qui se heurtera aux récriminations du petit propriétaire voisin, à l’âge inexorable qui terrasse l’oncle, à la captation d’héritage du père flambeur, aux goûts très moyens des architectes d’immeubles, à la crise économique et au blocage des loyers qui obligent à vendre…
L’amour est-il une faim plus facile à apaiser parce que très personnelle ? Pas sûr. Ethel découvre l’amitié particulière avec Xenia Chavirov, Russe émigrée d’une famille de comtes ruinés et chassés par la Révolution. Fantasque, fêtarde, impulsive, Xenia est celle à qui l’on confie son épaule tendrement. Mais les amours lesbiens sont mal vus de cette France aigrie à l’esprit étroit et ils s’évanouissent avec l’adolescence. C’est alors un jeune homme roux, anglais, qui vient combler cette moitié de soi perdue. Mais il s’agit d’amour des sens, puis d’amour de raison ; la passion y est fort tiède. Matière et société, là encore, sont plus fortes que les songes.
Le père d’Ethel est originaire de cette île Maurice, définie par Soliman d’une formule lapidaire : « petit pays, petites gens ». Transposée à Paris, cette société îlienne est perdue par les paillettes d’une ville laborieuse, égoïste et près de ses sous. Dans les salons de la rue du Cotentin, des margoulins font miroiter des placements mirobolants, des idéologues encensent Monsieur Hitler et voient dans l’antisémitisme montant le remède à leur perte de supériorité. Tous seront balayés par l’armée allemande lorsqu’elle envahira Paris, puis par les Résistants lorsqu’ils libèreront le pays. La triche avec le rêve ne paie jamais. Le Clézio note à la Flaubert ces fragments d’« idées reçues » entendues dans les salons d’époque : « l’or s’en va quand Blum arrive… Hitler l’a dit lui-même, le peuple est avec moi parce qu’il sait que je m’occupe bien de ses besoins, que c’est son âme qui m’intéresse… » Au fond, les parents d’Ethel (les grands-parents de l’auteur) apparaissent comme immatures. La longue lignée d’héritages de cette noblesse mauricienne est ruinée dans un Paris tourbillonnant.
Le Clézio n’aime pas Paris, il reste « entre culpabilité et méfiance ». La visite à l’Exposition, la mort de l’oncle, les marches avec Xénia, la visite au notaire, c’est toujours de la pluie à Paris. « La rue très grise, du gris de Paris quand il pleut, un gris qui envahit tout et entre au fond de vous jusqu’à en pleurer » (p.28). Le soleil est pâle comme un cachet d’aspirine. Le Clézio, solaire, préfère le soleil niçois et celui de l’ailleurs.
Car c’est à Nice où la fuite famille ruinée se réfugie sous l’Occupation allemande. Une ville où l’on a faim, une ville sous couvre-feu, mais où il y a ce rêve d’infini dû au soleil et à la mer. Dans le roman, Ethel finit par épouser Laurent après guerre, alors que l’auteur est né en 1940. S’invente-t-il une grand-mère juive par empathie ? Il dote Laurent Feld – son père romancé – d’une mère raflée au Vel’ d’Hiv’ et perdue à Drancy. Ce pourquoi il déambule sur les lieux aujourd’hui, et découvre un square parisien, la « Plate-Forme », où des gamins arabes jouent au pied des tours… Le seul souvenir des années noires est le musée photographique qui jouxte la synagogue. « C’est vertigineux, nauséeux » (p.203).
Mais à quoi bon ressasser sans cesses ces souvenirs ? N’est-ce pas l’avenir qui compte plus que le passé ? Seuls les vieux vivent dans l’hier. Leur décrépitude fait qu’ils s’économisent : ils n’ont plus « faim ». La vie est plutôt attente, désir d’avenir, de famille et d’enfant, de bâtir une maison à soi, d’entreprendre et de créer une œuvre. Le drame juif du Vel d’Hiv’ n’est-il pas né de ce vide français d’entre deux guerres ? Le déclassement dû à la crise économique, la poussée du Front populaire dans la lignée de la révolution russe, l’affirmation de la force brute en Italie et en Allemagne, l’indigence intellectuelle des écrivains, presque tous partisans d’Action française ou du Parti communiste, l’affairisme et l’égoïsme qui éloignent les amis et les amours… Ravel l’avait pressenti : « Le Boléro n’est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l’histoire d’une colère, d’une faim. Quand il s’achève dans la violence, le silence qui s’ensuit est terrible pour les survivants étourdis » (p.205).
En épigraphe de son livre, Jean-Marie Gustave Le Clézio évoque Rimbaud, « Fêtes de la faim » et sa ritournelle : « Si j’ai du goût, ce n’est guères/Que pour la terre et les pierres (…) Mes faims, tournez. » Tous les mensonges d’une époque ne peuvent rassasier la faim qui est au fond de soi. Celle que Nietzsche appelle la volonté de puissance et qui est la vie, la poussée de vie qui, telle le lotus, s’extrait de la boue pour émerger à la lumière. A chacun de faire son trou.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ritournelle de la faim, 2008, Folio 2010, 206 pages, 5.41€
Les livres de Le Clézio chroniqués sur ce blog












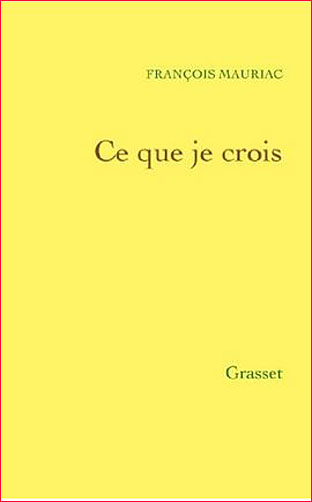




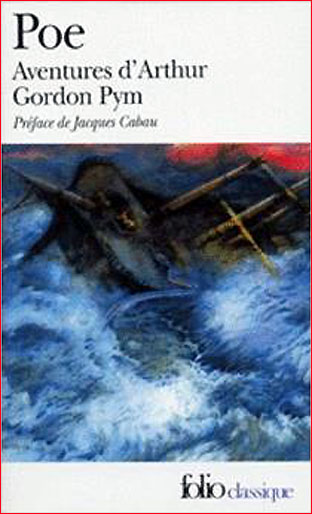







Commentaires récents