Cette chronique impressionniste des 11-13 ans de l’auteur dans le Japon des années 1918-1920 a un timbre universel. Elle conte la fin d’enfance, le passage vers l’adolescence, les dernières années d’insouciance de la vie au village, dans cette campagne japonaise très peuplée où oncles, grands-parents et cousins ne sont jamais éloignés que d’une demi-journée de marche.
Kôsaku est la suite de Shirobamba, vie quotidienne sur le même ton de ses 6 à 9 ans. Le gamin vit avec une ancienne concubine de son arrière-grand-père, la vieille Onui dont c’est la fin. Elle attendra cependant l’entrée au collège de la ville de son petit Kôsaku, élevé par elle depuis l’âge de 5 ans, pour quitter cette vie.
Car le récit est tout teinté d’amour, ce qui lui donne sa mélancolie mais aussi ce regard aigu de la mémoire qui revient vers la préadolescence. Jamais peut-être les émotions ne sont aussi fortes que vers 12 ans, juste avant de devenir pubère et que le regard des autres sur vous ne change. L’empreinte des êtres et des événements se garde la vie entière et, passée la cinquantaine, l’auteur s’en souvient toujours avec force.
Il fait de Kôsaku un garçon de littérature, parlant de lui à la troisième personne comme s’il était autre que lui-même. Mais cette distance permet de tenir les émotions contenues et de maintenir le récit sur le ton de la constatation. C’est ce qui fait le charme puissant du livre et lui donne cet aspect universel.
Kôsaku vit seul avec celle qu’il appelle sa « grand-mère », en face de ses autres grands-parents du côté maternel. Il est entouré par un oncle directeur d’école et par d’autres parents qu’il va voir pour bronzer à la mer ou pour découvrir la culture du champignon shiitake.
Mais tout fait événement au village où chacun participe à la vie de tous les autres. La moitié des habitants est là pour accueillir le nouveau directeur des Eaux et forêts – et ses deux enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 12 ; tout le village viendra saluer le départ de Kôsaku et de sa mère vers la ville à la fin. La création d’une ligne d’autocars, en place du vieux cheval à carriole, est l’occasion de débats épiques entre modernistes et conservateurs, mais beaucoup de gens se rendent chaque jour à l’arrivée du car. La survenue d’un typhon, comme chaque année, est l’occasion d’aller en pleine nuit chez les uns et les autres pour voir s’ils sont inondés ou si leur toit a été arraché.
Kôsaku et son copain Yukio d’un an plus jeune, sont inséparables. Ils jouent ensemble, se baignent en semble tout nu, vont explorer les endroits mystérieux. Ainsi lorsque Kôsaku, égaré près du cimetière à l’écart du village, aperçoit entre les bambous un couple s’embrasser avec fougue, il croit que l’homme est en train d’étrangler la femme et s’enfuit ! Il faut qu’il revienne entouré de ses copains, pour s’apercevoir qu’il n’y a pas eu meurtre. Mystères des adultes…
Étrangeté des filles aussi. Elles sont moins familières à mesure que les années passent, et semblent faire la tête sans aucune raison ; ou elles se montrent aimables sans que l’on sache pourquoi lorsqu’on est un garçon. Ainsi d’Akiko, un an plus âgée, fille du directeur des Eaux et forêt, qui va faire alterner soleil et nuages dans ses relations avec Kôsaku durant toute la longueur du livre. C’est qu’elle devient femme et que les femmes ne traitent pas les garçons comme des gamins. Ceux-ci sentent parfois une boule dans leur ventre, ils se demandent pourquoi.
Non, la vie à la campagne, immergé dans le spectacle de la nature, ne rend pas plus mûr sur la sexualité. Les gamins ne voient aucun rapport entre deux animaux qui s’accouplent et deux humains. Ils vivent dans l’exemple ambiant et la sexualité est, comme dans toute société, une intimité. D’où ce sentiment d’étrangeté vis-à-vis du sexe opposé, cet étonnement au bain lorsqu’ils veulent, comme avant, aller tout nu du côté des femmes.
Le garçon se sent appelé à une existence moins terre à terre que celle du fils du marchand de saké ou de celui qui veut devenir quincailler. Ce pourquoi il s’isole chaque jour pour étudier, malgré les appels des amis et des petits pour venir jouer après l’école. Où l’on constate que l’obsession d’apprendre et de s’élever au Japon ne date pas d’hier. Le début du XXe siècle connaissait déjà la compétition, cette saine émulation qui poussait les campagnards à passer le concours d’entrée au collège pour entrer en sixième.
Sa jeune tante décédée dans le précédent récit lui avait fait promettre, la grand-mère Onui lui fait promettre aussi, tout comme son oncle inflexible Ishimori, le psychorigide directeur d’école désormais en retraite. Kôsaku étudie avec un instituteur qui prépare les examens pour devenir professeur – et en devient fou tant la pression est grande. Mais lui, Kôsaku, veut réussir ; il sent confusément que tout ce qui l’habite ne peut tenir sur ces quelques hectares de territoire rural. Il lui faut aller à la ville, vivre avec ses parents, aller au collège.
C’est le grand art de l’auteur de nous montrer que tout vient naturellement, au fil des saisons, avec la progressive maturité. Le village était un paradis enfantin, il devient trop étroit pour la préadolescence puisque le garçon ne cesse de voyager vers la mer ou à la ville ; il faut désormais le quitter, sans regret, même si c’est avec mélancolie.
Toute l’acceptation de la vie qui va, l’adaptation japonaise au présent sans jamais renier l’hier, est dans ces quelques pages finales où le départ prend la couleur de l’hiver – cette saison qui prépare le prochain printemps.
Yasushi Inoué, Kôsaku, 1960, Folio 2011, 223 pages, €6.50
Les œuvres de Yasushi Inoué chroniquées sur ce blog

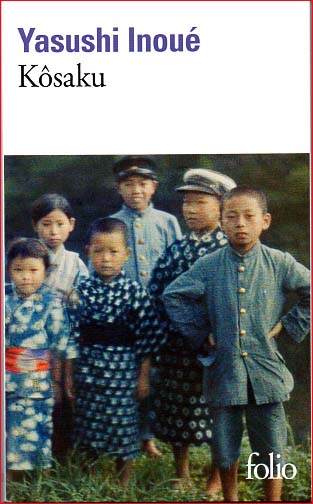


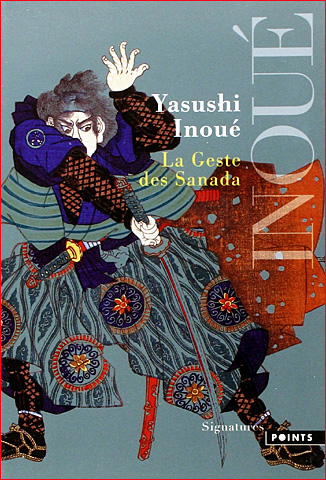
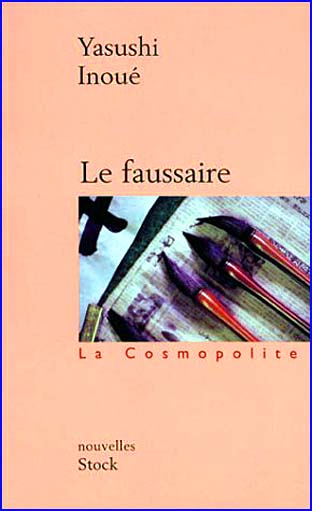
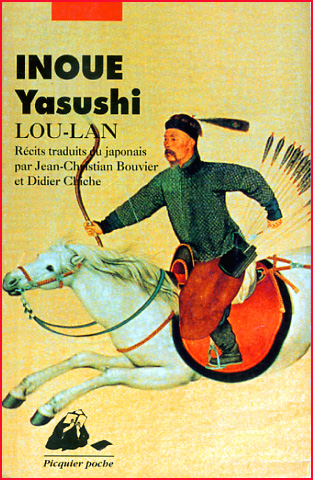
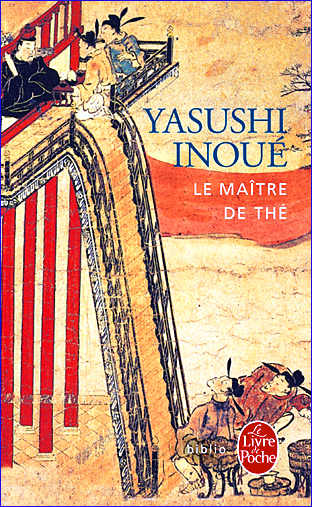


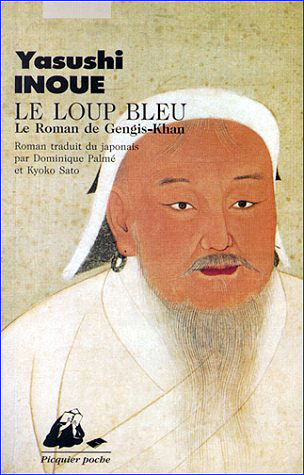
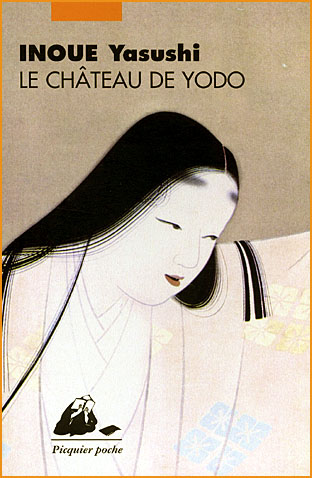

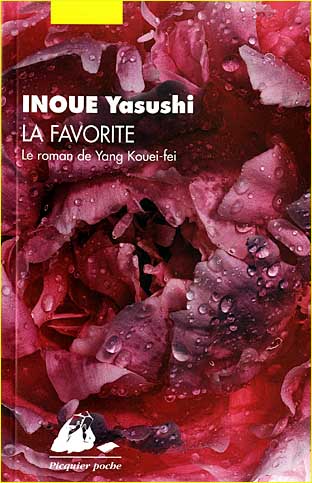
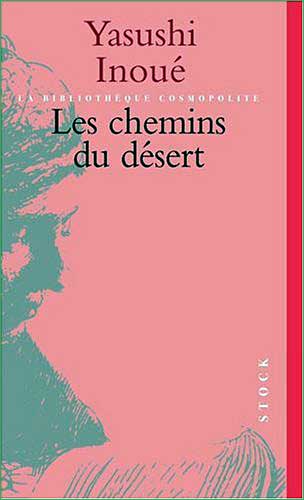

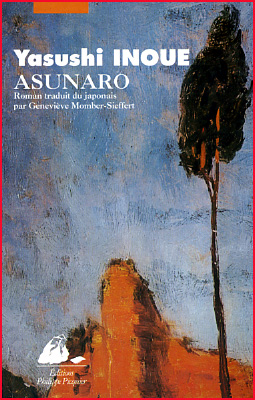



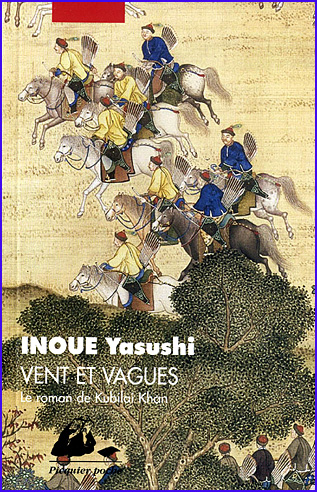
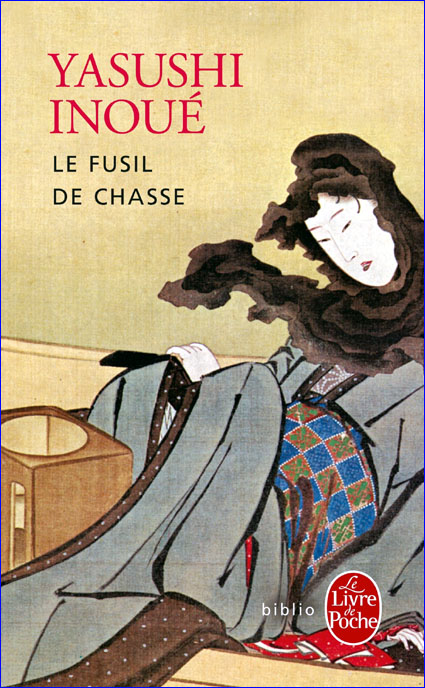
Commentaires récents