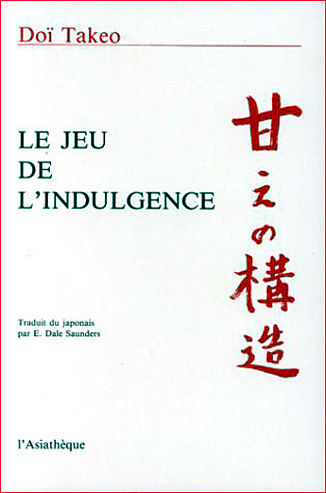
Cette étude, parue en 1981 au Japon, a été rapidement traduite en France, l’engouement pour les japonais étant avéré dans notre pays vers cette époque.
Elle explique la dépendance affective du Japonais (amae) par l’emprise de la mère, hégémonique sur l’enfant et surtout le garçon. Comme le père est très souvent absent, gros travailleur obligé aux heures supplémentaires, aux vacances réduites et au bar avec ses collègues après bureau, c’est la mère (qui souvent ne travaille pas) qui s’occupe des enfants. Le garçon est surprotégé au Japon, comme dans toute l’Asie d’ailleurs, où il est censé assurer les vieux jours de ses géniteurs en l’absence d’un régime décent de retraite (même si les choses ont changé, les mœurs demeurent). D’où son anxiété de la séparation, son infantilisme chronique et son « machisme » qui est surtout une attente que la femme le serve comme l’a servi sa mère.
Toujours en « attente d’indulgence », le Japonais donne du respect en contrepartie d’un statut sécurisant. Les sentiments humains naturels (ninjo) se complètent par les devoirs appris par l’éducation (giri), tandis que « les autres » (les humains sans obligations réciproques) sont indifférents et font l’objet d’un comportement non réglementé (enryo).
« Le sens de la honte, qui porte avec soi une impression d’imperfection, d’inaptitude, d’insuffisance de sa propre personne, est plus fondamental. Celui qui éprouve de la honte doit nécessairement souffrir de l’impression de se trouver frustré dans son désir d’amae, exposé aux regards d’autrui. » (p.46) Être reconnu, surtout par son groupe de pairs, est vital pour un Japonais. Être rejeté est la honte suprême, la dévalorisation de soi qui conduit soit au suicide, soit à l’exil, soit au repli otaku. Voir le beau roman de Haruki Murakami, L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, chroniqué sur ce blog.
Les pathologies d’amae sont, selon Takeo Doï, l’obsession, l’hystérie, la crainte des autres (extérieurs au groupe), le perfectionnisme, les sentiments homo-affectifs (voir la nouvelle intitulée Kokoro de Natsume Soseki), l’apitoiement sur les héros défaits, le sentiment d’être une perpétuelle victime, l’absence du moi sans le groupe. Le perfectionnisme et l’obsession sont des comportements qui frappent tout visiteur étranger dès ses premiers jours au Japon : pour le meilleur (le sens du service et la qualité des objets manufacturés) et pour le pire (se déchausser, se rechausser parfois six à huit fois sur quelques mètres).
Bien que, depuis l’écriture de Takeo Doï, la société ait quelque peu changé… La responsabilité légale n’a-t-elle pas été abaissée à 14 ans en 2000, signe que l’individualité progresse dans la jeunesse même ? En revanche, s’il faut avoir 18 ans pour devenir militaire, il faut encore attendre 20 ans pour voter !
La perméabilité du sujet est manifeste dans la langue, où le « je » est remplacé par un présentatif qui varie suivant l’interlocuteur et la situation. Cette absence d’affirmation du soi serait le fondement du besoin d’harmonie et de consensus. L’individu japonais se veut compulsivement dans l’ambiance, ne pas dissoner de la note commune. D’où son conformisme, mais aussi son confort social. Être « mignon » ou « sportif » est, pour le garçon, ressembler à l’image valorisée par les filles et par les autres garçons. L’apparence a au Japon un autre ressort que le narcissisme, pathologie de l’individualisme des Peter Pan infantiles fabriqués chez nous en série par les parents névrosés et démissionnaires de la génération 68.
D’où aussi, au Japon, cet empire des signes et des rites, valeurs sûres car elles rendent les comportements prévisibles. Les Japonais vivent volontiers sous l’emprise des masques, reflets, ombres, surface, rôles, « face » – bien loin de la lourde (et parfois pesante) franchise américaine.
Les temples shinto contiennent, à l’intérieur, un miroir… où chacun contemple ce qu’il veut : soi-même, son moi idéal, le dieu. Dans un flou artistique et métaphysique soigneusement préservé.
Complémentaire de l’étude américaine Le chrysanthème et le sabre, deRuth Benedict, le livre de Takeo Doï offre une compréhension en profondeur du Japonais moyen.
Takeo Doi, Le jeu de l’indulgence – étude de psychologie sur le concept d’amae, L’Asiathèque 1991, 134 pages, €18.50



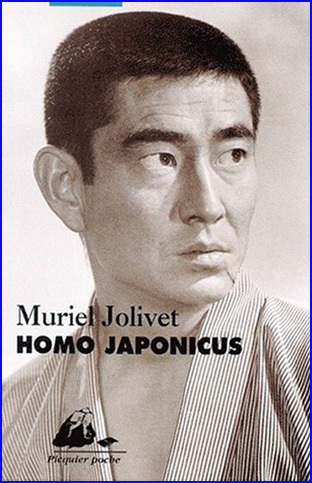


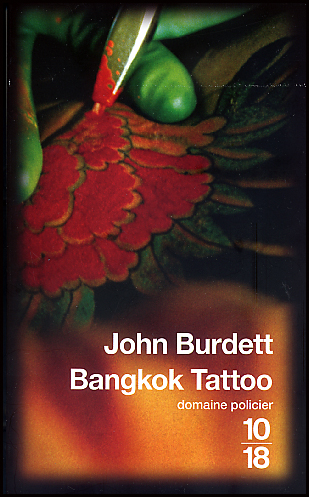

Commentaires récents