
La Direction générale de la sécurité extérieure fait l’objet d’un point d’enquête par un journaliste à Libération puis au Point. Il raboute des articles déjà publiés (et cités) par un liant général, qui est de décrire l’état actuel du service. C’est un peu brouillon, les 16 chapitres comme des dossiers sans ordre, mais nous en savons un peu plus à la fin qu’avant d’ouvrir le livre.
L’image des « espions » a changé en France avec la série bien réalisée du Bureau des légendes. Tout un chapitre lui est consacré en introduction. La réalité ne colle pas tout à fait à la fiction mais elle y ressemble beaucoup, ce qui sert à l’image publique du service comme au recrutement par concours. Ces vingt dernières années ont vu l’essor de la cyberguerre et du renseignement en sources ouvertes sur le net, via des algorithmes. Il a fallu embaucher des matheux, des geeks et des non-militaires. Le plus souvent par des contrats à durée déterminée. Le temps des barbouzes est quasiment révolu et si le Service action subsiste, il entre parfois en concurrence avec le Commandement des opérations spéciales militaire.
Sauf que les civils de la DGSE sont plus flexibles et plus discrets que les militaires du COS et peuvent donc mieux réussir des opérations « noires ». Contrairement aux propos légers et guillerets de Hollande aux deux journalistes, les opérations « homo » (faire tuer une cible) sont rares, et sont plus des actes de guerre militaires (éliminer un dirigeant djihadiste ou terroriste) que politiques. Un président ne devrait pas dire ça, mais le naïf aux quarante gaffes l’a dit. Ce n’est pas rendre service à la France.
Trop rares dans ce livre les opérations décrites en situation, tel le sauvetage (raté) de Denis Allex en Somalie ou l’expulsion (réussie) de faux diplomates chinois en quête de recrues via LinkedIn. L’auteur s’étend sur le juridique, le « droit » de faire, qui serait contraire aux « droits de l’Homme » revendiqués par la France. C’est un faux problème, les opérations extérieures sont des opérations de guerre et justifiées comme telles. Les terroristes ne sont « jugés » que parce qu’on leur fait honneur de les traiter en égaux si on les attrape, et non pas en ennemis ; sur un champ de bataille, ils seraient purement et simplement descendus. Les présidents récents n’ont-il pas parlé « d’actes de guerre » pour les actes terroristes ?
C’est un peu l’avis de « la secte » sécuritaire, comme l’appelle Jean Guisnel, un groupe de diplomates qui, au vu du déclin de leur ministère qui coûte cher, ont investi la DGSE pour être au cœur de l’information, sinon du pouvoir. « Ce groupe s’est barricadé dans les postes essentiels. Il exerce une influence déterminante sur la politique étrangère et la pensée stratégique française », regardant le monde sous l’angle des rapports de force entre États. Le pôle régalien par excellence de la politique et de la Défense est du domaine présidentiel sous la Ve République. « Ils ne sont pourtant ni sectaires, ni conspiratifs, encore moins fermés » p.281. Comme le dit un expert, cité p.282, « ce qui les définit le mieux, outre que ce sont des diplomates, c’est leur belle mécanique intellectuelle, individuelle et collective. Ils n’ont pas de problème avec l’usage de la force armée, ou avec l’application de sanctions économiques féroces. » Ils sont en phase avec notre époque – enfin ! Finie la naïveté idéologique et la guerre en dentelle.
Les valeurs qui animent les quelques 7000 agents de la DGSE, selon une étude commandée pour l’occasion, sont le « secret », la « discrétion » et « l’engagement ». La loyauté est essentielle et l’adaptabilité un signe d’intelligence. Tiens ! Justement le mot qui qualifie les services secrets des pays anglo-saxons est intelligence, eux qui n’ont pas attendu les attentats terroristes, les espions chinois ou la guerre russe pour engager dès l’université les meilleurs élèves. Le renseignement n’est pas l’information, c’est l’intelligence de l’information pour en tirer quelque chose d’utile, notamment « entraver » (selon la formule consacrée dans les textes) les opérations ennemies contre la France.
En bref, ne recherchez pas un journalisme d’action qui relate les hauts faits des « services », mais une étude grand public sur l’organisation, les agents et l’usage d’un tel service « secret » dans la République. Les relations avec les « alliés » américains, les adversaires chinois (plus que russes), la guerre ouverte aux terroristes maghrébins et somaliens, la protection informatique, la place de la France en Afrique, tous ces thèmes sont abordés. Cette histoire n’a rien de « secrète » comme son titre pour faire vendre le laisse croire ; mais elle renseigne sur le renseignement.
Jean Guisnel, Histoire secrète de la DGSE, 2019, J’ai lu 2022, 381 pages, €8,90 e-book Kindle €10,99
DVD Le bureau des légendes saisons 1 à 5, avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Brad Leland, Mathieu Amalric, Jules Sagot, StudioCanal 2020, 43h30, €64,79

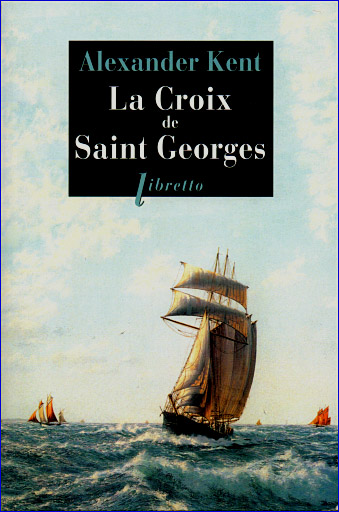
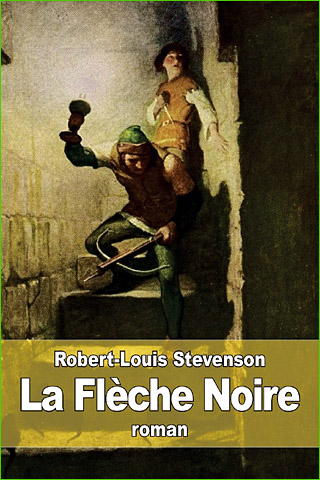


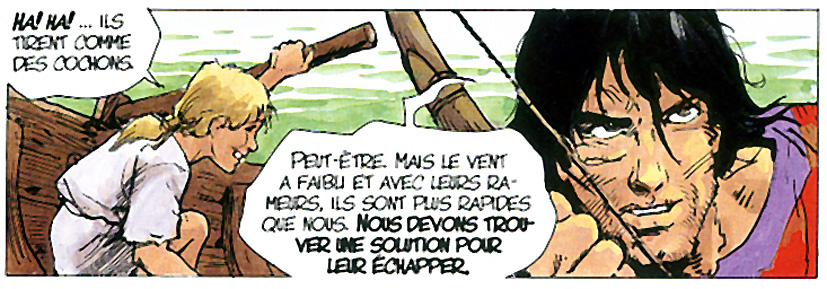







Commentaires récents