
Le crime parfait, ou presque, inspiré du premier roman policier de Patricia Highsmith. Deux inconnus se rencontrent par hasard dans un train ; l’un deux propose d’échanger les crimes : lui tuera la femme de l’autre qui refuse de divorcer et s’envoie en l’air avec le premier venu ; l’autre tuera son père, tyran autoritaire qui veut le faire enfermer, à défaut de travailler. Pas de mobile pour chacun, inconnus de l’entourage, sitôt arrivés sitôt parti – des tueurs sans traces.

Sauf que le plan ne se passe pas comme prévu. Bruno Anthony (Robert Walker), fils unique à maman et gosse de riche, n’est pas net mais un brin psychopathe. La trentaine sonnée, il adore encore mystifier les gens en leur racontant des horreurs, joignant parfois le geste à la parole au point que les vieilles dames emperlousées s’en étranglent. Le jeune et beau tennisman Guy Haines (Farley Granger, 25 ans au tournage), célèbre par les revues de sport, le rend presque jaloux. Il a ce que Bruno ne parvient pas à avoir : un travail dans lequel il est bon, la notoriété, une nouvelle fiancée Anne (Ruth Roman, 28 ans au tournage), fille de sénateur, qui lui a offert un briquet gravé à leurs deux initiales – bien que Guy ne fume quasiment pas. Si Bruno le tente par le meurtre prémédité de sa femme Myriam (Laura Elliott) devenue encombrante et enceinte d’un autre, le jeune Guy agit comme le Christ au désert, il refuse. Mais le diable a mille ruses, dont la première est le fait accompli. Et la seconde la malice : prenant une cigarette, il demande du feu et omet de rendre le briquet.

Même si Haines lui a dit non, interloqué de voir que n’importe qui connaît presque tout de sa vie intime par la presse, Anthony va le faire – et réclamer sa réciproque. La première scène du film où ne sont vues que les chaussures, disent tout des bonshommes : la frime bicolore du raté, les richelieus sobres du jeune homme bien dans sa peau. C’est en se faisant du pied que les deux inconnus se rencontrent dans le train et se parlent. Une vraie passe de drague pour le fils raté qui veut être reconnu et aimé. D’où la provocation des meurtres. Ce que le bon sens du champion refuse. L’autre va donc insister, s’obstiner, s’imposer. Jusqu’à la haine, une inversion d’amour.

Mais ce sentiment négatif ne le servira pas, il se prendra à sa propre toile et terminera comme il se doit. Bruno suit Myriam, serpent à lunettes qui s’amuse follement avec deux jeunes avec qui elle va faire la fête avant de coucher. Il profite d’un moment où elle est seule dans la nuit pour l’étrangler, sur l’île d’amour du parc de Metcalf, alors que les deux jeunes sont en train d’amarrer le bateau. Il se voit en miroir dans les lunettes de la fille et jouit de sa terreur progressive. Il la laisse morte et empoche les lunettes pour preuve, ainsi que le briquet de Guy, qui est tombé de sa poche. Cela lui donnera une idée.

Pendant ce temps Guy, en colère parce que Myriam a refusé de divorcer et qu’elle est enceinte, a téléphoné à Anne qu’il voudrait la supprimer – il l’a même répété trois fois, comme le reniement de Pierre dans les Évangiles. A l’heure du meurtre, qui est très vite découvert par les petits amis de Myriam, le tennisman est dans le train pour New York en compagnie d’un vieux prof aviné qui lui explique les intégrales (John Brown). Le problème est qu’il ne se souviendra de rien, trop bourré pour faire un témoin. Guy ne peut donc offrir qu’un demi alibi aux inspecteurs : il a cité un passager effectivement dans le même train, mais a pu monter en route à Baltimore. Les flics le surveillent donc constamment pour voir s’il va se couper.

Bruno le maniaque harcèle Guy pour qu’il accomplisse son meurtre en retour, celui de son père haï. Il lui téléphone, le rencontre « par hasard » au musée, dans la rue, s’incruste même aux invitations du futur beau-père, sénateur, se lie de relations mondaines avec des amis de l’entourage. Il envoie par la poste un plan de la maison avec une clé, puis un pistolet. Excédé, Guy décide d’en finir : il déjoue (facilement) la surveillance des flics sous sa fenêtre et se rend à la maison de Bruno, jusqu’à la chambre du père indiquée sur le plan. Il veut parler avec lui de son fils et lui dévoiler la machination du fou. Mais le vieux n’est pas là et c’est Bruno qui l’attend. Ce qui est curieux est que Guy aurait pu tirer sur la forme dans le lit, pour accomplir sa mission et tuer ainsi le psychopathe net. Bruno joue avec la mort, la donnant sans remord mais désirant aussi qu’on la lui donne pour expier sa mauvaise nature. La devoir au beau jeune homme amoureux et à qui tout réussit serait peut-être une grâce, un geste d’amour peut-être. Il y a une ambiguïté homosexuelle, consciente ou non, dans le film. Peut-être était-ce l’époque, au masculinisme accentué du fait de la guerre toute récente.
Mais Guy repart de la maison sans même que Bruno ne lui tire dessus. Guy a-t-il même pris le soin d’ôter les balles du chargeur, puisqu’il n’avait pas l’intention de tirer ? Il est probable que non, ce qui montre sa légèreté, voire son innocence au sens psychologique. Il a même oublié de débrancher le téléphone chez lui, qui a sonné interminablement la nuit, sans doute Anne toujours inquiète et cherchant le réconfort en vrai femelle du temps, ce qui a intrigué les flics. Ils se sont alors aperçus, mais un peu tard, que l’oiseau s’était envolé. Anne a en effet découvert le pot aux roses en observant Bruno évoluer en intrus parmi les convives d’une soirée organisée par son père le sénateur, où il a parlé crime avec deux épouses qui s’ennuient et a mimé l’étranglement sur l’une d’elle. Hypnotisé par les lunettes de Babette (Patricia Hitchcock), la sœur d’Anne qui le regardait, il en a oublié de ne pas serrer trop fort et s’en est même évanoui. Guy a alors tout avoué à Anne, sa rencontre, la proposition des deux meurtres sans mobile, son refus et le harcèlement. Mais le dire à la police serait devenir coupable aux yeux de la loi, sans témoin fiable pour le corroborer.

Bruno a une autre idée : aller remettre le briquet sur l’île du parc d’attraction pour faire accuser directement Guy et se venger de son refus de tuer son père. Il l’en informe et le jeune tennisman veut alors le rejoindre pour l’en empêcher mais sa fiancée lui fait remarquer qu’il doit tout d’abord subir l’épreuve du championnat de tennis, ce serait louche s’il déclarait forfait. Guy va donc s’efforcer de gagner en trois sets, malgré un adversaire coriace, pour attraper un train vers Metcalf avant la nuit tombée, heure où le meurtrier ira incognito déposer la preuve sur l’île. Ce qui donne une séquence de suspense bien construite où les images du match serré où tout est à l’initiative de Guy et les images du voyage inexorables de Bruno vers Metcalf sont intercalées.
Grâce à Babette, efficace personnage secondaire qui prépare un taxi pour lui, Guy parvient à attraper le train pour Metcalf et arrive au soleil couché. Les flics qui le surveillent préviennent leurs collègues sur place et il est suivi en force dans le parc d’attraction. Bruno est retardé par la foule qui se presse sur l’île, voulant voir « les lieux du crime » ; aucun bateau n’est disponible et la queue est longue. Il est reconnu par son chapeau enfoncé sur les yeux et son air sévère, halluciné plus que fêtard, par le loueur de canots (Murray Alper), qui l’indique aux flics. Mais, voyant Guy, il tente de lui échapper en grimpant sur un manège qu’un con de flic fait tourner en folie lorsqu’il tire un coup de feu en pleine foule qui tue le machiniste, poussant le levier à la vitesse maxi.

Le combat entre Guy et Bruno est un autre moment de suspense, avec le sempiternel gamin innocent des films américains. Juché sur un cheval de bois, il tape avec enthousiasme sur Bruno le méchant qui l’envoie bouler, manquant in extremis d’être éjecté si Guy ne l’avait pas retenu puis sauvegardé dans une baignoire. Lorsque le manège est enfin arrêté par un employé qui passe dessous afin d’accéder au frein d’urgence, tout s’écroule dans un fracas pré-hollywoodien au milieu de la foule hystérique, et Guy s’en sort alors que Bruno y reste. Il mentira jusqu’au bout, sans se repentir une seconde en mauvais larron, niant avoir le briquet et accusant Guy de l’accuser. Alors qu’il l’a dans la main, qui s’ouvre à son dernier soupir devant le flic qui comprend tout.
Le côté destinée, version protestante de la grâce innée ou du mal sans recours, est très fortement souligné dans ce film noir. Guy est la jeunesse championne, énergique et innocente – en bref l’Amérique juste après-guerre ; Bruno est la version décadente d’enfant gâté, pourri de l’intérieur, jaloux et paresseux, voué à détruire. Le pendant féminin est entre Anne, fille de riche mais non gâtée, amoureuse – et Myriam, dont la fêlure intime est révélée par le port de lunettes, qui veut jouir sans payer, égoïste et menée par le vagin.
Un thriller efficace qui n’a rien perdu de son mordant ni de son attrait. Je l’ai vu et revu régulièrement. En connaître la fin n’a aucune importance car ce qui compte est la progression tragique de la prédestination au mal.
DVD L’inconnu du Nord-Express (Strangers on a Train), Alfred Hitchcock, 1951, avec Farley Granger, Robert Walker, Ruth Roman, Leo G Caroll, Warner Bros Entertainmenent France 2001, 1h39, €7,40 blu-ray €15,81 – avec version bis britannique, 2 mn de différence.

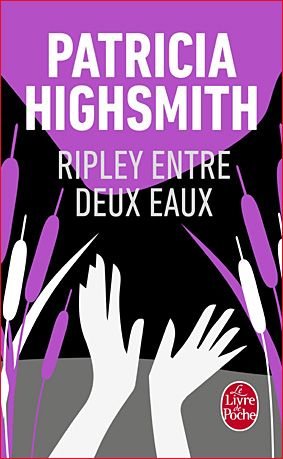

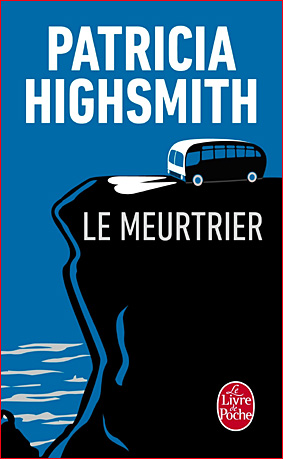
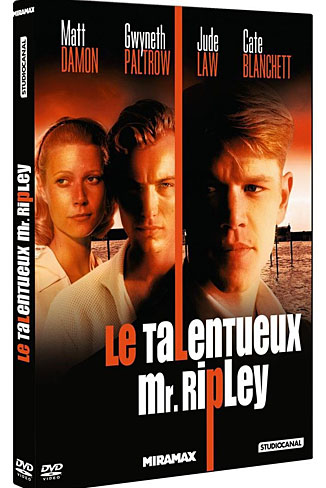




Commentaires récents