Le titre en français fait peut-être plus vendeur que le titre américain mais « le gaffeur » (the blunderer) décrit bien le personnage principal. Patricia Highsmith est une observatrice aigue de la société de son pays et de son époque. Les années 1950 aux Etats-Unis sont celle de la réussite sociale encouragée par les biens de consommation ménagers, et les couples s’enferment en égoïsme, surtout lorsqu’ils n’ont pas d’enfants. Chacun y écluse force scotch et cocktails pour les riches, bière en boite pour les pauvres – même avant de prendre le volant après la « soirée ». Et l’on y fume comme des cheminées.
Walter Stackhouse (rien à voir avec un steack) est un avocat d’affaires qui a épousée une névrosée redoutable dans la vente immobilière. Il est toujours amoureux et sexuellement attiré, pas elle. Il divorcerait bien mais, à chaque tentative, Clara entreprend un suicide. Ne reste que le meurtre… qui lui effleure l’esprit à la lecture d’un fait divers dans un journal. Une femme a été tuée à un arrêt de car, attirée dans un buisson, et son mari a un alibi qui repose sur un témoignage : il était au cinéma.
Crime parfait ? Walter découpe l’article (Internet n’existait pas) et va pour le classer dans un cahier d’observations sociales qu’il tient peut-être comme Patricia Highsmith pour en tirer des idées de futurs romans. Et puis il le jette ; il est amoureux de sa femme et va plutôt forcer le divorce. Si elle réussit son suicide, pas besoin de la tuer !
Il est en revanche fasciné par le mari du fait-divers et va jusqu’à sa librairie pour le voir physiquement. A-t-il été capable de tuer ? C’est la première d’une série de gaffes qui vont se multiplier, faisant de lui un coupable lorsque sa femme meurt lors d’un arrêt de car où elle va voir sa mère mourante qu’elle déteste. Elle est retrouvée fracassée en bas d’une falaise. A-t-elle sauté ? L’a-t-on poussée ? La première hypothèse est vraisemblable mais le gaffeur a été jusqu’à suivre sa femme jusqu’au premier arrêt du car longue-distance, comme hypnotisé par l’exemple du libraire. Il ne l’a pas trouvée mais s’est fait remarquer – troisième gaffe.
Le jeune inspecteur fédéral Corby s’acharne sur les dossiers car il a les dents longues. Il retrouve la coupure de presse classée dans l’album de Walter, qui croyait l’avoir jetée mais que sa femme de ménage consciencieuse a ramassée. Et il découvre que l’avocat a été rendre visite au libraire avant la mort de sa femme. Il n’aura de cesse, dès lors, de monter les deux hommes l’un contre l’autre afin de les faire avouer. Sans Stackhouse, Melchior le libraire aurait vécu tranquille et sans soupçons. Mais la façon dont sa femme a été éliminée a inspiré un copieur, ce qui ramène le projecteur sur lui.
Cette rivalité se double d’une lutte de classes : « C’était bien le genre d’endroit où il s’attendait à voir vivre Stackhouse, une grande maison, de la bonne construction solide et chère, comme un livre relié en parchemin blanc, et pourtant sans rien d’ostentatoire : Stackhouse était si profondément homme de goût, si bien retranché derrière la barrière de son argent, de sa classe sociale, de son allure d’Anglo-Saxon » p.335 édition Pocket. Cette peinture de mœurs fait beaucoup pour l’attrait des livres.
Mais c’est surtout la fabrique du coupable qui est le ressort du roman. Le vrai coupable du premier chapitre sait se faire oublier ; le faux coupable de la suite multiplie les erreurs et se laisse manipuler. C’est l’époque autoritaire où l’on ne peut entendre sonner un téléphone sans décrocher, même au milieu de la nuit, ni entendre sonner à la porte sans ouvrir. Où les rumeurs sociales s’enflent en milieu fermé, la femme ménage déclarant au kiosquier qui le répète à la charcutière, ce qui arrive aux oreilles de l’ami ou du patron… Où les journaux s’emparent des affaires juteuses et spéculent sur la culpabilité à partir de menus faits, faisant des coïncidences des preuves et des gaffes des aveux. C’est particulièrement net aux Etats-Unis, et déjà dans les années cinquante du maccarthysme où chacun soupçonnait chacun de possible trahison. C’est que les sociétés puritaines sont portées à s’épier mutuellement, à dénoncer les déviances de « la ligne », à chercher le « péché » dans tout comportement. C’est le cas en islam, c’est le cas dans la société communiste (et peut-être bientôt en société écologiste), c’est particulièrement le cas aux Etats-Unis. Dans ce genre de société, seule compte l’apparence, la réputation, l’opinion. Peu importe la vérité, elle n’est que contingente et relative ! Chez Patricia Highsmith en 1954, comme chez Donald Trump en 2017. Car il s’agit bien de la même société.
La fin est désagréable et bâclée, la vieille vicelarde de Patricia Highsmith, auteur de Plein soleil, n’ayant aucun sens du bien ni de la morale. Mais, après tout, l’inattendu fait le sel du roman policier.
Un film de Claude Autant-Lara a été réalisé en 1963 sous le même titre, Le meurtrier.
Patricia Highsmith, Le meurtrier (The Blunderer), 1954, Livre de poche 1991, 384 pages, €7.30
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

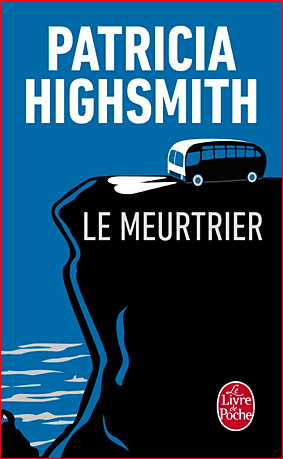
Commentaires récents