François Mitterrand m’a toujours captivé. Littéraire, provincial, florentin, attaché aux relations humaines et fidèle, il avait le sens de l’État et celui de la France dans un univers qui évoluait vite, sous l’influence de l’économie–monde américaine.
Bien sûr, tout n’est pas rose dans le personnage : son côté caméléon, son ambition forcenée, sa capacité à tourner casaque, ses transgressions de la légalité selon son bon vouloir (les écoutes de journalistes, sa maitresse cachée, sa fille élevée aux frais de l’Etat). Mais la complexité de sa personnalité me fascine, sa richesse, sa profondeur. François Mitterrand, s’il n’a pas la stature historique d’un Charles de Gaulle, tranche sur les technocrates gris et superficiels qui peuplent trop souvent nos gouvernements.
C’est l’un des mérites du livre d’Hubert Védrine de le rappeler à propos des affaires étrangères, lui qui fut conseiller du président pendant quatorze ans. L’un des aspects de son livre consiste à dégager la cohérence et les lignes de force de la diplomatie mitterrandienne ; un autre aspect de tracer un portrait en actes du président. C’est cette seconde lecture qui m’intéresse ici.
« Toute sa vie avant 1980, François Mitterrand a été un individualiste et un rebelle. Élu président, il ne change pas de conception. Il entend bien être et rester le seul détenteur de l’ensemble des informations, seul maître de la totalité des réflexions et projets, et naturellement l’arbitre final des décisions de la présidence comme du gouvernement. D’où la méfiance que, d’instinct et expérience, il nourrit vis-à-vis des corps qui se prétendent détenteurs de la vraie légitimité, des bureaucraties qui phagocytent les ministres, des organisations qui pourraient entraver sa démarche » p.30. En quelques mots, beaucoup est dit : Mitterrand n’est pas un technocrate, il aime réfléchir par lui-même et ne pas laisser une décision importante à l’anonymat irresponsable des « experts » ou des « bureaux ». Il décide « en méditant seul longuement, mais aussi en éprouvant sur l’un, sans le lui dire, les idées de l’autre, puis sur un troisième une combinaison des idées des deux premiers, avant d’adopter cette idée ainsi transformée, non sans l’avoir modifiée à nouveau ou, au contraire, de la stocker en mémoire, d’où il la ressortira, en cas de besoin, trois mois ou trois ans plus tard » p.34.
Comme centre de pouvoir autour duquel tout gravite, il exerce un ascendant et laisse se former une cour. Mais il reste personnellement libre envers tout cela. S’il crée des dépendances, il stimule ; s’il séduit, il contrôle. Ce ne sont pas les « favoris » qui emportent les décisions, mais bien lui-même, homme de caractère et de volonté. « Il y a eu une fascination, un envoûtement Mitterrand (…). Ce bonheur Mitterrand a été mal rendu par les témoignages » p.72.
Sa personnalité, il la nourrit par la culture, notamment par l’histoire et par la pensée des grands hommes. Il reste en cela un humaniste, tempérament ou qualité qui a tendance à se perdre dans le laisser-faire ou la frivolité de nos jours. L’humanisme est d’essence libérale au sens du XVIIIe siècle, attaché à ce qui est précieux en chaque individu, à ses capacités uniques d’intelligence et d’invention, que la société a pour devoir de développer et d’épanouir. « Sa vraie passion, insatiable, sa source de vie jamais tarie, c’est la littérature. Les livres, neufs ou anciens, les libraires et les librairies, les ventes et, bien sûr, les auteurs, leur écriture. Ses goûts sont hors de toute mode, loin des best-sellers intemporels. S’il aime la compagnie des romanciers contemporains, il est peu porté sur les « grands écrivains » de son temps, à l’exception peut-être de Mauriac, de Giono et de grands créateurs non-européens qui écrivent comme coulent les fleuves : Gabriel Garcia Marquez, William Styron, Yachar Kemal. Plutôt Renan, Chateaubriand, Lamartine, Zola, le XIXe siècle. Et Casanova, Casanova bien sûr, et Venise, ville-talisman » p.76. J’ajouterai pour ma part Jacques Chardonne, Louis Ferdinand Céline et Ernst Jünger – mais ce n’était pas politiquement correct en gauche socialiste d’évoquer ces sulfureux écrivains portés à droite, bien que Mitterrand les aimât fort.
Car nourrir sa réflexion ailleurs que dans ce qui est tout proche est une forme intellectuelle de liberté. « Ce qui a beaucoup agacé chez lui est peut-être qu’il le peu de cas qu’il faisait de toute une cuistrerie contemporaine, de tout un pathos indigeste de sciences de l’Homme, de Progrès, de Morale, sur la nature humaine, qu’il en ait tant, qu’il en ait trop su, d’instinct, sur l’immuabilité de cette dernière » p.77.
Pragmatique, héritier du passé français, historien et géographe en politique étrangère, il était de « culture classique, français dans ses tripes, européen de raison, occidental par le hasard de la géopolitique » p.86. Il se méfiait des hypocrisies et paravents d’intérêts que dissimule le discours libéral, surtout anglo-saxon. S’il a le goût de la précision, il a aussi « tact, pudeur, souci de ménager les étapes, conviction qu’il vaut mieux faire que dire et que cela risque d’aller moins bien en le disant » p.406.
Nourri de la Bible par sa mère, « les leçons de l’histoire étaient pour lui quotidiennement présentes, presque obsédantes » p.749. Celles qui ont fixé les lignes géo-ethniques par exemple en Europe, idée plus que centenaire qui permettra peut-être de « civiliser la mondialisation » en préservant le meilleur de la vieille Europe et de sa culture, dont celle de la France.
Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand – à l’Elysée 1981-1995, 1996, réédition Fayard 2016, 784 pages, €34.00 e-book Kindle €32.99

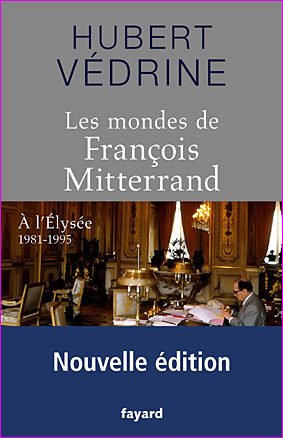
Commentaires récents