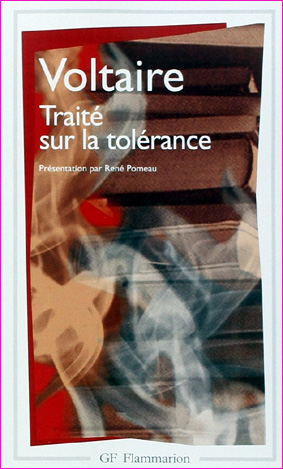
Tout commence par l’affaire Calas à Toulouse le 13 octobre 1761. Dans une famille protestante, le père est accusé d’avoir tué son premier fils de 28 ans « parce qu’il » voulait se convertir au catholicisme. La rumeur publique enfle et exige des treize juges qu’ils condamnent à mort ceux qui restent, le père, la mère, le fils cadet, l’ami présent, la servante. Le tribunal condamne après enquête, mais seulement le père, à être torturé puis roué avant d’agoniser deux heures (au cas où il avouerait) puis étranglé. Mais il n’avoue rien, il est innocent, le fils aîné s’est probablement suicidé par pendaison tout seul par dépit de n’être pas reconnu professionnellement par la société (il voulait devenir avocat, ce qui était impossible à un protestant), ni par son père qui le voulait boutiquier comme lui. Voltaire en fait le scandale du siècle, le procès de l’Intolérance, qu’il attribue aux Jésuites affidés du pape et à l’Eglise soucieuse de terroriser les fidèles pour mieux les tenir.
L’écrivain en fait un « Traité » qui est plus pamphlet qu’une réflexion philosophique, un écrit « à la française » empli de raisonnements et d’ironie qui en appelle à la liberté (pourvu qu’elle ne menace pas les autres) et au bon sens (si mal partagé par les croyants poussés au fanatisme). Mais le « traité » s’arrête à l’exposé des faits et à la revue des recherches, comme on dirait aujourd’hui. La thèse n’est pas écrite qui ferait de la tolérance un souverain bien pour telle et telle raison. Ce livre est plus un placet pour agiter l’opinion publique « éclairée », juxtaposant des pièces en faveur de la révision du jugement auprès du Conseil du Roy – qui annule la sentence après nouvelle enquête en 1765.
La rhétorique « à la française » (qui subsiste en nos journaux intellos) consiste tout d’abord à remonter aux calendes grecques sur le sujet en question – au contraire des journaux anglo-saxons qui ouvrent toujours leurs articles sur le vif du sujet : les faits en premier et les hypothèses d’explication à la fin. Voltaire se préoccupe donc d’aller voir comment les peuples anciens étaient intolérants ou pas. Puis, dès que les chrétiens furent en nombre, si ce n’est pas de leur côté que l’intolérance fut la plus grande : en effet, le propre d’un croyant est de mettre au-dessus de tout son dieu et sa foi, récusant toute critique, tout aménagement et toute raison. C’est ainsi que « les martyrs » sous l’empire romain étaient de mauvais citoyens qui refusaient les rites de la société dans laquelle ils vivaient alors « qu’il n’y a, si je ne me trompe, que peu de passages dans les Evangiles dont l’esprit persécuteur ait pu inférer que l’intolérance, la contrainte, sont légitimes » chap. XIV. Les martyrs chrétiens se mettaient hors de leur société, rêvant au royaume des cieux. Les y expédier était presque leur rendre service, ironise Voltaire, mais l’intolérance était avant tout de leur côté bien loin de la raison naturelle humaine : « Si vous voulez qu’on tolère ici votre doctrine, fait dire Voltaire par un mandarin chinois à deux chrétiens, un aumônier danois et un jésuite qui se battaient, commencez par n’être ni intolérants ni intolérables » (chap. XIX). Cette maxime joliment frappée pourrait s’appliquer avec bonheur aux extrémistes de l’islam aujourd’hui. Du temps de Voltaire, l’Eglise et les sectes ecclésiales (telle les Jésuites) en ont rajouté comme eux sur le Dogme et son respect à la lettre – pour imposer leur pouvoir sur les âmes, suscitant ces guerres de religion qui ont fait tant de mal à l’Europe.
Plus que la tolérance, c’est donc la liberté que prône déjà Voltaire : celle de croire sans imposer, celle de penser sans être condamné, celle d’exercer une profession sans donner des gages de sa foi. Ce qui veut dire concrètement la séparation des Eglises et de l’Etat comme John Locke l’exhortait, l’épuration de la religion de tout ce qui est impur et malsain, accumulé par les siècles d’obscurantisme et de cléricalisme, et le droit laissé à chaque citoyen de ne croire que sa raison. Plus le rire, que les caricaturistes illustrent de nos jours contre la plus fanatique de toutes les dérives religieuses : « Ce ridicule est une puissante barrière contre les extravagances de tous les sectaires » chap. 5, croit Voltaire.
Au fond, Jean-Marie Arouet ne propose pas moins qu’un vaste programme pour lequel il faudra attendre 1789 afin d’en connaître un début de réalisation, mais qui est sans cesse à recommencer car toute croyance tend à dégénérer en fanatisme (le complot sous Robespierre, les Ultras à la Restauration, l’anarchisme fin XIXe, le communisme et le fascisme au XXe siècle, l’islamisme et le politiquement correct offensé au XXIe siècle). L’universel de la raison naturelle, la tempérance humaine raisonnable, reste un idéal jamais atteint.
Voltaire, Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas, 1763, Flammarion GR 1993, 193 pages, €4.90 e-book Kindle €1.99
Voir pour les détails juridiques du temps la note de Dominique Inchauspé, sur l’affaire Calas et Voltaire. L’auteur est avocat au barreau de Paris et auteur de L’intellectuel fourvoyé, Voltaire et l’affaire Sirven, publié en 2004.

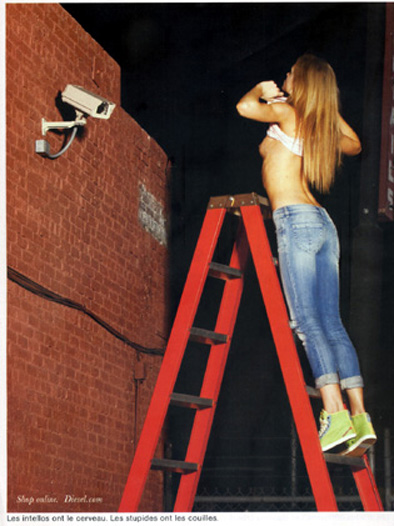
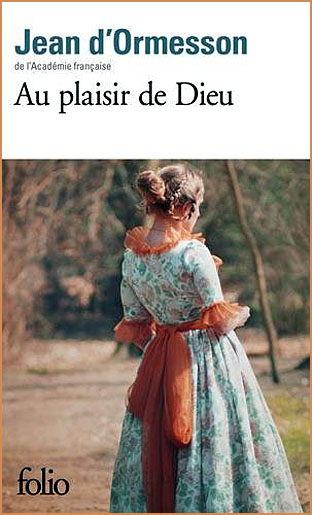


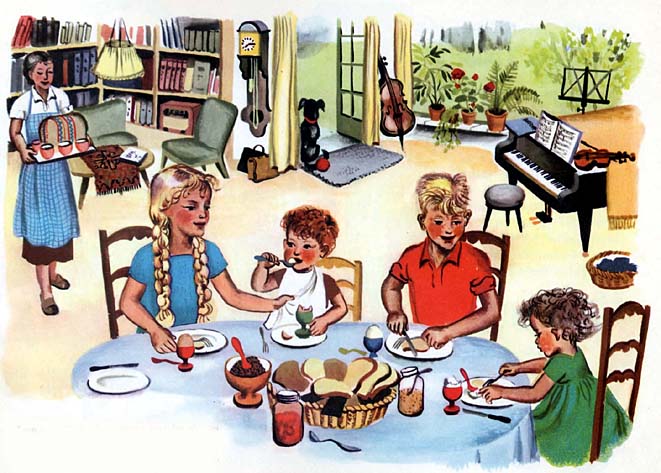
Commentaires récents