En 1851, un aristocrate russe en France qui a combattu avec le futur tsar Alexandre II dans le Caucase, s’aventure en ballon avec quelques amis, Madame la comtesse de Solms (née Marie Laeticia Bonaparte) et le comte Alexis de Pomereu. Le ballon du nom de L’Aigle s’est élevé de Paris le 5 juin 1851 à 5h17 de l’après-midi. « Nous étions d’une gaieté radieuse en quittant la terre » p.29.
L’avion n’existait pas et la terre vue du ciel était un plaisir rare. Non sans une sensation quasi sexuelle, tout comme les balançoires le font aux petites filles. Car Monsieur le comte aime « les actrices » de Paris et est vu souvent en galante compagnie. L’époque savait vivre et donner du plaisir sans la froide exploitation comptable du bourgeois calculateur. La comtesse née Bonaparte fait bien quelques fantaisies pour balancer la nacelle et se pencher au-dessus du vide, par exubérance irrationnelle comme on le dit des ados en état d’ébriété hormonale et comme le dira un banquier central célèbre de l’autre côté de l’Atlantique pour qualifier le marché boursier de son époque. Mais elle quitte le ballon à la fin de la première étape.
En effet, la technique n’est pas au point et les coutures de toile de l’enveloppe se distendent et laissent fuser du gaz. La portance est moindre et le poids doit être allégé pour repartir. Ivan Matzneff reste donc seul avec les deux frères aérostiers Godard.
Ce qui est drôle est que, lors des atterrissages, les paysans accourent et admirent – tout au contraire des moujiks russes filmés par Tarkovski dans Andrei Roublev : eux savent lire, ils ont lâché la superstition pour la science, ils rêvent de bâtir la modernité. Cette époque optimiste du XIXe siècle s’est un peu perdue aujourd’hui, sauf peut-être dans le secret des chambres d’adulescents rivés à leurs gadgets et chattant en forcenés sur smartphones, tablettes et ordinateurs de jeux. Une corde longue de 150 mètres est lancée du ballon et retenue par les paysans accourus, jusqu’à ce que la nacelle rencontre le sol et puisse être amarrée.
Souvent les gens veulent faire entrer l’engin dans leur ville, pour le spectacle, et le ballon est ancré sur la place principale, faisant l’objet d’attraction en ces temps où la télé n’est pas encore inventée. « J’entrais dans un corps de garde ; les soldats ne furent pas médiocrement étonnés de la demande que je leur fis de remiser notre ballon. (…) Je m’emparais de la corde qui flottait sur le devant de notre machine et le ballon captif entra triomphalement dans Soissons en passant par-dessus les fortifications » p.34. C’était la première étape, effectuée en six heures depuis Paris : bien mieux que le train, encore poussif à l’époque !
La seconde étape sera à Montcornet dans l’Aisne, près du château du comte Jules de Chabrillant. Mais le vent s’est levé et amarrer le ballon n’est plus possible à cause des arbres. Il faut repartir de suite, « aller jusqu’à Bruxelles » selon les conseils de M. Godard, l’aérostier. Ce qui est fait derechef. « Quoique le temps fut magnifique, l’intensité du vent devait grandir avec l’élévation du soleil au-dessus de l’horizon, et M. Godard ne doutait pas que nous n’eussions de grandes difficultés à vaincre pour notre descente ; mais nous étions encore sous l’empire de l’enthousiasme, et la fièvre de l’extraordinaire nous dévorait » p.47. Le ballon montera cette fois à 6310 m d’altitude ; c’était le 6 juin 1851 à 9h15 environ du matin. Surdité, difficultés à respirer, fatigue, sont les maux d’altitude bien connus des alpinistes mais ignorés alors.
L’atterrissage définitif du ballon est mouvementé, le vent empêchant son ancre de crocher et les laboureurs de le maintenir. « L’échevin de la commune de Basse-Bodeux » en Belgique intervient et le ballon finit par toucher terre pour être dégonflé et rapporté à Paris par le train depuis Bruxelles. C’est dans cette capitale que « le surlendemain, je gagnais Paris en chemin de fer dans un wagon spécial où Mme la princesse régnante de Valachie, venant de Bucharest, voulut bien m’offrir une place » p.58.
Comme tous ses amis veulent savoir, le harcèlent et lui écrivent, le comte Ivan décide de publier son récit dans la Revue des Deux-Mondes ; il paraît le 1er juillet 1851, soit à peine un mois après l’exploit. Son descendant Gabriel, écrivain contrairement à sa sœur Alexandra et à ses frères André et Nicolas, décide de raviver le souvenir de cet ancêtre fantasque et merveilleux, personnage à la Jules Verne ou à la Hergé, dès qu’il en lu la mention chez Barbey d’Aurevilly, l’un des amis du comte. Il profite dans les seize premières pages de parler moins de l’ancêtre que de lui-même…
Gabriel Matzneff, Monsieur le comte monte en ballon – Comte Ivan Matzneff, Un voyage dans les airs de Paris à Spa en trois étapes, 1851, éditions Léo Scheer 2012, 71 pages, €14.50 e-book Kindle €14.49

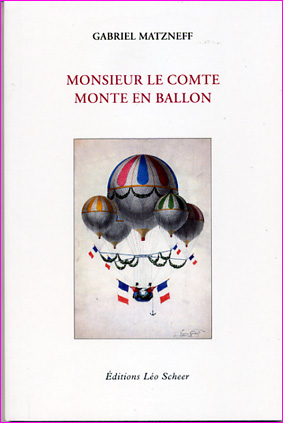
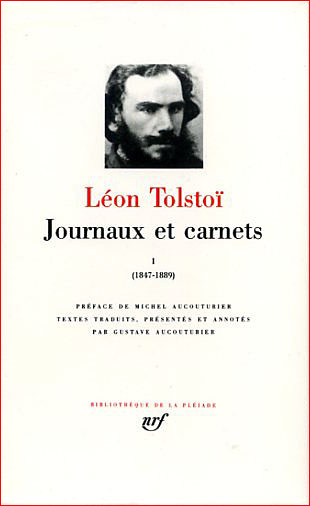
Commentaires récents