Le titre français tire le film du côté biblique par cette citation de Matthieu (18.7) : « Malheur à l’homme par qui le scandale arrive ». Abandonner la voie droite pour celle du démon est certes un bon résumé de la vie du pater familias texan (Robert Mitchum), riche de 25 000 hectares et cavaleur de filles en sa jeunesse. Mais l’injonction morale rigide est nuancée par les progressives révélations sur son couple, qui le rendent moins coupable. Tiré d’un roman de William Humphrey intitulé L’Adieu du chasseur, le film y ajoute un personnage, celui du fils bâtard. Le mélodrame du mâle américain blanc des années cinquante est ici joué à la perfection. Hollywood savait s’intéresser à la psychologie avant la décadence des décennies qui suivront.
Qui va à la chasse est chassé… telle est l’acte par où commence le film ; il finira de même. Le grand mâle blanc patron Wade Hunnicutt se fait tirer dessus lors d’un tir aux canards par un bouseux dont il a lutiné la femme – apparemment consentante. Il n’avait qu’à « la tenir » comme on disait alors. La Bible reconnait que la femelle de l’homme, issu de sa côte, est douée d’insatiable désir qu’il s’agit de dompter par le mariage, le « devoir conjugal » régulier et surtout les enfants. Mais Hannah sa femme (Eleonor Parker) lui a fermé ses cuisses comme une huître depuis la naissance dix-sept ans auparavant de leur seul enfant, Theron (George Hamilton un peu âgé, 20 ans au tournage). Le spectateur ne saura pas pourquoi elle a cristallisé une telle haine envers son mari (haine de classe ? haine de réputation ? haine du sexe ? haine chrétienne ?) – mais la guerre du couple a bien lieu.
Au détriment du fils, comme de bien entendu. A 17 ans, le gamin est mince et naïf, élevé par sa mère qui l’a voulu pour elle seule, condition mise pour rester en couple et sauver les apparences. Sauf qu’à l’aube de l’âge adulte, la niaiserie n’est plus de mise. Les fermiers du patron bizutent un soir Theron en le conviant à participer à une chasse à la bécassine, la nuit dans la forêt (alors que chacun sait que les oiseaux dorment, sauf les rapaces nocturnes). Il doit se tenir avec un grand sac ouvert et siffler, tandis que les « rabatteurs » lui feront déverser le gibier tout droit. L’adolescent le croit, propre et bien mis, les boutons tous attachés, en mocassins dans les fourrés. Le père se rend alors compte qu’il doit prendre en main l’éducation de son fils pour en faire le digne héritier du domaine. Celui-ci l’exige d’ailleurs de lui, après son humiliation par les hommes : « tu es mon père, c’est à toi de m’apprendre ». La « parole » donnée à sa femme tombe d’elle-même, malgré son amertume.
Wade convie son fils Theron dans son sanctuaire, un bureau orné de trophées de chasse et de carabines, ses trois chiens soumis à ses pieds, le bourbon dans le verre, la pipe à la gueule. Il lui donne des conseils de tir et manifeste par une balle dans la chemisée, son intention de prendre en main son garçon à toute la maisonnée, un brin terrifiée. Il mandate comme « grand frère » Raphaël (George Peppard), son autre fils bâtard issu d’une précédente liaison, pour enseigner et surveiller Theron dans son initiation. Celui-ci, avide d’exister contre maman, délaisse ses « collections » de timbres, papillons et autres cailloux (loisirs bourgeois féminins) pour se vouer au tir et à la chasse (loisirs pionniers masculins). Il est habile, passionné, au point de vouloir abandonner ses études – contre son père, mais qui ne récolte que ce qu’il a semé.
Un gros sanglier ravage la contrée et les fermiers demandent au patron d’intervenir, tel un seigneur d’Ancien régime en ce Texas resté au fond peu « démocratique ». Wade mandate Theron pour ce faire : c’est son initiation. Mais il sera sous la tutelle de Rafe. La traque se prolonge le long des marais sulfureux dans lesquels il ne faut pas s’aventurer, symboles de la frontière infernale ; le sanglier semble issu de l’enfer et le vaincre une victoire contre le Mal. Les deux hommes doivent passer la nuit dehors car les chiens sont épuisés et l’un est tué. Mais Theron veut prouver à son père qu’il est digne de lui et se prouver à lui-même qu’il peut le faire et devenir un homme, un vrai. Il ne réveille pas Rafe et quitte le bivouac en léger appareil, torse nu sous sa veste ouverte. Il montre les muscles… et tire effectivement le sanglier.
La suite de l’initiation va consister à la chasse aux filles. Mais comme Theron n’est pas Wade, pas question de papillonner de l’une à l’autre comme la réputation du père, qui le précède, le voudrait. Theron ne jette son dévolu que sur une seule, Elisabeth (Luane Patten). Mais il est trop timide pour aller draguer lui-même et mandate Rafe à sa place (qu’il ne sait pas encore être son grand frère). Celui-ci, sans copine, est ébloui par la belle et trouve les mots choisis pour la convaincre. Commence alors une idylle d’adolescent entre elle et Theron, encore une fois chemise ouverte avec elle comme à la chasse. La symbolique du vêtement ne s’arrête pas là. L’adolescent, pour faire viril, imite les grands et déboutonne largement sa chemise sur son poitrail encore étroit – l’inverse des convenances enseignées par maman toujours impeccablement coiffée et en hauts talons, même sur la pelouse. Il trouve du travail comme ouvrier à l’égreneuse de coton pour s’éprouver et quitter le cocon.
C’est que les rêves des parents pour leurs enfants se heurtent à la réalité de ces mêmes enfants : ils ont leur personnalité et ne sont pas façonnés à partir de rien. Le rêve maternel se brise sur l’exigence de virilité de la société ; le rêve paternel sur le dégoût de « la vie de famille » qu’a connu le fils avec des parents séparés en guerre permanente ; le rêve d’Elisabeth sur la volonté de Theron d’éviter de reproduire le modèle familial… Les rêves sont des volontés de domination sur les autres, qui doivent y résister s’ils ont quelque consistance. Il n’y a guère que le rêve de Rafe (qui n’ose pas en avoir vraiment) qui se réalise : épouse, fils, maison. Car Theron a engrossé Elisabeth sans le savoir, dans sa naïveté, et l’enfant est réputé être celui de Wade, le dragueur impénitent. Mais Elisabeth ne dit rien à Theron car il a déclaré ne pas vouloir se marier pour ne pas reproduire l’antimodèle de ses parents, surtout lorsqu’il apprend que Rafe est son demi-frère. Alors Rafe, qui a toujours aimé Elisabeth mais s’effaçait comme d’habitude devant son frère chéri, se dévoue pour épouser l’engrossée et endosser la paternité de l’enfant. Lui sera un bon père. Surtout lorsqu’il sera reconnu – post mortem – par son véritable géniteur avec son prénom gravé sur sa pierre tombale afin que tous le voient.
Wade disparaît d’un coup de fusil réussi, après la parenthèse de l’initiation du fils par le fils. Mais il est cette fois tiré par le père d’Elisabeth parce que la rumeur l’accuse de l’avoir engrossée – alors qu’il n’y est pour rien, semble-t-il. Mais le film reste ambigu : l’enfant (qui ressemble à Wade pour autant qu’un bébé puisse réellement ressembler à un adulte) est-il son propre fils ou celui de son fils ? Je penche pour la seconde hypothèse mais la réputation sociale penche pour la première. Lorsque le père d’Elisabeth l’apprend (Everett Sloane), il entre chez Wade et le tue. Theron se lance à sa poursuite et le tue. Désormais meurtrier, inapte à la famille à cause de ses parents, il n’a comme héritage que la destruction : le goût du sang et de la chasse, l’alcool, le dégoût du couple et de la progéniture, l’absence d’instruction. Un bel exemple !… Seul Rafe est conscient de ses manques, une enfance orpheline, l’absence de reconnaissance, un savoir concret dans la nature. Il prend la vie comme elle vient, sans rêver, et la vie le récompense.
Robert Mitchum en chef de tribu est magnifique, son fils George Hamilton moins ; il fait pâle figure avec sa silhouette de gamin monté en graine contradictoire avec un sternum velu. Il expiera les « péchés » d’être riche et fils chéri en délaissant son domaine pour partir travailler au loin, et en laissant sa fiancée à son demi-frère, avec le bébé qu’il ignore couvant dedans. Le fils bâtard héritera de tout, par compensation biblique (les premiers seront les derniers). La mère, Eleonor Parker, en frigide rigide est la poupée sociale corsetée en devoirs, enfermée dans ses certitudes moralisantes et inapte à comprendre son enfant comme son mari… et les autres. Il faut la « violer » au sens métaphorique pour qu’elle se bouge : imposer la virilité au fils, imposer la réconciliation comme remède à l’asthénie du fils, imposer le voyage de noces à Naples pour à nouveau coucher ensemble, l’appâter avec le petit-fils pour qu’elle sorte de sa grande maison vide après la mort de son mari et le départ de Theron. C’est une potiche, dont la « volonté » n’est que cuirasse de refus, pas une action positive.
DVD Celui par qui le scandale arrive (Home from the Hill), Vicente Minnelli, 1959, avec Robert Mitchum, Eleanor Parker, George Hamilton, George Peppard, Warner Bros 2006, 2h24, €24.99 blu-ray €22.77













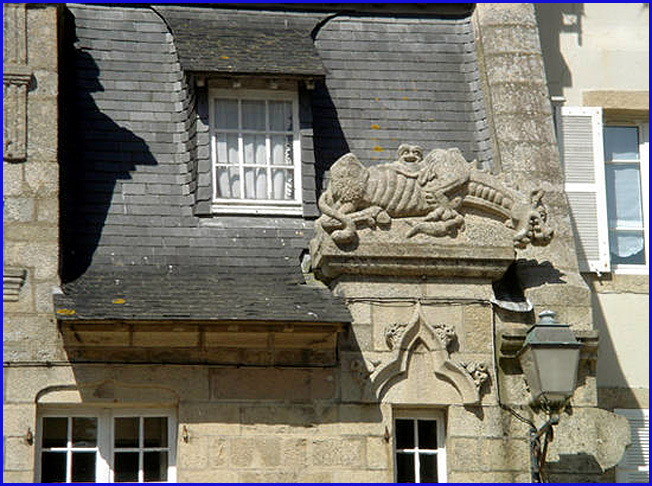





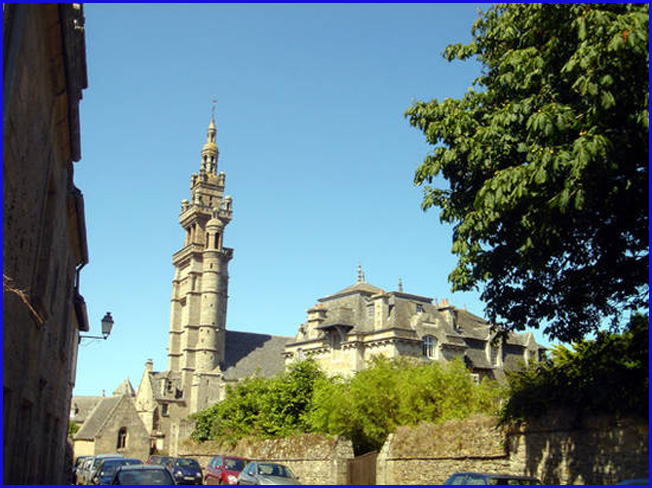

Commentaires récents