
Un doctorant juif en Histoire de Columbia nommé Thomas Lévy (Dustin Hoffman), court autour de Central Park pour s’entraîner au marathon, fort à la mode au milieu des années 1970. Son père est mort des suites du maccarthysme, suicidé pour avoir été accusé à tort, les « vérités » de ce temps de soupçon étant aussi relatives que celles de Trump. Vous êtes ce que je crois que vous êtes, pas ce que vous croyez être. Le jeune garçon en a été marqué à vie et entreprend des études d’histoire justement pour savoir. Son directeur de thèse le lui fait remarquer, son sujet sur les tendances autoritaires dans la démocratie américaine ne saurait se limiter à la période du sénateur McCarthy durant la guerre froide des années 1950.
Le frère aîné de Thomas, Henry (Roy Schneider), est « dans les affaires », le pétrole comme il était de mise à l’époque. Il gagne bien sa vie, aime les plaisirs du luxe, grands hôtels, bons vins, bonne chère lorsqu’il voyage. Et il voyage souvent, notamment à Paris. Le spectateur français a plaisir à revoir ce Paris des années 1970 qui nous semble si exotique avec son fouillis dans les rues, ses antiques automobiles aux formes bizarres comme l’Ami 6 Citroën aux lunettes de vieille folle et à la vitre arrière à angle aigu ou la 204 Peugeot au train arrière raboté comme s’il était sans queue. Les hommes portent tous des cheveux dans le cou, même les flics, ce qui fait genre sous la casquette. Des post-soixantuitard pré-écolos défilent en vélo, braillant « contre la pollution » tandis que les soutiers de la CGT laissent s’entasser les sacs poubelle dans les rues en raison d’une sempiternelle « grève » productiviste. Mais ce paysage exotique cache de redoutables pièges pour Henry, qui travaille en fait pour une organisation gouvernementale secrète chargée de traquer les anciens nazis.

Justement, l’ancien dentiste SS hongrois des camps Szell (Laurence Olivier), inspiré du Dr Mengele, qui s’est exilé en Uruguay, compte récupérer un trésor de diamants qu’il a déposé dans une banque de New York avec son frère. Lequel, tombant en panne en Mercedes dans le quartier juif, se fait prendre à partie par un irascible rescapé qui le pousse à bout – et notamment dans un camion de fuel qui explose (bien que le fuel n’explose pas…). Tous deux meurent, cramés comme à Auschwitz, ce qui est un clin d’œil ironique comme il n’en manque pas dans le film (à l’époque, on pouvait rire de tout et le blasphème, même sur la Shoah, n’était pas haram). Szell, au prénom de Christian (encore un trait ironique pour un nazi), ne fait pas confiance aux courriers qui convoient ses diamants vers Paris régulièrement et veut prendre en main lui-même l’opération. Henry Lévy est agent double, lui servant de courrier tout en travaillant pour le gouvernement. Szell veut l’éliminer, à moins que ce ne soient ses collègues… Le problème de l’agent double est que tous les côtés sont ses ennemis.
Il échappe de justesse à un attentat à la bombe en poussette au marché aux puces à Paris, puis à un égorgement de dacoït par un asiatique particulièrement retord dont il finit par faire craquer les vertèbres, torse nu au balcon après sa musculation, ce qui est bien dans l’esthétique des années 1970. Mais il finira mal, Szell l’aura personnellement à New York, avec sa lame rentrée sous le coude. Henry parviendra à rejoindre son petit frère Thomas dans son studio de Broadway et s’écroulera mort dans ses bras.

A-t-il dit quelque chose ? Le spectateur sait que non, Szell comme l’organisation soupçonnent que oui. Dès lors, il s’agit de faire parler le jeune homme innocent et tout est bon pour cela, depuis la jeune fausse Suissesse qui le séduit à la bibliothèque (Marthe Keller) jusqu’à la fausse évasion après les tortures dentaires de Szell par Janeway (William Devane), le collègue de son frère. « Is it safe ? » lui demande Szell comme une énigme ; mais le petit frère ne connaît pas le mot de passe ni l’allusion. La traduction française est ambiguë car le mot « safe » désigne, outre le sans danger, aussi le coffre-fort…

Thomas court pour sa vie, il court après la vérité, il court pour aller plus vite que le mensonge et les balles. Mais, Juif qui veut sauver sa peau contre tous les fascismes, du nazisme de Szell au maccarthysme qui a tué son père et au complotisme secret du gouvernement de son temps, Thomas saura se défendre. Il les descendra tous, juste revanche de Superman contre l’hydre du Mal. De bons symboles américains ajoutent à l’histoire pour faire percuter le spectateur dans ce grand film d’espionnage devenu culte.
DVD Marathon Man, John Schlesinger, 1976, avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Schneider, William Devane, Marthe Keller, Paramount, 2h03, €8.15 blu-ray €15.24


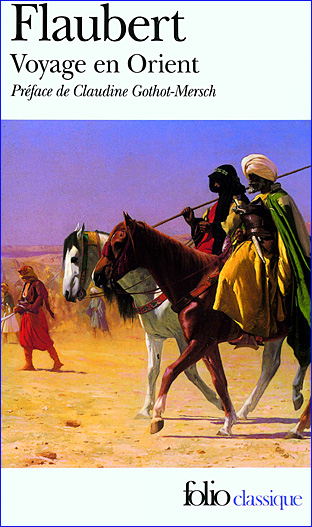



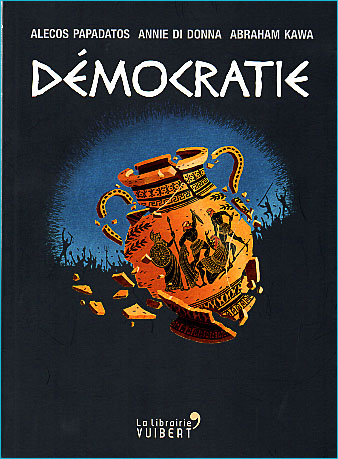


















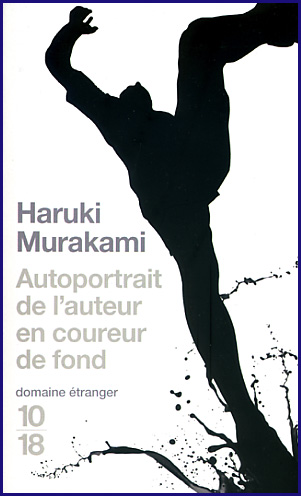









Commentaires récents