
Premier tome de la trilogie romancée de son autobiographie, Jules Vallès se met en scène sous les traits de Jacques Vingtras (mêmes initiales), de sa naissance en juin 1832 à 16 ans en 1848. Bien qu’il écrive au présent pour qu’on s’y croie, le personnage n’est pas lui. Il est l’enfant vu par la distance critique de l’âge (la quarantaine avancée) et à la lumière de la Commune de 1871 puis de la IIIe République qui suit. Il s’est rendu unique bien qu’il soit le troisième enfant du couple ; les deux autres sont occultés pour l’acuité de l’épure.
Les derniers lecteurs à pouvoir comprendre ces mœurs et cette époque sont encore vivants aujourd’hui car il subsistait de ces Folcoche abusives jusqu’avant les années post 1968, où la société a radicalement changé de paradigme. Seuls ceux qui ont vécu leur enfance au début des années soixante encore ont pu avoir une mère telle que décrite et un père fonctionnaire humilié tel qu’il est présenté. La mère est obsédante, l’enfant la craint, voire la hait car elle le bat par principe (on dit qu’elle « le corrige ») et le lave tout nu à grands coups de bassine d’eau froide dans la cuisine ; l’adolescent puis l’adulte la comprennent et pardonnent. Cette Julie, sortie de la paysannerie par son mariage avec un petit intello fonctionnaire, aspire à la bourgeoisie. Elle méprise ouvertement artisans et commerçants de la « petite » classe pour viser à la « moyenne », celle qui pose en société, le milieu cultivé. Ne travaillant pas comme le font les paysannes, les ouvrières et les commerçantes, sa seule activité valorisante est de « dresser » son moutard et de « tenir » la maison (et les cordons de la bourse). « Qui remplace une mère ? Mon Dieu ! une trique remplacerait assez bien la mienne » p.212 Pléiade.
Méfiante, avare, elle veut le mieux pour faire réussir l’enfant et, pour cela, il faut le « contraindre » – pour son bien. Tout ce qui est nature est proscrit, tout ce qui est domptage social requis. Voudrait-il avoir la liberté du corps ? On l’enferme dans des cols et des redingotes, on lui interdit de sortir jouer avec les petits du peuple, on l’enferme en classe et étude. Aime-t-il les poireaux ? On lui refuse. Déteste-t-il les oignons ? On le force. Nourri au gigot la première semaine du mois, cuit, réchauffé, froid, en hachis, en boulettes, le gamin est vigoureux et « râblé » ; il « a du moignon » (du muscle) et aime s’en servir. Dès 11 ans, il en remontre à ses cousines paysannes en sautant à pieds joints une barrière ; à 14 ans il porte les bagages ; à 15 ans il séduit (sans le vouloir laisse-t-il entendre) Madame Devinol, une femme mariée qui l’emmène à la campagne pour lui faire son affaire avant que, cocasserie où l’ombre de la mère paraît, sa classe de collège en goguette reconnaisse à l’entrée son chapeau prétentieux imposé par maman et interrompe l’idylle.
Le jeune Jacques/Jules aime la liberté, la nature, l’espace. Il est contraint par les convenances, les vêtements, la maison et le collège. Il se trouve enfermé et angoisse, ne s’évadant que par les livres, Robinson Crusoé enfant, le récit des grands hommes adolescent, puis celui de la Révolution. A 8 ans il ôte sa cravate pour aller col ouvert embrasser sa tante qui sent si bon ; à 11 ans sa cousine un brin amoureuse de sa vigueur lui fourre un bouquet souvenir à même sa peau nue par le col de sa chemise ouverte. L’enfant est énergique, sensuel. « Cet air cru des montagnes fouette mon sang et me fait passer des frissons sur la peau. J’ouvre la bouche toute grande pour le boire, j’écarte ma chemise pour qu’il me batte la poitrine » p.232.
Quant à son père, il est distant, il est « pion » même à la maison. Faible devant sa femme, il a peu de moments complices avec son fils. Celui-ci, dans le même lycée où il enseigne, peut lui faire honte et entacher sa carrière besogneuse, peu reconnue. « Je m’étais rappelé tout d’un coup toute l’existence de mon père, les proviseurs bêtes, les élèves cruels, l’inspecteur lâche, et le professeur toujours humilié, toujours malheureux, menacé de disgrâce ! » p.345. Si le gamin n’est pas mauvais en thème grec et en version latine, s’il comprend la géométrie parce qu’un maçon italien réfugié lui a montré avec les mains, il n’accroche à aucune abstraction, ni mathématique, ni philosophique, ni religieuse. Qu’il faille énumérer « les preuves de l’existence de Dieu » ou « les sept facultés de l’âme » le laisse froid ; d’ailleurs il pourrait y en avoir huit – ce qui lui fera rater son bac la première fois. Il préférerait comme ses oncles la vie à la campagne, « se dépoitrailler aux chaleurs comme un petit vacher » ou manier les outils d’artisans. L’exemple de son père ne lui fait aucune envie : « bien » travailler et « dur » – pour ça !

La famille à trois suit la carrière de Monsieur le professeur, d’abord répétiteur puis agrégé, du Puy à Saint-Etienne, enfin à Nantes. Le fils est envoyé à Paris à 15 ans après l’histoire de femme revenue aux oreilles du proviseur qui a conseillé à son père d’éloigner le scandaleux. L’adolescent découvre Paris, la pension minable certes, où il n’est pris que pour gagner les concours comme un veau de comices, mais aussi les copains avec qui il sort au café et déambule sur les boulevards. Et puis le journalisme sous les traits d’un républicain farouche qui loge son ami de collège et avec qui il découvre le peuple révolutionnaire (qui ressemble aux siens) ainsi que les fracas et senteurs de l’imprimerie. Au bout d’un an, sa mère vient le chercher pour qu’il retourne à Nantes ; il a quelques duvets de moustache et a beaucoup grandi. Ses vêtements confectionnés à la maison dans des chutes de vieux tissus le rendent ridicule et il exige, cette fois contre sa génitrice, un costume sur mesure.
Il a trouvé à Paris comment briser les chaînes de servitude qui lient l’individu, la famille et la société, l’enfant dressé contre sa nature pour « arriver », l’éducation idéologique qui force l’adhésion sociale, les postes conquis par l’entregent et le piston. Tout cela est décrit en phrases simples, charnues, qui reviennent vite à la ligne. Une ironie féroce court dans les descriptions de maman, l’auteur affectant de prendre son parti tout en montrant ses ridicules prétentions en même temps que son illusion de bien faire son travail de mère en le taillant, le dressant et le corrigeant pour son bien.
Une grande œuvre sur un moment de l’éducation enfantine – mais aussi sur un moment de l’évolution sociale.
Jules Vallès, L’Enfant, 1876 revu 1884, Folio 2000, 416 pages, €7.50
Jules Vallès, Œuvres tome II 1871-1885, Gallimard Pléiade 1990, édition de Roger Bellet, 2045 pages, €72.00

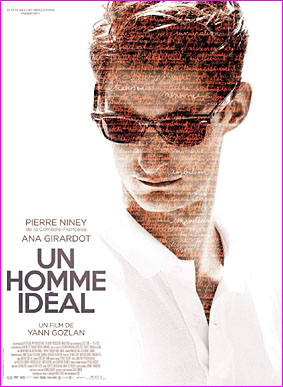





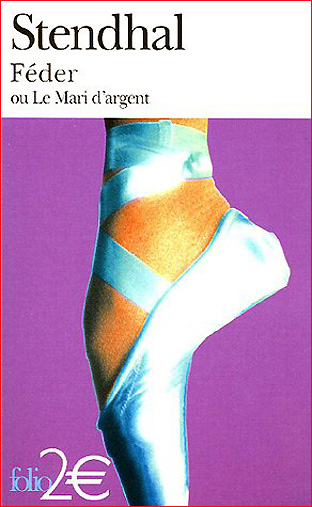
Commentaires récents