
Une insupportable pétasse (Cate Blanchett) envahit le spectateur dès la première scène en avion – en première classe. La prénommée Jeannette qui se fait appeler Jasmine par snobisme assomme sa voisine de son monologue psychotique sur sa vie passée de riche oisive tête de linotte. En fait, malgré le billet d’avion très cher de New York à San Francisco, ses bijoux, ses sacs Vuitton et son pourboire somptueux au taxi, la poulette est fauchée. Elle vient quémander auprès de sa demi-sœur l’hébergement après sa dépression, « le temps de se retourner ».

Rien de plus antagonistes que les deux sœurs. Autant la new-yorkaise blonde est égocentrée et futile, cachant son angoisse existentielle sous des dehors de grande bourgeoise artiste, autant l’autre, Ginger (Dally Hawkins) est brune, vive et pleine de bon sens. Autant Jeannette est ambitieuse, imitant sans personnalité et adoptant les rôles qui lui semblent requis au risque du boniment, rêvant du prince riche comme feu son mari et ne voulant d’enfants qu’adoptés, autant la san-franciscaine est réaliste, se contentant de ce qui est à sa portée, un emploi de vendeuse en supermarché et un mec dans le bâtiment ou meccano, avec deux garçons un peu gros et pas très beaux. Le snobisme bourgeois impérieux et futile ou la normalité – au risque de la vulgarité – est assumée avec bonne humeur. Le jour et la nuit : la vodka citron pour la blonde, le vin rouge ou la bière pour la brune.

Évidemment, rien ne va plus entre les deux sœurs de hasard. Dans le passé, Jasmine avait épousé un financier de haut vol qui gagnait des millions et envoyait son fils à Harvard, apaisant les éventuels scrupules de sa femme par des bracelets et des colliers, tout en sautant les autres filles qui passaient à sa portée. Devenu amoureux de l’ex baby-sitter, Hal (Alec Baldwin) a voulu divorcer. Crise de panique de la Jeannette larguée qui s’accroche à son mari et à son statut comme une huître à son rocher, incapable d’exister par elle-même. De rage, au lieu de consentir au divorce négocié qui lui aurait assuré une fortune, elle appelle le FBI pour dénoncer les malversations style pyramide de Ponzi qui ont permis à Hal (et à elle-même) de vivre sur un grand pied. Jasmine est coupable d’avoir conseillé à sa sœur Ginger et à son mari de l’époque Augie, qui venaient de gagner 200 000 $ au loto, de confier la somme à Hal pour investir dans des placements juteux « rapportant plus de 20 % par an ». Une démesure qui devrait alerter tout individu doué de raison lorsque l’inflation annuelle est à 2 %, mais la cupidité et l’ignorance sont les deux mamelles que tètent les escrocs à la Madoff. Hal, qui en est l’élève, est arrêté, il se suicide en prison ; son fils Danny (Alden Ehrenreich), qui faisait Harvard, interrompt ses études de finances ; il hait sa belle-mère et rompt tout contact avec elle. Jeannette a tout détruit de son château de cartes fortuné.

Elle ne peut que s’en prendre à elle-même et veut recommencer sa vie. Après avoir vendu des chaussures en boutique à ses anciennes invitées chics de Park Avenue, elle veut se lancer dans la décoration. Chili, l’amoureux de Ginger (Bobby Cannavale), que Jasmine a chassé de la maison alors qu’il devait s’établir en couple, l’aiguille sur le secrétariat médical d’un dentiste mais c’est trop vulgaire pour la fille. Elle finit cependant par consentir à ce poste qui demande de l’organisation et de l’écoute – ce qui est aux antipodes de sa personnalité et lui occasionne des migraines le soir.

Mais gagner de l’argent est indispensable pour prendre des cours de décoration. Ils sont moins chers en ligne mais, pour cela, il faut être à son aise dans le maniement d’un ordinateur. Il ne s’agit pas d’informatique mais de simple usage de bon sens. Jasmine prend donc des cours préalables dont elle ne comprend rien et qui ne lui servent à rien. D’autant que le dentiste lui fait des compliments de plus en plus pressants sur sa classe – les hommes sont toujours attirés par le snobisme des femmes, on ne sait pourquoi – et, après une pression plus physique que les autres, Jasmine quitte son emploi. Ginger est désespérée pour elle.

Dans la dèche mentale et économique, une amie des cours d’informatique propose à Jasmine d’aller avec elle à une fête « pour rencontrer du monde, et peut-être le prince charmant ». Encore un rêve qui débute et Jasmine s’empresse d’y aller, entraînant sa sœur qui veut bien s’amuser. Ginger y rencontre Alan (Louis C.K.), un ingénieur du son qui la fait vibrer et la baise plusieurs fois dans la soirée, insatiable, y compris plus tard sur le siège arrière de sa voiture (aux vitres teintées). Elle croit au grand amour et veut quitter Chili, « pas assez bien pour elle » selon Jeannette, sa demi-sœur qui détruit tout, mais il se révèle qu’Alan est marié et que sa femme Hellen sait tout ; ils ne doivent plus se voir et le rêve à deux s’interrompt.

Jasmine, quant à elle, rencontre Dwight (Peter Sasgaard), un riche diplomate qui va passer quatre ans en poste à Vienne avant de revenir à San Francisco, d’où il est originaire, pour se lancer en politique. Il vient de faire l’acquisition d’une belle villa en bord de mer avec des espaces intérieurs somptueux et une vue époustouflante. Jasmine, qui se présente comme décoratrice d’intérieure, veuve sans enfant d’un chirurgien décédé d’une crise cardiaque (que des mensonges pour mettre des talons aiguilles à son ego), paraît un beau parti pour le diplomate. Elle le séduit par son allure, ses compétences sociales et son tempérament artiste. Mais le rêve s’écroule une fois de plus pour la psychotique parce qu’elle a menti. Dans une rue chic de la ville, devant une vitrine de bagues en diamant pour les fiançailles, Jasmine se retrouve face à Augie (Andrew Dice Clay), l’ex-mari de Ginger ruiné par son mari Hal, qui lui rappelle crûment son passé. Le mari n’était pas chirurgien mais escroc, il n’est pas mort d’une crise cardiaque mais suicidé par pendaison, elle a un fils, même si ce n’est que son beau-fils qui ne veut plus la voir et s’est reconverti en vendeur de musique. Dwight rompt incontinent avec cette femme de carton-pâte. Le diplomate n’aime pas les apparences, il a soif d’authenticité.

Ginger se remet avec Chili, qui l’aime pour ce qu’elle est, alors que personne n’est capable d’aimer Jasmine, pas même ses neveux à qui elle inflige d’interminables monologues sur sa vie. Malgré la proposition finale de fête au champagne de Chili et Ginger, Jasmine retombée en Jeannette préfère la vodka brute et quitte la maison pour errer dans les rues. L’alcool et la folie l’accaparent progressivement, avec les rides et la déchéance qui viennent avec. Elle est seule, à jamais désespérément seule, à cause de son incapacité à s’accepter telle qu’elle est pour préférer le factice social.

Ce film féroce griffe sans pitié le snobisme new-yorkais des bourgeoises psychotique adonnées aux médicaments et à leur psy. Celles qui ne sont rien sans les attelles du social, sans un mari qui les entretient. En ces temps de féminisme radical, Woody Allen se venge des femelles qui voudraient bien mais ne peuvent pas. Des clampines, pas des copines.
DVD Blue Jasmine, Woody Allen, 2013, avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Andrew Dice Clay, TF1 Studios 2014, 1h32, €6,90 blu-ray €10,14

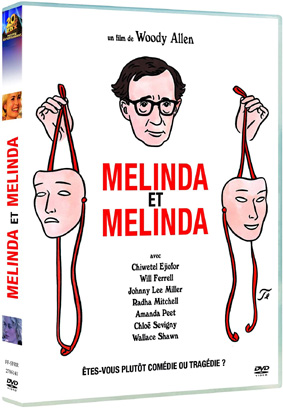


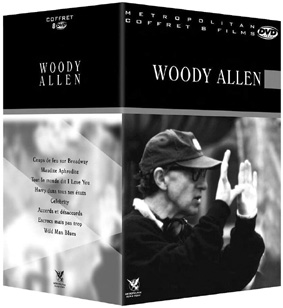





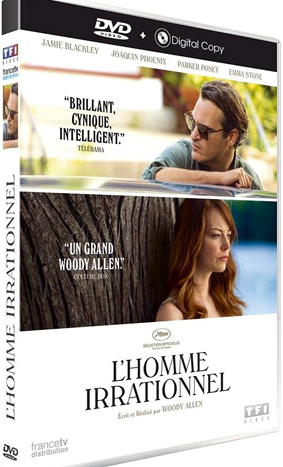



























Commentaires récents