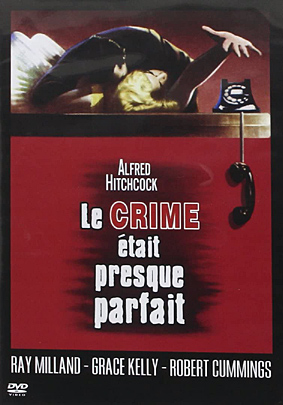
Tuer sa femme parce qu’elle a un amant et refuse de clarifier sa position est une tentation classique des années où le « mariage » était éternel et la « fidélité » jurée. Hitchcock en fait un moment de spéculation intellectuelle intense, fondé sur un imbroglio de clés.
Tony (Ray Milland) est un joueur de tennis anglais qui a arrêté sa carrière parce qu’il devenait trop vieux mais aussi parce que sa femme, qui a la fortune et entretient dès lors le joueur retraité, lui reprochait de ne pas s’occuper d’elle. Mais Margot (Grace Kelly) s’est empressée de nouer une liaison avec l’auteur de romans policiers américain Mark (Robert Cummings) et l’a rencontré plusieurs fois dans un studio de Londres où les gens les ont vus en ombres chinoises par les fenêtres jouer au couple. Un an plus tard, The Times annonce l’arrivée prochaine du paquebot Queen Mary avec, parmi les notables à son bord, Mark Halliday. Margot Wendice se réjouit.

Mais Tony le sait. Il sait aussi, par une lettre qu’il a découvert que sa femme est amoureuse de Mark et que c’est réciproque. Il sait donc qu’elle ment et le trompe effrontément ; et que son train de vie va lui être retiré sir elle le quitte. Il décide tout simplement de la tuer.
Il échafaude pour cela un plan machiavélique et soigneusement organisé. Trop – cela le perdra. Il contacte un ancien condisciple de collège, soupçonné jadis d’avoir piqué dans la caisse du club sans se faire prendre, et qui a fait ensuite de la prison comme escroc. Une courte enquête lui permet de voir qu’Alexandre Swan (Anthony Dawson) a agi sous plusieurs noms, dont le dernier est celui de capitaine Lesgate, et qu’il met par exemple en vente la voiture de sa patronne, une vieille riche, à son propre nom. Il le contacte donc pour cela, l’air de rien, et le met en conditions. Il lui fait lire la lettre amoureuse de Mark à Margot et lui propose 1000 £ (une grosse somme en 1954) pour tuer sa femme selon un plan préétabli.

Tout paraît simple. Tony va emmener Mark à un banquet d’anciens joueurs de tennis américains en visite à Londres, où il pourra rencontrer des compatriotes. Comme il s’agit d’un club d’hommes, les épouses et amies ne sont pas conviées. Margot va donc rester à la maison. Elle a envie de sortir, d’aller au cinéma, mais Tony la convainc que c’est dangereux le soir et qu’elle ferait mieux de classer les coupures de presse qu’elle a accumulé et dont elle repousse sans cesse la mise en album. Il lui sort pour cela ses ciseaux pointus de sa trousse à couture pour les mettre sur la table. Il en profite pour lui subtiliser sa clé de l’appartement, une simple clé plate, qu’il va placer discrètement sous le tapis de l’escalier qui fait face à la porte, afin que le tueur puisse entrer sans effraction.
Il a programmé 23 h pour le crime. Il doit alors téléphoner pour que Margot se réveille et aille se placer près du téléphone, dos aux rideaux de la fenêtre sur jardin. Alexandre, planqué là, n’aura plus qu’à l’étrangler. Mais sa montre retarde, il a plusieurs minutes de retard lorsqu’il prévient qu’il doit passer un coup de fil à son patron qui part le lendemain matin pour Bruxelles. Un homme dans la cabine du téléphone le retarde encore. C’est in extremis, à 23h07 seulement, qu’il parvient à appeler. Le tueur est sur le point de repartir, il a déjà ouvert la porte quand la sonnette grêle de ces années-là résonne dans l’appartement éteint. Il n’a que le temps de se filer derrière les rideaux.
Margot décroche, dit allô plusieurs fois mais n’obtient aucune réponse. Suspense, le tueur attend qu’elle libère son oreille pour lui passer les bas noués autour du cou. Mais elle s’obstine, redit allô plusieurs fois, hésite, baisse le combiné puis le replace pour dire encore allô. Enfin, elle raccroche et est aussitôt accrochée. Mais le tueur n’est pas habile, il serre mais pas assez fort ni assez brutalement. Elle se tord, roule sur le bureau. C’est là qu’en tâtonnant, elle saisit la paire de ciseaux et… lui enfonce dans le dos. Le tueur titube, la lâche, et s’écroule dos au sol, s’empalant de lui-même sur la lame. Il est mort.

Le meurtre de Margot a échoué et elle saisit le téléphone, resté décroché. Tony, qui a tout entendu de la lutte, parle enfin : qu’elle ne touche surtout à rien, qu’elle ne prévienne pas la police, il arrive. De retour, il prend la clé dans la poche du mort et la replace dans le sac de sa femme. Il place la lettre de Mark dans la poche du tueur, comprenant ses empreintes puisqu’il lui avait fait toucher. Il brûle le bas dont le tueur s’est servi pour en nouer deux autres appartenant à sa femme et en cacher un troisième sous le sous-main près du téléphone. Il peut ainsi attendre la police en s’assurant froidement que tout est au point.
Mais un inspecteur-chef moustachu et sagace (John Williams) fouine. Mark donne sa version, Tony aussi, son épouse Margot joue les victimes sous le choc. Mais puisqu’il n’y a pas effraction, c’est qu’elle a ouvert au tueur ; il voulait la faire chanter avec la lettre qu’il avait subtilisée dans son sac à main, volé quelques semaines plus tôt à la gare de Charing Cross – et récupéré aux Objets trouvés. Ce sont ses bas qu’elle a placés pour faire croire à l’agression et s’est elle-même infligé les marques sur son cou avec le troisième bas qu’elle a laissé sur le bureau avant de le planquer in extremis sous le sous-main. En bref, elle est condamnée pour meurtre et doit être exécutée.
La veille du jour fatal, l’inspecteur-chef revient. Il a poursuivi son enquête et quelque-chose le turlupine. Mark s’efforce de convaincre Tony de s’accuser de tout un scénario de roman policier pour sauver sa femme. Tony résiste mais ment lorsqu’il dit ne rien savoir d’une mallette bleue dont il aurait sorti des billets pour régler une dette de tailleur. Or la mallette est sur le lit de la chambre où Mark s’est caché lorsque l’inspecteur a sonné. Il soupçonne Tony d’être moins clair qu’il n’en donne l’apparence et révèle sa présence et la mallette pleine de billets. Les relevés bancaires de Tony font état de retraits peu élevés mais réguliers sur le compte, laissant imaginer un projet établi de longue date.

C’est alors que s’enclenche l’engrenage implacable du jeu de clés qui va compromettre Tony et prouver l’innocence de sa femme. Le plan pour la tuer était pensé, la contre-enquête est elle aussi pensée, comme un revers de balle au tennis. Ce qui compte est le calcul intellectuel, pas la passion, peu montrée entre les protagonistes. Il s’agit d’un assassinat plus que d’un meurtre, car il y a préméditation.
Le film a été tourné en relief stéréoscopique devant être projeté en lumière polarisée avec lunettes pour l’effet de relief. La version classique est publiée en DVD noir et blanc mais la version 3D (préférable) en couleurs.
DVD Le crime était presque parfait (Dial M for Murder), Alfred Hitchcock, 1954, avec Ray Milland, Grace Kelly, Leo Britt, Alfred Hitchcock, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson, Warner Bros 2005, 1h41, noir et blanc €7,26
Blu-ray et 3D en couleurs, Warner Bros 2012, €33,72






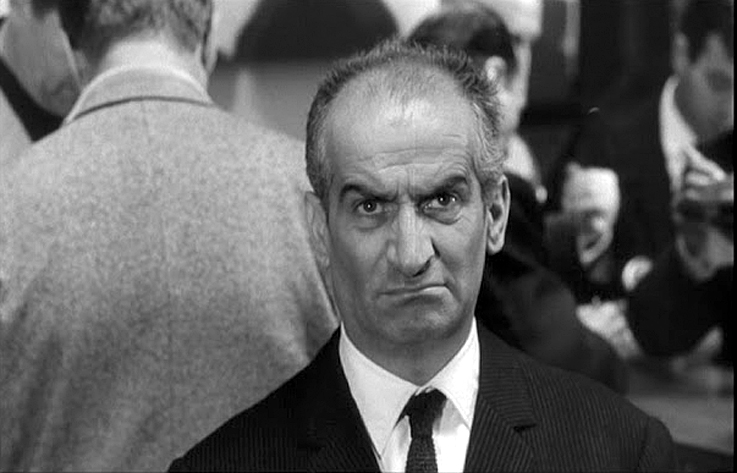



















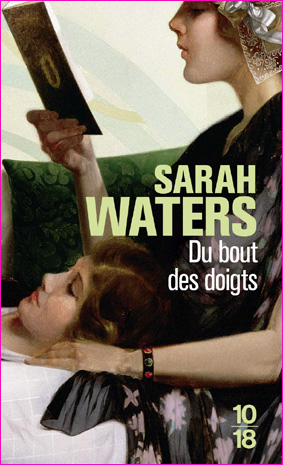
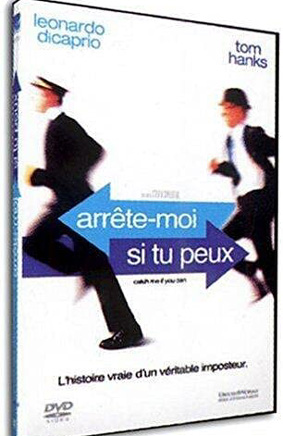


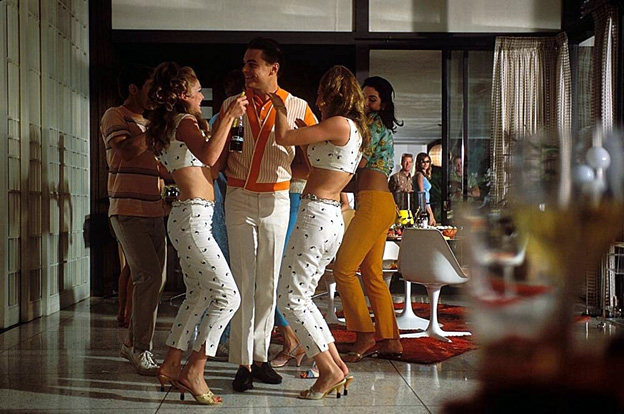


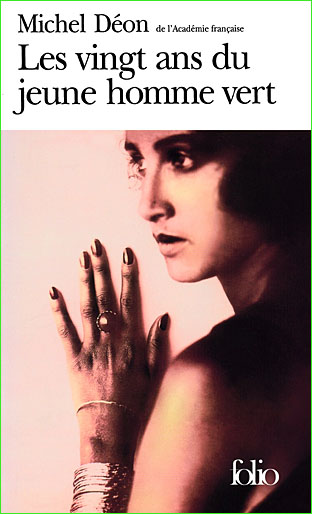
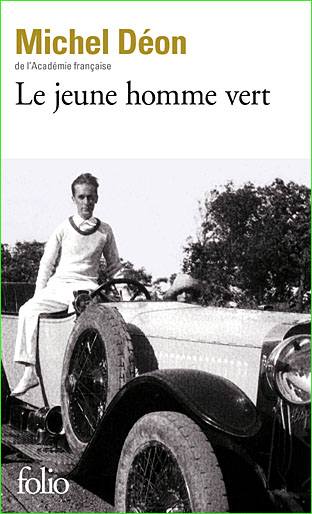



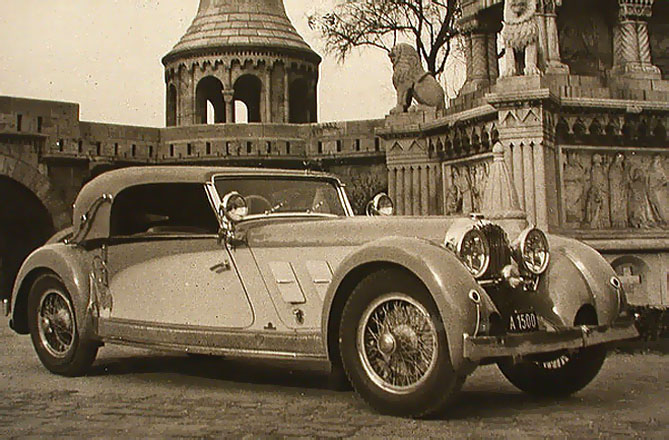
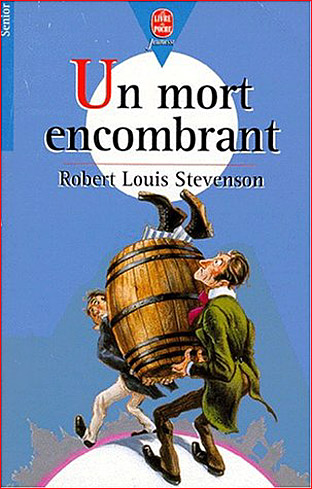
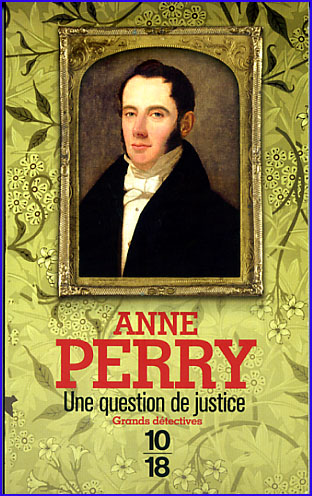
Commentaires récents