
A 33 ans, le narrateur juif, avocat travaillant pour la municipalité à promouvoir l’égalité américaine, entre en psychanalyse. Il veut se connaître. Enfance couvée, adolescence sexuellement rebelle, débuts dans l’âge adulte désastreux avec les femmes, son long monologue interpelle, gémit, proteste et souffre. Il est pathétique et comique, Alexander Portnoy, au prénom de conquérant goy blond et au nom juif quasi pornographique (porn toy ? jouet sexuel). C’est qu’il est partagé entre ses origines qui l’enchaînent dans la juiverie la plus repliée et son aspiration à intégrer le rêve américain.
Injonctions contradictoires issues de son éducation. « Les Juifs, je les méprise pour leur étroitesse d’esprit, pour leur bonne conscience, pour le sentiment de supériorité incroyable et bizarre que ces hommes des cavernes que sont mes parents et les autres membres de ma famille ont acquis Dieu sait comment – mais dans le genre clinquant et minable, en fait de croyance dont un gorille même aurait honte, les goyim [chrétiens] sont tout simplement imbattables. A quelle espèce de pauvre connards demeurés appartiennent donc ces gens pour adorer quelqu’un qui, primo, n’a jamais existé et qui, secundo, à supposer qu’il ait jamais existé, était sans aucun doute, vu son allure sur cette image, la grande Pédale de Palestine. Avec des cheveux coupés comme un page, un teint de Bébé Cadum – et affublé d’une robe qui, je m’en rends compte aujourd’hui, venait sûrement de Frederick’s of Hollywood ! [chaîne de lingerie féminine des années 40] Ras le bol de Dieu et de toutes ces foutaises ! A bas la religion et cette humanité rampante ! » p.374 Pléiade. Tout le monde en prend pour son grade, juifs comme chrétiens. Tous des croyants, tous des enchaînés pas près de se libérer, et qui enchaînent leurs enfants à leurs névroses. C’est truculent et libertin – mais pas faux.
L’auteur décrit l’Amérique des années 40 et 50, la juxtaposition des milieux qui se mélangent peu (l’apartheid envers les Noirs ne sera levé que dans les années 60). Il provoque par son déballage verbal, il est impitoyable avec les milieux sociaux, qu’ils soient WASP ou juif, il offre une satire de la psychanalyse de base posée comme réponse à tous les maux. Les critiques, souvent instinctives, émotionnelles et superficielles, confondent l’auteur et son personnage, le roman avec une confession. Mais la littérature sert justement à sublimer l’intime dans une fiction plus vraie que nature. Philip Roth est entré en psychanalyse de 1962 à 1967 après son divorce désastreux ; il a assisté au grand déballage polémique sur la guerre du Vietnam, la libération sexuelle, le Watergate. Lorsqu’il publie son roman, en 1969, il se lâche. Foin de l’hypocrisie, la vérité. Tout est bon à dire, même si ce n’est pas sa biographie. « Qui d’autre, à votre connaissance, a été effectivement menacé par sa mère du couteau redouté ? Qui d’autre a eu la chance d’être si ouvertement menacé de castration par sa maman ? Et qui d’autre, en plus de cette mère, avait un testicule qui ne voulait pas descendre ? Une couille qu’il a fallu amadouer, dorloter, persuader, droguer ! Pour qu’elle se décide à descendre s’installer dans le scrotum comme un homme ! Qui d’autre connaissez-vous qui se soit cassé une jambe à courir après les shikses (non juives) ? Ou qui se soit déchargé dans l’œil lors de son dépucelage ? Ou qui ait trouvé un véritable singe vivant en pleine rue de New York, une fille avec une passion pour La Banane ? Docteur, peut-être que d’autres font des rêves, mais à moi, tout arrive. J’ai une vie sans contenu latent. Le fantasme devient réalité » p.445. Voilà une vie en résumé plein d’humour.
Le personnage est issu du quartier populaire juif de Newark et grandit dans un appartement modeste entre une mère castratrice, un père constipé et une sœur effacée. Il est l’enfant-roi, le petit garçon à sa maman vers lequel tous les espoirs de réussite de la famille se portent. Ce cocon étouffant, ces parents tyranniques à force d’amour fusionnel, le font heureux durant l’enfance – qui a besoin de protection. Mais l’adolescent se révolte devant ce comportement de tortue en diaspora qui a une sainte terreur de toute souillure, de la nourriture comme du contact. L’obsession de la pureté engendre la névrose. Ce n’est pas qu’une névrose juive, mais elle est fort présente dans cette famille où la Mère régente sa maisonnée, rend impuissant le père, efface sa fille et menace d’un couteau son garçon lorsqu’il ne veut pas manger la nourriture issue de son propre sein. La rébellion pubère est de prendre le contrepied de tout cela : jaillir au lieu de retenir, manger dehors des mets interdits comme des hamburgers non kasher et des frites goy, partir en vacances avec une fille protestante à 17 ans, pour ses premières vacances universitaires…
C’est cocasse et émouvant, cet oisillon qui se débat pour sortir de sa coquille et émerger enfin à la lumière. Le sexe est au fond la seule chose qui lui appartienne, lorsqu’il est en âge de s’en apercevoir. Il patine sur le lac en poursuivant des filles goy à 13 ans, ému par leur blondeur et inhibé de les aborder – jusqu’à se casser une jambe – juste châtiment ! Il se masturbe plusieurs fois par jour, d’une inventivité fiévreuse pour son plaisir, tronchant une tranche de foie de veau derrière un panneau dans la rue, puis chez lui dans le frigo (avant de la manger benoitement en famille au dîner), violant une pomme évidée ou une bouteille de lait au goulot graissé, éjaculant dans son gant de baseball au cinéma ou dans une chaussette dans son lit… Les titres des chapitres sont édifiants, volontairement immergés dans le foutre : La branlette, Fou de la chatte.
Mais les lecteurs qui s’arrêteraient au sexe ne comprendraient pas le roman.
Si les rabbins se déchaînent à la sortie du livre, c’est que l’auteur juif traite du monde juif et de son intolérance, de sa mentalité de ghetto. Même en Israël, où le personnage voyage et découvre avec émerveillement que « tout le monde est juif », les mœurs sont intolérantes : la kibboutzim sportive et volontaire qu’il rencontre le rend impuissant parce qu’elle exsude le moralisme militant – comme sa mère à Newark une génération avant.
Si les psychanalystes se déchaînent, c’est que l’auteur montre combien les psys sont des acteurs avides d’argent plutôt que de cure : son Spielvogel (au nom qui signifie jouer avec son oiseau) a un accent germanique yiddish et garde le silence (car le silence est d’or). Pirouette ultime, la dernière phrase du livre incite le personnage à tout reprendre car, après la diarrhée verbale (celle que son père n’a pas su provoquer), le travail peut commencer.
Si les confrères écrivains se déchaînent, c’est que l’auteur montre l’autre face de l’Amérique, son hypocrisie coincée entre grands principes et mots généreux – mais la réalité tout autre. Le style oral choisi par Philip Roth est en écho au stade oral de Freud (le personnage n’aime rien tant que de se faire sucer) et à l’obsession maternelle de lui faire ingérer sa nourriture. « Pourquoi donc, je vous le demande, toutes ces règles et ces interdits alimentaires, sinon pour nous exercer, nous autres, petits enfants juifs, à subir la répression ? » p.303. L’oralité est censée lever les tabous, curer par la parole, déballer les complexes. La « libération » des déterminismes biologiques, familiaux, ethniques, culturels, va-t-elle intervenir ?
Le sexe pousse à s’ouvrir à l’autre, à entretenir des relations. C’est pourquoi la masturbation adolescente est une impasse, engendrée par la névrose de la mère juive castratrice hantée de souillure. Baiser à couilles rabattues – et si possible des shikses (femelles non juives) – est une conquête de l’Amérique. Ce pourquoi le personnage va en enfiler une brochette représentative : Kay au grand cœur et gros cul dite la Citrouille, Sarah l’aristo de Nouvelle-Angleterre dite la Pèlerine, et Mary Anne la vulgasse illettrée issue de culs terreux de l’Amérique agricole. Que des blondes, que des White Anglo-Saxon Protestant (WASP). L’alternative aurait été d’épouser une juive de sa rue et de reproduire indéfiniment le schéma familial : épouse fidèle gardienne des traditions juives, flopée de gosses juifs, partie de softball le dimanche matin avec les hommes juifs du quartier juif.
Dans ce roman passionnant, écrit comme un monologue par associations et qui se lit fluide, l’auteur nous fait aimer ce monde juif new-yorkais et son personnage désemparé de devoir se débattre dans toutes ces contradictions. Rabelaisien en prouesses sexuelles, il est aussi psychologue, dressant un portrait soigné d’un névrosé qui cherche à en sortir, et sociologue, sur une certaine Amérique moyenne où chacun cherche à se différencier par affirmation de son milieu. Contre l’esprit de sérieux, mais avec profondeur, ce roman est profondément réjouissant.
Philip Roth, Portnoy et son complexe, 1969, Folio 1973, 384 pages, €6.66
Traduit sous le titre La plainte de Portnoy dans l’édition Pléiade : Philip Roth, Romans et nouvelles 1959-1977, Gallimard Pléiade édition Philippe Jaworski 2017, 1204 pages, €64.00
Philip Roth sur ce blog

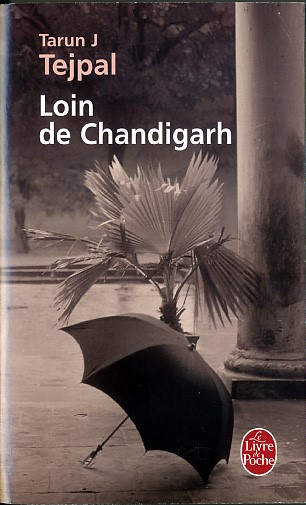




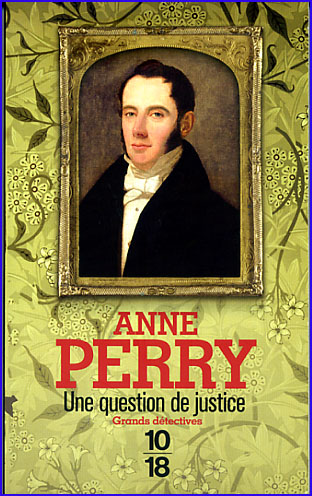





Commentaires récents