
Livre bariolé, fait de pièces et de morceaux, il s’agit d’un recueil d’essais et de poèmes en prose publiés dans diverses revues. Colette s’y cherche, sa vie change, Willy s’éloigne. Femme séparée, saltimbanque, lesbienne, Colette est réprouvée par la « bonne » société et fait front.
Elle utilise pour cela le procédé de Marcel Schwob, l’un de ses contemporains, de faire parler des animaux. C’est le dialogue entre Toby-Chien et Kiki-la-Doucette, chatte. Mais aussi une « rêverie de Nouvel An » pour faire le bilan du passé. « Nuit blanche » et « Jour gris » se succèdent devant le « Dernier feu » pour parler des « Amours » et d’« Un rêve ». Il faut faire face, se masquer, d’où « Maquillages » et « Belles-de-jour » pour se demander « De quoi est-ce qu’on a l’air ? » et s’en foutre. Donc la « Guérison », le « Miroir » où Colette se mire en Claudine, la « Dame qui chante » et la « Partie de pêche » en « Baie de Somme » où la célibataire invertie esseulée contemple les familles à marmaille et les enfants patauds comme de petits animaux. Pas son truc à Colette, elle préfère « Music-halls », ce qui termine le recueil.
En vingt textes hétéroclites mais finalement organisés, on s’en aperçoit a posteriori, Colette se précise. En 1908, Sidonie-Gabrielle a 35 ans, l’âge mûr, le début de la fin pour la femme dont l’acmé se situait selon Balzac, auteur chéri de Colette, à 30 ans. L’immoraliste gidienne féministe, fille de capitaine d’Empire, fait le bilan. Le rossignol ligoté par les vrilles de la vigne est cet amour hormonal de la jeune adolescente romantique, emportée par son lyrisme et tombée « amoureuse » sans savoir ce que c’est, qui se retrouve ligotée à un mari par les liens du mariage, « les pattes empêtrées de liens fourchus, les ailes impuissantes… » La jeune fille, naïve rossignolette, « crut mourir, se débattit, ne s’évada qu’au prix de mille peines, et de tout le printemps se jura de ne plus dormir, tant que les vrilles de la vigne pousseraient » p.959 Pléiade.
Pour résister à la tendance naturelle féminine à se laisser faire par les hommes, à se laisser emprisonner par les convenances, à se laisser être conforme au miroir de la société, une seule façon : élever la voix. Écrire, chanter, s’exprimer. « Pour me défendre de retomber dans l’heureux sommeil, dans le printemps menteur où fleurit la vigne crochue, j’écoute le son de ma voix… » p.960.
Colette, Les vrilles de la vigne, 1908, Livre de poche 1995, 125 pages, €2,00 (Amazon indique un prix faux) ; e-book Kindle €0,94
Édition pédagogique Bac 2023, Sido suivi de Les vrilles de la vigne, Livre de poche 2022, 384 pages, €6,20
Colette, Œuvres tome 1, Gallimard Pléiade 1984, 1686 pages, €71,50
Colette sur ce blog


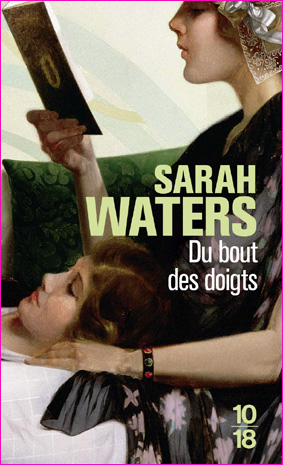
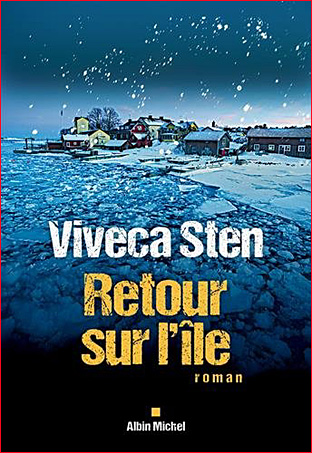
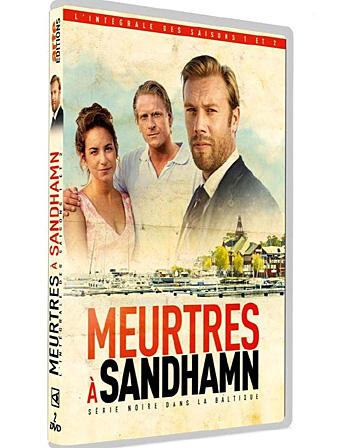
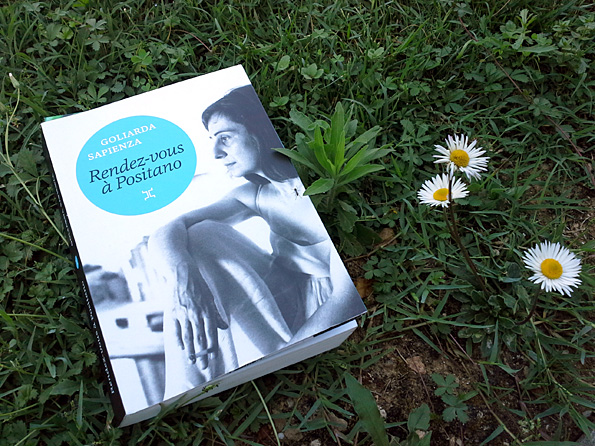
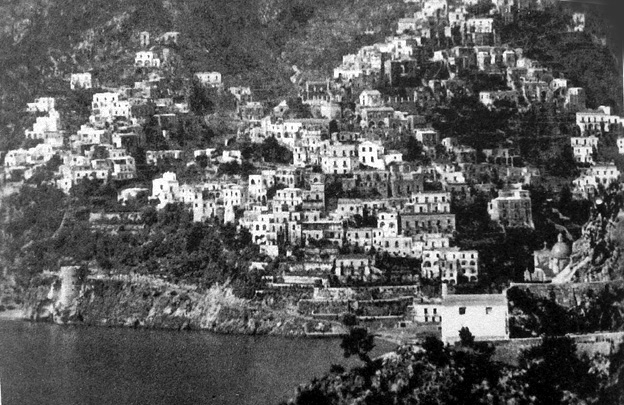


Commentaires récents