
Eric Blair a passé cinq ans comme fonctionnaire de police anglais en Birmanie, province de l’empire. Il prend le pseudonyme de George Orwell pour son premier roman par devoir de réserve, change les noms des lieux et des personnages par souci d’éviter toute diffamation, et son éditeur remplace les mots d’argot qu’il cite par des étoiles. Les années trente du siècle dernier sont en effet très peu libérales pour l’expression, d’autant plus qu’une guerre idéologique commence au Royaume-Uni entre « le socialisme » et le conservatisme de classe moyenne. La révolte est issue de la révolution bolchevique en Russie et des jeunes hommes en colère après la boucherie de la « Grande » guerre qui a vu les vieux planqués sur l’île et les meilleurs des jeunes mitraillés ou gazés sur le continent, les « stratèges » galonnés faisant bon marché de la vie humaine. Pour eux, tout est à passer par-dessus bord : le patriotisme, l’empire, le conservatisme autoritaire, la morale austère, le mépris social…
A 19 ans, après le collège d’Eton, le jeune Blair s’est engagé dans l’administration pour travailler et il s’élance sur les traces de son père, ancien fonctionnaire de l’Indian Civil Service. Il est nommé en Birmanie, province du Raj, mais si le pays le séduit, l’impérialisme le rebute. Le snobisme de classe très présent en Angleterre se transforme ici en racisme de caste entre Blancs et « Nègres » birmans. C’est non seulement la couleur de peau qui diffère mais l’odeur, la cuisine, les coutumes, l’usage d’aller presque nu. Les Anglais, même de basse extraction, se sentent supérieurs parce qu’ils portent chapeau et sortent cravatés, et occupent des fonctions de commandement dans la police, l’administration, l’exploitation forestière. Le club est le lieu de l’entre-soi où chacun se conforte en vieille Angleterre et se défoule sur les moricauds.
Le roman est celui de la déchéance morale de l’Anglais condamné à la solitude loin de chez lui et qui ne se trouve en accord ni avec la nature environnante ni avec sa propre nature. Une vraie thèse marxiste avec pour horizon l’utopie quasi « écologiste » du chacun adapté à son milieu en fonction de son éducation. Orwell brosse quelques caractères sommaires et une intrigue amoureuse des plus décevantes entre John Flory, 35 ans, chef d’exploitation forestière et Elisabeth, bécasse de 22 ans tout juste sortie de Londres après avoir perdu ses parents. John est un minable, un perdant ; Elisabeth est une snob pétrie de préjugés de classe et d’ailleurs déclassée. Depuis qu’elle a suivi deux trimestres de scolarité d’une école privée chic, elle sépare moralement le monde entre « infect » et « charmant ».
John tente de se libérer de lui-même mais reste englué dans sa mouise faite du pays occupé sans avenir, de sa profession d’exploiteur, de son milieu étroit et fermé, et de son physique repoussant à ses propres yeux avec son angiome au visage. Il est dominé par sa biologie (l’appartenance à la « race des maîtres »), par son physique (la tache sur la joue, son âge), par son milieu (colonialiste), par sa culture (inadaptée à la pimbêche qu’il désire – faute de mieux). Le déraciné est un raté qui ne pourrait se sauver qu’en rentrant au pays pour y commencer une nouvelle vie, mais le destin l’en empêche une fois et sa lâcheté l’empêchera de recommencer. Il croit se sauver alors par l’amour mais il lui sera refusé par la rigidité sociale. Ne lui reste alors que l’ultime évasion, une lâcheté de plus mais qui est le destin de ceux qui se trouvent enfermés sans pouvoir en sortir.
Ami du docteur indien Veraswami avec lequel il peut avoir des conversations intéressantes, Flory subit la médiocrité des vicelards du club qui éclusent force gin et whisky entre deux putes locales et insultes aux indigènes. Le magistrat birman obèse U Po Kyin, qui veut avoir du pouvoir après avoir obtenu l’argent use de la même corruption pour devenir membre du club des Blancs. Pour cela, il fait inonder les Anglais de lettres anonymes dénonçant le docteur indien, de grade plus élevé que lui, et fomente une machination pour perdre de réputation John Flory qui le soutient. Rien de mieux qu’une pute répudiée pour faire éclater un scandale sexuel en pleine messe, ce qui est le summum de l’horreur pour les bigots superstitieux du convenable dans le milieu anglais. Car les Blancs en pays hostile doivent se tenir les coudes et penser d’une seule façon. John, qui rêvait d’épouser Elisabeth, fille à marier dont l’oncle et la tante voudraient se débarrasser à tout prix avant que sa date de péremption soit passée, connait des hauts et des bas avant le désastre.
Car la fille est sotte, un véritable portrait vu par un collégien d’Eton élevé entre garçons. Elle est inconsistante et sans culture, préférant les livres légers à la mode aux classiques, détestant tout ce qui est « intellectuel », même la poésie, et ne rêvant que de bras mâles pour une vie coloniale de chasse loin de la saleté indigène. Malgré les accès de virilité de John qui la sauve d’un buffle, l’emmène chasser le léopard, puis sauve le club d’une émeute indigène, elle flirte avec l’Honorable lieutenant Verrall venu passer un mois en mission armée pour mater une éventuelle révolte. Car John aime le bazar coloré indigène, les fêtes et danses des villages, la beauté des corps (surtout masculins) et l’entraîne malgré elle dans la promiscuité « sale », aux odeurs fortes (une obsession de l’ail chez Orwell), au milieu des haillons et de la marmaille nue et de l’adolescence gracile. Au contraire, le lieutenant blond virevolte sur sa jument arabe comme un centaure svelte et musclé, sans se mêler aux indigènes ni même aux membres du club dont il méprise la basse extraction, l’esprit aussi étroit que les autres blancs mais polarisé sur le polo, cueillant les filles comme des fleurs en chemin, trop snob pour songer à se fixer avec une petite-bourgeoise quelconque comme Elisabeth.
C’est un climat colonial daté et un microcosme anglais particulier que décrit Orwell dans ce premier roman vigoureux et réussi (qui n’est pas son premier livre publié). Sa description du lever de soleil, de la clarté du matin, des fleurs proliférantes, des oiseaux beaux comme des émaux, du bain nu dans un ruisseau limpide de la jungle est d’une sensualité qui tranche avec l’atmosphère renfermée, alcoolisée et aux pensées aigries du club des Blancs. Ce livre est une expiation, une purge de souvenirs, un tombeau pour l’empire plus qu’une nostalgie ; Orwell se veut un anti-Kipling car, selon lui, l’oppression crée l’hypocrisie, ce qui corrompt l’âme.
George Orwell, Une histoire birmane (En Birmanie – Burmese Days), 1934, 10-18 2001, 357 pages, €9.20
George Orwell, Œuvres, édition de Philipps Jaworski, Gallimard Pléiade 2020, 1599 pages, €72.00



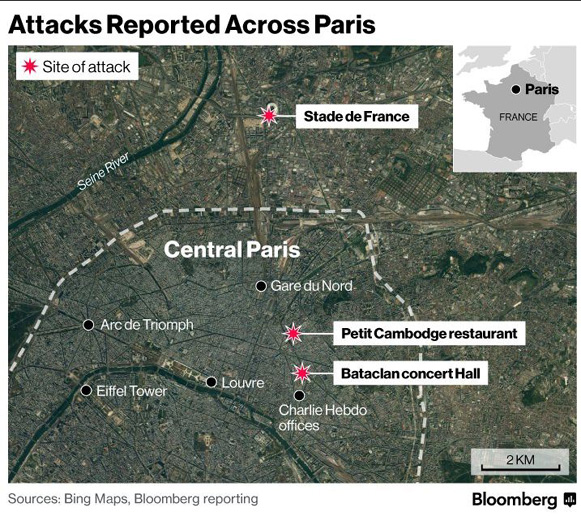
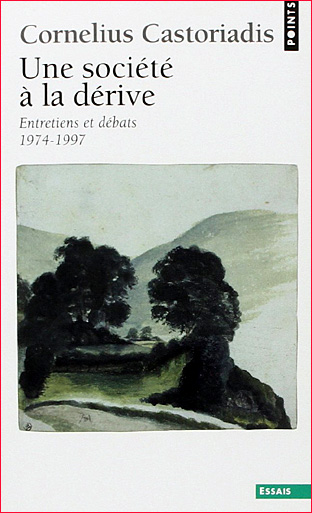


Commentaires récents