Les Cinque Terre sont à peine mentionnés dans le Guide bleu des années 1990, ils sont à la mode aujourd’hui. Le problème des Cinque Terre est que les atteindre ressort du parcours du combattant. Pas moins de 12 heures en trains divers avec attentes entre les lignes.
Je me lève à 5 h pour le TGV Paris-Milan qui met 7 h pour arriver à Milan, Piazza Garibaldi. Il faut aller à pied à la gare de Milano Centrale, une horreur mussolinienne massive à allure de blockhaus, entre les grands immeubles de verre et les rues tortueuses de la modernité. Le temps d’attraper un Milano-Genova qui, après 1h20 d’attente, traversera les montagnes sur ponts et sous tunnels en 1h30. Avant d’attendre plus d’une heure encore un train local pour Deiva Marina, à proximité du parc national où se trouve l’hôtel. Je n’arriverai que vers 19h30 ! Le train est cependant bien moins cher que l’avion pour la période.
Le TGV est confortable, le Milano-Genova archaïque avec ses compartiments, le train de la côte moderne, sorte de RER à locomotive électrique. Si le TGV est calme, à cause de l’heure matinale en ce dimanche, le train pour Gênes est lent et s’arrête partout. Mon compartiment est tout entier étranger : deux Suédois et trois Lithuaniens en plus de moi, Français. Les Suédois sont un couple mûr dont la dame lit un roman policier américain traduit en sa langue (Harlan Coben), tandis que Monsieur feuillette un manuel de traduction italo-suédois. Les Lithuaniens sont un couple avec une fille de 15 ans très sage ; je lis le nom du père sur le billet électronique imprimé via Internet. De part et d’autre de notre compartiment calme, deux compartiments bruyants et agités de ragazze e ragazzi revenant d’un tournoi de basket, à ce qui est inscrit sur leurs maillots ou débardeurs bleus. Filles et garçons de 13 ans sont accompagnés d’un coach qu’ils appellent familièrement zio, oncle. Ils sont bronzés, dénudés, shorts courts et débardeurs lâches, bien vivants.
Le tortillard qui enfile les stations entre Genova Piazza Principale et Deiva Marina, en s’arrêtant partout, est en retard d’une dizaine de minutes. Les arrêts durent longtemps, même quand il y a peu de monde à monter ou descendre. Autour de moi, une famille allemande avec trois enfants dans les 14, 11 et 9 ans (difficile de donner un âge aujourd’hui où les enfants grandissent ou retardent plus qu’auparavant). Les accompagne un quatrième, un garçon de 15 ans aux épaules carrées et au ventre en béton, qui doit être le petit copain de l’adolescente. Ils se mignotent trop pour être même cousins. Le papa est branché avec plusieurs boucles à l’oreille, la chemise ouverte sur le tee-shirt et une casquette de tankiste. Il est rare de nos jours d’avoir l’occasion de rencontrer une famille allemande avec plusieurs enfants. C’est dommage, car les gamins allemands sont beaux et vigoureux.
A mon arrivée, tardive, l’hôtel Eden est facile à trouver, à deux ou trois cents mètres de la gare ; encore faut-il prendre la bonne sortie (côté mer) et enfiler la bonne rue (celle de droite). Je demande dans un bar dans mon italien un peu remis à neuf avant le départ. Le dîner du nouveau groupe est à 20h et j’ai le temps de m’installer dans la chambre pour trois et de me rafraîchir rapidement avant de rencontrer les autres.
Nous sommes huit dans le groupe, plus la guide italo-française Eva, trois garçons et cinq filles – tous d’âges plutôt mûrs, difficulté et période obligent. Je serais venu en juillet-août, il y aurait eu des familles ; la rentrée scolaire a lieu en France dans deux jours et les familles ont déserté les circuits.
Nous dînons dans le restaurant de l’hôtel, plus réputé que les chambres, et qui est plein tous les soirs. Deux plats de pâtes nous sont proposés, spaghetti et farfale, les premiers à la tomate et les seconds aux légumes, puis deux plats de viande, filets de poulet grillés et tranches d’espadon grillées, accompagnés d’une salade verte, tomates et carottes râpées. Le dessert est un sorbet citron très liquide, servi en flûte.
Il a fait beau toute la journée mais un orage tonne vers minuit et nous apprendrons le lendemain qu’il est tombé des torrents de pluie durant la nuit. Ce sera la seule ombre au séjour, il fera désormais beau jusqu’à notre départ, le soleil ne recommençant à se voiler que ce jour-là.
Après dîner, nous visitons le vieux village de Deiva Marina avec Eva, ce qui est assez vite fait dans la nuit. L’église San Antonio Abate (1739), les ruelles, les gamins jouant encore dans les rues après 22 h (l’école ne reprend que vers fin septembre), les sangliers dans la bambouseraie qui borde la rivière. Nous ne voyons pas le couple d’émeus que la municipalité a acheté aussi pour l’attraction. Malheureusement, et par ignorance, ils ont pris un couple du même sexe !
Il n’y a rien à faire lorsqu’on a dépassé l’âge du jeu innocent entre copains, dans cette petite ville balnéaire qui ne vit guère qu’en été. Les gars se tatouent les bras et les épaules comme le jeune serveur du restaurant, se mettent des boucles à l’oreille, se parent de médailles et colliers, se moulent dans de fins tee-shirts pour accentuer leurs pectoraux secs et leurs abdos quasi absents – tout cela pour se faire remarquer, exister, parfois draguer.
Le soir suivant, le plus jeune des serveurs, peut-être 18 ou 19 ans, a été complimenté par un client dans la trentaine à tel point qu’il a tenté même de lui caresser la tête. Ce geste a été vite contré par la main du jeune homme, qui l’a converti en poignée de main, mais avec les joues rougissantes et les bras mis en croix sur la poitrine en geste de refus. Les Italiens parlent beaucoup avec leur corps.
Suite lundi.






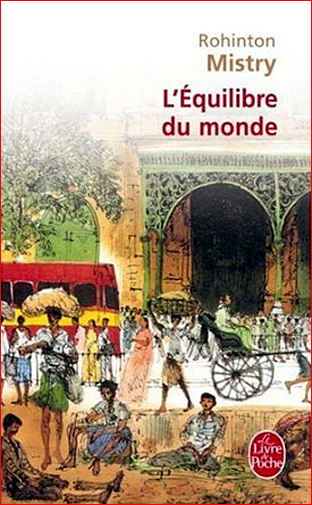





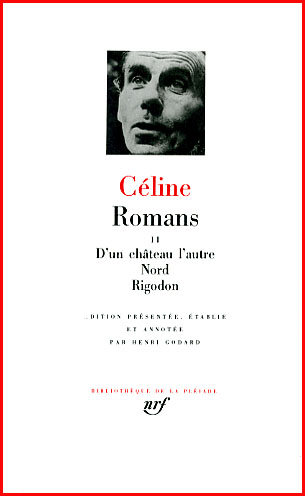
Commentaires récents