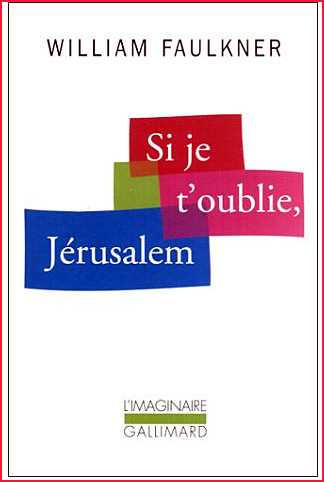
Deux histoires s’entremêlent, celle d’un étudiant en médecine et de son amante mariée, celle d’un grand forçat et de la femme enceinte qu’il a récupérée en barque lors d’une inondation du Mississippi, le Vieux Père. Deux histoires de paradis perdu où la Femme est la tentatrice, le serpent diabolique qui fait sortir des rails ; deux histoires de destin biblique où ce que Dieu a écrit ne peut être transgressé.
Ce roman très américain, assez loin de nos conceptions du monde en Europe, est marqué de l’empreinte juive d’Ancien testament, une force qui vous dépasse, une obsession à l’amour qui vous emporte, des lois suprêmes qui s’appliquent, implacables. Il n’est pas pour moi parmi les meilleurs romans de Faulkner : trop messianique, trop névrosé, trop moralisateur.
Harry et Charlotte se veulent des êtres libres, animés seulement par l’amour ; l’argent ne compte pas, ni le métier qu’ils font, ni le regard social des autres. Sauf que la vie ne supporte pas l’insouciance ; lorsque l’enfant paraît (est sur le point de paraître), tout ce qui fait les nécessités de l’existence se révèle indispensable : l’argent, le métier et le regard social des autres. Médecin inachevé, Harry croit posséder la technique, mais agir sur qui l’on aime inhibe la raison professionnelle : il rate son avortement et fait mourir son amante. Il sera condamné par le peuple avant de l’être par le tribunal provincial, puis par Dieu dans l’au-delà probablement.
Le forçat, lors de la grande inondation du delta, a pour mission de prendre une barque pour aller récupérer les habitants réfugiés dans les arbres. Cette aventure, analogue à celle de l’existence, le fait errer, quasiment se noyer, recueillir une femme enceinte, faire du feu et récupérer de la nourriture pour le bébé – en bref « mener sa barque » pour passer l’épreuve. Tous survivent, mais lui, le grand forçat, n’aspire qu’à retrouver le paradis tranquille de sa vie recluse en pénitencier. Il se rend, accusé d’avoir tenté de s’évader, et en prend pour dix ans de plus.
« – Les femmes ! Font chier » fit le grand forçat. » Telle est la dernière phrase du livre, celle qui avoue combien le Serpent induit en tentation, combien Lilith fait perdre aux mâles toute raison, combien Faulkner a été tourmenté par sa femme et ses amantes à l’époque de l’écriture.
Harry a refusé la vie, le grand forçat l’a accueillie ; mais aucun des deux n’en veut. Ils sont trop bien entre hommes, en hôpital réglé comme un monastère ou en pénitencier sécurisé. Malgré la femme et la fornication, chacun aspire à retourner au ventre maternel où tout est réglé pour vous. Comme c’était mieux avant ! Quand aucune responsabilité n’exigeait d’eux la décision et le courage. La liberté est une prison ; la prison rend libre. C’est ce que clamait Sartre sous l’Occupation (ce chantre de l’Engagement qui ne fut « résistant » qu’à la toute dernière heure) ; c’est ce qu’ironisait George Orwell du modèle soviétique dans 1984 : la liberté c’est l’esclavage !
« Si je t’oublie, Jérusalem », chantaient les Hébreux dans les geôles et l’exil à Babylone, selon le Psaume 137. Faulkner avait voulu ce titre pour l’entrelacs des deux histoires sans rapports apparents, Les Palmiers sauvages et Le Vieux Père, mais l’éditeur américain a choisi initialement les palmiers. Il est vrai que l’arbre sec, obstinément tendu vers le soleil contre cyclones et inondations, est une métaphore du vieux Sud. Mais vouloir vivre obstinément, n’est-ce pas orgueil insupportable à la face de Dieu pour les croyants trop raides ? « Cela dépasse les bornes ! Il y a des règles, des limites ! À la fornication, à l’adultère, à l’avortement, au crime – et ce qu’il voulait dire était – À la part d’amour, de passion et de tragédie qui est accordée à chacun à moins de devenir comme Dieu Qui a souffert également tout ce que Satan a pu connaître » p.201 Pléiade.
Pas trop long malgré quelques longueurs, violemment misogyne malgré ses beaux caractères de femmes, ancré dans la boue sudiste comme dans l’âme rigide et donneuse de leçon de ses habitants, ce roman faulknérien en diable peut encore se lire, surtout pour comprendre tout ce qui nous sépare aujourd’hui de ces modernes Texans et sudistes, lecteurs de Bible.
William Faulkner, Si je t’oublie Jérusalem (The Wild Palms), 1939, Gallimard L’Imaginaire 2001, 364 pages, €9.90
William Faulkner, Œuvres romanesques tome 3, Gallimard Pléiade, 2000, 1212 pages, €66.00



Commentaires récents