Nous quittons Tachkent et sa chaleur humide pour la climatisation du bus. C’est un Mercedes acheté d’occasion à une compagnie de bus française. Il a été bien révisé par les mécaniciens bricoleurs d’ici. 330 km de route nous attendent pour rallier Samarcande, deuxième ville d’Ouzbékistan, mais avec 400 000 habitants seulement, un tiers de la capitale. Samarcande signifie « la grosse ville », « la ville riche ». Elle était le centre de la Sogdiane, ce pays prospère préislamique, célèbre pour son art de la poterie. Le vent du nord ne rencontre aucun obstacle sur les plaines. Il fait donc froid l’hiver, -15° en moyenne, mais très chaud l’été, +45°. Il pleut au printemps.
L’été brûlant de la steppe incite les gamins à se baigner dans les rigoles boueuses le long des routes. Elles sont peu nombreuses ces rigoles, en général vouées à l’irrigation, et chacune d’entre elle attire inévitablement sa brochette de corps dorés qui en ressortent luisants comme des scarabées. Un adolescent en slip, assis sur le bord en ciment du canal qui amène l’eau précieuse aux champs de coton, surgit telle une statue de Tireur d’Epine. Il a le corps de bronze, le dessin nerveux des muscles et l’attitude apollinienne qui convient. Une grosse médaille d’or étoile sa gorge vernissée du bain. Les fillettes ne sont pas conviés par leurs frères à ces agapes du soleil et de l’eau. La plaine est composée de champs cultivés, parfois d’arbustes. Des vaches noir et blanc, quelques chevaux à la longe, broutent l’herbe rase. Le réseau routier est en piteux état en raison des variations climatiques et du manque d’entretien, mais il est peu encombré.
Depuis l’horizon, je vois se lever un voile dans le ciel. Il accourt d’autant plus vite que nous fonçons à 100 km/h droit vers lui. C’est une brutale pluie d’orage. Brève et violente, elle fait retomber la poussière, claque la peau nue des gosses et favorise la pousse du blé. Tel Gribouille, les gamins ne sortent pas de leurs rigoles pour s’abriter de la pluie : ils s’y plongent au contraire jusqu’aux yeux, avec délices, pour échapper aux traits piquants des gouttes agressives.
Nous voici en pleine « steppe de la faim ». Nous devons la traverser pour arriver à Samarcande. Son nom lui vient du manque d’eau qui l’a rendue longtemps non cultivable. Et ce jusqu’aux grands travaux khrouchtchéviens. Bien peu écologiques, ces travaux ! Louable était l’intention, il s’agissait de permettre la culture du blé et du coton et ce fut réussi. 12 000 km² de canaux furent creusés à force pour détourner l’Amou-Daria il y a 50 ans, dont le canal Karakoum qui amène 17 km3 d’eau douce par an sur 1300 km. Mais ce prométhéisme marxiste n’est pas resté sans conséquences : le Syr-Daria n’arrive plus à la mer d’Aral au nord de l’Ouzbékistan et celle-ci s’assèche. Sans parler du gaspillage de l’eau entre évaporation intense de tous ces canaux, déperdition des conduites, arrosages de lieux non cultivés, offre trop abondante pour les besoins réels… Seulement 55% de l’eau collectée servirait vraiment aux plantes ! On mesure les ravages de la bureaucratie d’Etat dans l’irresponsabilité et le je-m’en-foutisme, le monopole du Ministère de l’Eau aux temps soviétiques empêchant toute initiative locale et estampillant toute objection comme « politique » !
Certes, la production agricole a été multipliée par quatre entre 1950 et 1980, les légumes sont plus abondants de près de sept fois depuis 1960, la viande est produite deux fois plus, le lait trois fois, et ainsi de suite. Mais à quel prix ! L’idéologie productiviste fait peu de cas du support matériel, selon la mauvaise habitude marxiste, accentuée par l’activiste Lénine. C’est l’une des causes de la chute de l’URSS, avec Tchernobyl. La science à la soviétique était rendue tellement administrative, liée aux clans du pouvoir et à l’esprit boutique du Parti, qu’elle ne servait plus guère à « étudier la nature » mais à conforter l’ego des dirigeants.
La mer d’Aral s’étendait sur 68 000 km² en 1960, sur la moitié seulement en 2000. Au début 1990, le niveau avait perdu 14 m depuis 1960 et sa surface s’était réduite de 28 000 km², soit 40% de sa surface. La salinité de l’eau avait été multipliée par trois, tuant les poissons, et réduisant la pêche à rien dès 1979. Plus de caviar, dont la région produisait pourtant 10% de la production totale de l’URSS ! Les roseaux sont passés d’un territoire de 8000 km² à 200 km², 38 des 178 espèces animales subsistaient seulement – loutres, sangliers, cerfs, tigres et de nombreux oiseaux ont été éliminés… L’économie des hommes s’en est trouvée transformée. Des ports autrefois se retrouvent à 30 ou 80 km de l’eau, les pêcheurs ne pêchent plus (les Gaïa-intégristes diront « ne pèchent » plus !). Le climat est devenu plus sec avec hivers plus rigoureux et été plus arides. Les vents transportent les sels du fond marin asséché jusqu’à 500 km alentour, rendant les sols moins propres à la culture. La pollution par les engrais, véhiculée par les canaux d’irrigation qui reviennent dans le débit des fleuves, contamine les nappes phréatiques. Cette mauvaise qualité de l’eau à l’ère soviétique a entraîné une nette augmentation des affections intestinales et des cancers de l’œsophage.
La chute de l’URSS a permis d’entreprendre des travaux d’aménagement, notamment une digue pour retenir une partie des eaux du Syr-Daria, et il semble en 2007 que le niveau de la mer d’Aral soit remonté bien plus vite que les experts ès catastrophes ne l’anticipaient. Une région spéciale, la Sin Daria a été créée en 1973 pour gérer irrigation et cultures.
Justement, un poste frontière se dresse sur la route. Encore un héritage du soupçon et du contrôle politique soviétique. Une frontière est ainsi érigée entre chaque région, tout comme l’octroi chez nous sous l’Ancien Régime. C’est la « porte de Tamerlan », entre deux montagnes, qui nous ouvre le chemin de Samarcande. Par ce défilé à l’est, les caravaniers venus de Chine abordaient la ville. La rivière Sanzar (« endroit caillouteux ») coule à l’envers : vers l’est et pas vers l’ouest comme toutes les autres rivières d’Ouzbékistan. La légende veut qu’une mère ayant perdu son bébé dans la rivière ait prié Allah. Le Dieu a inversé le cours pour rendre son bébé à l’implorante. A la montagne Gourista commence le désert de sable rouge. La rivière Zarafshan (« l’eau qui porte l’or ») a livré du métal et irrigué les alentours de Samarcande avant que l’Amou-Daria n’ait baissé en raison des grands travaux du XXe siècle.
Samarcande est située au centre du pays, dans la vallée de la Zeravchan. Y sont produits du thé, du textile, des engrais et des pièces de moteur. Ancienne Maracanda, Samarcande fut la capitale de la province perse de Sogdiane, conquise par Alexandre le Grand en 329 avant, puis par les Arabes en 712. Elle fut presque entièrement détruite par Gengis Khan pour devenir en 1369 la capitale de l’empire de Tamerlan. Les Ouzbeks s’en emparèrent en 1500. La ville compte quelques 390 000 habitants.
Samarcande se divise aujourd’hui en trois : 1/ l’ancienne ville, inhabitée ; 2/ la vieille ville ; 3/ la ville moderne, administrative. Ce soir, nous logeons à l’hôtel Orient Star, dans la ville moderne. Le bâtiment est neuf, mais construit sur un thème traditionnel. L’ensemble a un air de mosquée et le restaurant est situé sous la coupole. Un jardin sur l’arrière offre sa détente, avec piscine, mais elle est en cours de récurage ce soir. Un thé de bienvenue nous est servi dans le hall, peut-être pour vérifier que les chambres sont bien prêtes. Abricots secs, raisins secs, cacahuètes, tous produits de la région proche, accompagnent le thé brun comme du temps des caravanes.
Nous dînons tôt, vers 19 h, pour tenter d’avoir un sommeil long et réparateur après notre nuit blanche d’avion. D’ailleurs, une coupure de courant intervient pile à 21 h, pour on ne sait quelle raison. Tout le quartier est concerné. Le lit est encore à faire, seul le drap de dessous est mis, celui de dessus reste plié. C’est à la lampe frontale que je m’en débrouille.









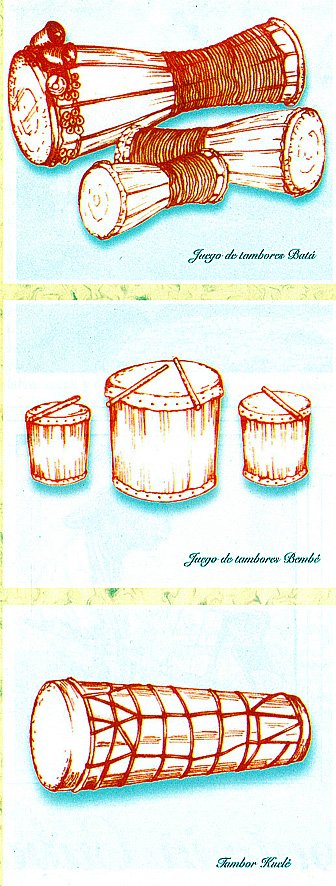



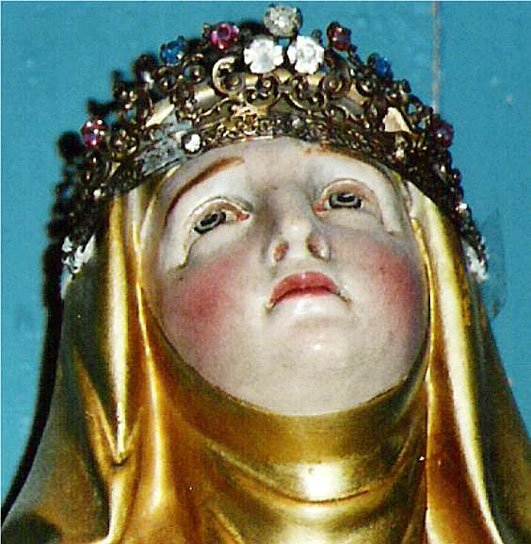













Commentaires récents