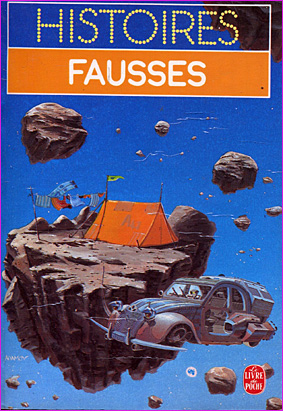
Faites l’humour, pas la guerre, telle semble être la raison d’être de ce recueil de nouvelles de la science-fiction américaine des années 1950 à 1980 environ. Elles sont présentées de façon assez cuistre au milieu des années 80 par Demètre Ioakimidis, anthologiste de SF né en Italie, résidant suisse et de nationalité grecque…. Mais on peut zapper la préface sans aucun problème, les distinguos de linguistique universitaire n’ayant aucun intérêt littéraire. Ce ne sont pas moins de seize récits qui montrent combien les choses ne sont pas ce qu’elles semblent et que tout, au fond, reste imprévu, même dans l’imaginaire.
Observez d’abord les livres qui s’envolent – littéralement – en battant des pages de couverture pour rejoindre la migration vers les forêts originelles. Ecologique mais bizarre, non ? Comme si l’ignorance était notre futur – durable. C’est ensuite un poêle hollandais qui « irrite » suffisamment un soulier pour que celui-ci s’anime et se carapate tandis que le savant fou qui l’a « inventé » convoque la presse et les sommités universitaires. C’est encore le coffre-fort absolu, celui qui fuit quand on l’approche, invulnérable aux rets, aux pièges et au lance-flamme, qu’un millionnaire en faillite tente de récupérer pour les (faux) diamants qu’il contient. Ou un docteur robot surnommé Tic-Tac qui vous sait malade avant même que vous ne lui parliez et qui vous enferme dans son hôpital mutualiste afin de persévérer dans sa fonction : qui n’a pas connu un docteur de ce genre ? Knock n’est pas le seul à vous persuader de recourir à ses indispensables soins.
Dans l’espace, rien à bouffer : lorsqu’on débarque sur une planète lointaine où se trouvent des êtres vivants, comment savoir si ce qu’ils mangent est bon pour nous ? Le poison d’un homme est peut-être la délectation de l’extraterrestre. De même la colonisation des planètes pour exploiter ses matières premières : la manière habituelle (forte) est-elle la bonne ? Evelyn E. Smith, adroite polygraphe née en 1927, met en scène deux fils à papa, l’un d’amiral, l’autre de sénateur, entrés dans l’armée spatiale parce que trop sensibles et… en bref trop chochottes. Le commandement les envoie seuls sur une planète maudite où toutes les expéditions précédentes pour récupérer un minéral se sont fait massacrer : quand on est inverti, autant mourir en héros pour masquer l’opprobre sociale. La nouvelle a été écrite en 1962, autrement dit dans un autre monde. Mais il s’avère que le couple des deux jeunes hommes s’en sort à merveille. Au lieu de s’imposer, il se donne en exemple ; au lieu d’interroger, il se laisse observer. Leur goût pour aménager le baraquement standard de l’armée, leur artisanat aux couleurs délicates, séduisent tant les indigènes, eux aussi sensibles à l’art, qu’ils leurs apportent les fameuses pierres requises par l’expédition : il faut de tout pour faire un monde. Pour d’autres, c’est la vie de pionnier qui importe et, lorsque les semblables rappliquent, c’est la fuite immédiate vers l’inconnu – même si l’épouse souhaite se fixer. Mais pourquoi pas d‘enfants ?
Lorsque les aliens envahissent la Terre, c’est pour la soumettre, à la Poutine, miroir de notre désir d’asservir les planètes. Obéissez et vous serez préservés ; résistez et vous serez pulvérisés. Le général Milvan des hordes galactiques a tout du Vladolf Poutler avec ses « 2m10, musclé à rendre jaloux un professeur de culture physique et noblement revêtu d’un tissu aussi chatoyant que collant (…) le front superbe, les yeux lumineux très écartés – il avait tous les attributs d’un être supérieur » – ce qu’il croit être. Sauf qu’il n’est sans aucune humanité : « une flotte aérienne sympathisante détruite sans avertissement ; une douzaine de villes bombardées avec une efficacité impitoyable… Cela, ajouté à l’arrogant sourire de mépris errant sur ses lèvres » p.188. Il a tout de Poutine, ce conquérant de Lebensraum galactique. Mais il trouve plus malin que lui, et plus fort, cela va de soi : Satan en personne, qui considère la Terre comme sa chasse gardée et renvoie Milvan Poutinovitch à ses étoiles. Qui sera donc le diable du Mongol nazi au Kremlin ?
Il y a d’autres histoires, comme celle de ce craqueur de sécurité bancaire, originalement présentée ; de ces voyages dans le temps qui cherchent à modifier le présent mais n’y parviennent jamais parce que le présent… est toujours présent, sinon il ne serait pas « le » présent, vous comprenez ? Ou ce vieux cinéphile qui, lassé des scies et convenances des scénarios de films, finit par les modifier mentalement à l’écran sans que la bobine en soit changée, pour le plus grand plaisir des autres spectateurs. De l’inconvénient aussi de se retrouver homme invisible, un matin au réveil, pour avoir absorbé la veille une pilule de laboratoire pharmaceutique avide de vendre. L’épouse a du mal à s’y faire, la fille de 10 ans s’évanouit d’horreur, mais le petit de 4 ans trouve cela merveilleux : c’est toujours son papa. Heureusement, l’antidote existe car c’était un secret du Pentagone, le labo travaillait pour eux.
Une exploration dans les antres de la machine à imaginer les futurs qui, cette fois, en rit franchement. Ce qui fait du bien en ces temps retrouvés de guerre et de nationalisme, d’occupants et de collabos. Les années 1980 avaient du bon !
Histoires fausses – La grande anthologie de la science-fiction, Livre de poche 1984, 409 pages, occasion €1,54







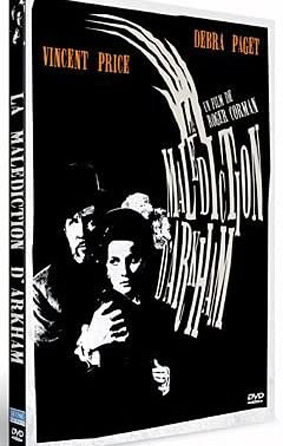






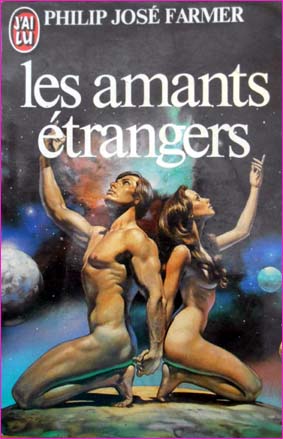


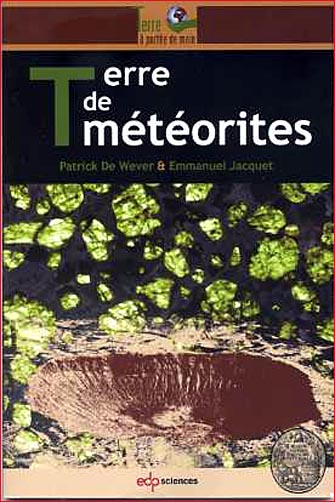
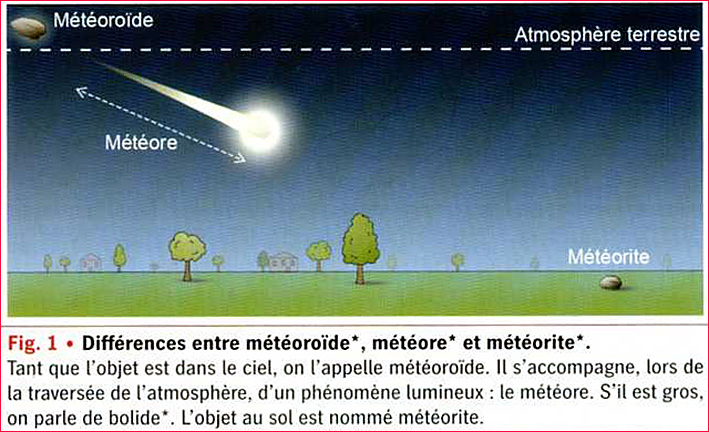
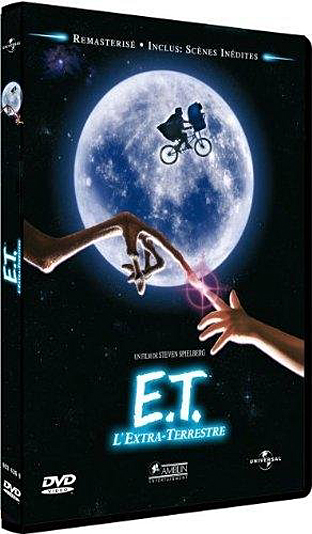



Commentaires récents