Tombé en amour dès 9 ans pour ces pierres tombées du ciel, Emmanuel Jacquet est maître de conférences au Museum national d’histoire naturelle et continue d’étudier de très près les composants des météorites. Avec le professeur du même Musée Patrick de Wever, ils composent un petit livre très illustré sur ces roches venues de l’espace qui fascinent les hommes superstitieux, mais offrent aussi aux scientifiques des renseignements précieux sur la formation du système solaire.
Il ne faut pas confondre ce qui passe dans le ciel comme une étoile, ce qui file dans l’atmosphère comme un bolide et ce qui tombe sur le sol comme une pierre, tuant (rarement, 90 cas en moyenne par an), occasionnant des dégâts (souvent), et jonchant le sol des déserts. L’objet qui brille et passe est soit une comète (glace et poussières), soit un astéroïde (roche majoritaire) ; celui qui pénètre notre atmosphère est un météore, appelé souvent étoile filante parce qu’il brille intensément en brûlant dans l’air terrestre ; ce qui reste et tombe est plus ou moins gros et plus ou moins chaud (écorce brûlante et noyaux glacé, comme une omelette norvégienne). On évalue à 36 000 tonnes par an cette matière extraterrestre qui impacte la surface de notre planète, mais les particules sont pulvérisées et seulement 6000 tonnes par an sont des fragments visibles. Le risque de voir tomber une météorite de 50 m de diamètre semble ne surgir que tous les 1000 ans.
Lorsque l’on trouve un gros caillou bizarre, ce n’est pas forcément une météorite ; on la reconnait à sa croûte brûlée, à son poids et à son magnétisme, tous deux dus aux minéraux métalliques qui la composent. Mais la marcassite (sulfure de fer) ressemble lui diablement sans en être une : quand on le casse, on constate un cœur de fibres en rayons.
« On admet aujourd’hui que la majorité des météorites proviennent des astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter » p.21. Pas de fantasmes sur les galaxies lointaines… Jupiter a perturbé l’accrétion des poussières en véritable planète et conserve en équilibre instable un anneau de matière, relique du système solaire primitif (avant la formation des planètes). Certaines météorites renferment des minéraux inconnus sur Terre (carbures de titane ou de zinc, molybdène, nitrures de silicium), certains même datant d’avant la formation du système solaire (carbure de silicium).
Les comètes tombent soit parce que leur trajectoire a été déviée par un choc avec un autre astéroïde, soit par « l’effet Yarkovsky » qui explique comment le côté chauffé plus que l’autre exerce une petite poussée sur l’astéroïde qui change peu à peu sa trajectoire.
La Terre est composée aux trois quarts d’océans, mais 188 cratères de météorites sont visibles sur les terres émergées. Meteor Crater, en Arizona, mesure 1.2 km de diamètre et provient d’une météorite d’une vingtaine de mètres de diamètre qui s’est écrasée à 50 000 km/h il y a 50 000 ans en balayant tout dans un rayon de 15 à 20 km. Rochechouart est la gloire française en termes de cratère : situé entre Limousin et Charente, il fait 21 km de diamètre (mais l’érosion l’a en partie effacé). Il a provoqué un tremblement de terre de magnitude 8.2 et un raz de marée dont on retrouve les traces jusqu’à 1300 km alentour – mais c’était il y a 2 millions d’années. Le plus célèbre cratère se situe sur la péninsule du Yucatan au Mexique ; on en a fait (faussement) l’origine de la disparition des dinosaures (amplification et déformation typique des médias, selon les auteurs). Le bolide avait 10 km de diamètre et est tombé il y a 66 millions d’années, engendrant une pulvérisation équivalent à « 100 millions de bombes d’Hiroshima » (p.35), un tsunami et un gigantesque incendie qui a obscurci l’atmosphère terrestre et l’a refroidie pendant plusieurs années.
Le lecteur se souvient probablement de la météorite de Tcheliabinsk, explosant dans l’atmosphère de l’Oural le 15 février 2013 et abondamment filmée par les caméras embarquées des voitures. D’un diamètre de 15 à 17 mètres, elle a explosé six fois, se diffusant sur une ellipse de 60 x 2 km en fragments qui n’ont pas faits de dégâts – mais les ondes de choc, si ! Impacts sur les murs, les voitures, bris de verre. La météorite de Draveil (Essonne) en 2011 a lâché des fragments jusqu’à 5.2 kg, fracassant « une tuile du toit de Madame Comette (ça ne s’invente pas !) » p.60.
Précis, largement imagé, clair et maniant l’humour comme on le voit, ce petit livre m’évoque l’enchantement de mon enfance avec l’encyclopédie hebdomadaire Tout l’Univers. Quiconque s’intéresse à ces objets venus de l’espace y trouvera un condensé du savoir complet actualisé, notamment le point sur l’origine de la vie et les relations des météorites avec la politique (mais si, il y en a !) – tout cela facile à lire et fort plaisant.
Patrick de Wever et Emmanuel Jacquet, Terre de météorites, 2016, EDP Sciences, 88 pages, €12.00
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

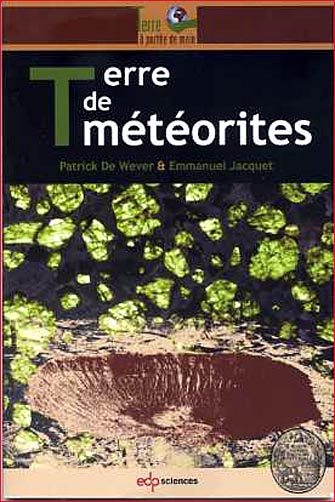

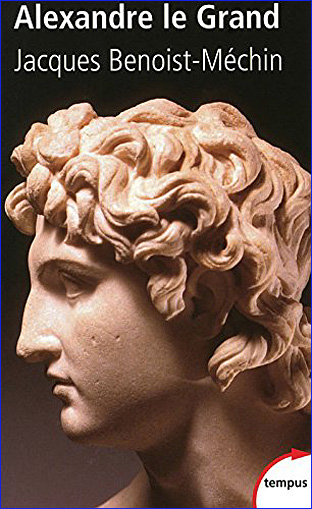
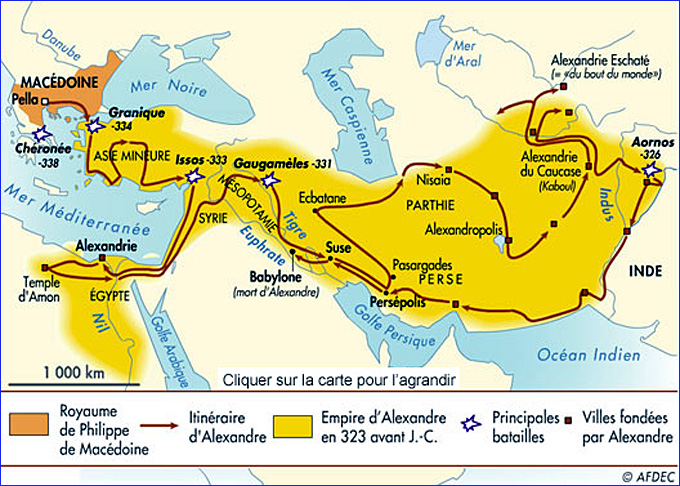
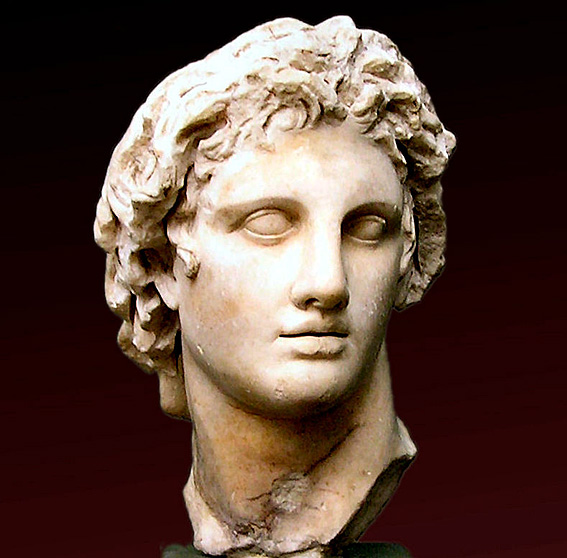
Commentaires récents