
La fin du monde vue par John Carpenter est à la fois très américaine et très horrifique. Les pouvoirs d’un écrivain vont-ils jusqu’à faire croire à sa fiction comme d’une réalité ? Stephen King était alors à son acmé et ses livres, devenus des films, faisaient croire à une « autre » réalité, une « vérité alternative » comme dira plus tard le macho à mèche platine. Des monstres existent, qui dominent le monde (ou le voudraient bien), lâchés par « le diable » biblique, éternel opposant au Bien. Le Complot est partout et, comme dans H.P. Lovecraft, le mort saisit le vif pour le faire s’entretuer.
John Trent est rationnel (Sam Neill). Enquêteur indépendant pour les assurances, il a du métier pour traquer les fraudeurs et dénicher les arnaques. Lorsqu’un autre assureur veut l’engager au nom de l’éditeur Arcane pour tout savoir de la disparition de l’auteur à succès Sutter Cane, dont les livres d’horreur s’arrachent, il est pris à partie dans le café par un dément armé d’une hache (comme dans Shining). Il se révélera comme l’agent littéraire de Sutter Cane, contaminé par son auteur. L’éditeur (Charlton Heston), qui attend le dernier manuscrit de Cane et a déjà vendu les droits pour un film, engage John Trent pour le retrouver. Il lui joint son assistante, une executive nymphowomane (Julie Carmen) plutôt cynique. Tous deux doivent rechercher la ville de Hobb’s End où Sutter Cane situe ses romans.

Trent est un incurable sceptique, il ne croit pas à une « vraie » disparition mais à un coup de pub. Rien de tel que de s’évanouir sans donner de nouvelles, comme Agatha Christie en son temps, pour faire parler de soi et revenir en triomphe. Le général de Gaulle l’a réussi en 1968. Mais Styles lui affirme que les lecteurs de romans de Cane sont atteints psychologiquement, il n’a qu’à lui-même essayer. De fait, Trent est sujet à des hallucinations répétitives pendant qu’il lit les romans d’horreur de Cane, genre qu’il n’a jamais abordé ni aimé. Il voit un flic tabasser une raclure dans une ruelle se transformer en zombie sanglant, ou même s’asseoir à ses côtés sur le canapé.

Mais, comme il réfléchit par lui-même au lieu de se laisser influencer, John Trent découvre que les dessins des couvertures des livres, découpés, composent en puzzle les contours du New-Hampshire (région favorite de Stephen King pour ses romans). La ville de Hobb’s End, non répertoriée sur les cartes ni même au service postal, pourrait s’y trouver. Rien de mieux, pour « toucher » la réalité, que de s’y rendre. C’est un long chemin et le couple de travail doit rouler de nuit. Or c’est la nuit que les cauchemars rôdent. Un gamin en vélo qu’un carton dans les rayons fait vibrer, un vieux qui se jette sur la voiture puis repart comme si de rien n’était, un tunnel interminable qui ne dure que trente mètres.
Au matin, c’est Hobb’s End. Ils sont arrivés et la ville inconnue est déserte. Dans l’hôtel cité dans les romans de Cane, ils prennent chacun une chambre. La tenancière est une petite vieille qui repousse du pied quelque chose sous le comptoir, le spectateur verra bientôt quoi. Un étrange tableau voit ses personnages changer dès qu’on tourne la tête. La réalité se distord subtilement comme s’il existait un « autre monde possible ». En pire, un indicible comme chez Lovecraft.
L’église de la ville a des clochers en bulbe, comme les églises orthodoxes, ce qui n’apparaît pas très catholique : l’orthodoxie russe n’a-t-elle pas accouché du communisme soviétique ? Lorsqu’ils s’y rendent, un phénomène étrange se produit : une bande d’enfants fuit dans la campagne. Des pick-ups emplis d’adultes armés se présentent à la porte de l’église. Un commerçant somme la créature à l’intérieur de lui rendre son Johnny, un petit blond à la Stephen King, mais les portes s’ouvrent et se referment et le gamin impassible est aspiré à l’intérieur. Des rottweilers sortent de nulle part et attaquent les adultes, qui s’enfuient en désordre. Ici le Mal se répand et commence par les enfants, non encore civilisés par l’église.
Plus tard, Linda Styles peut rencontrer Sutter Cane (Jürgen Prochnow) dans la sacristie fermée d’une porte en bois, après une série de croix à l’envers. Il met la dernière patte à son dernier roman, intitulé L’Antre de la folie. En l’obligeant à lire la dernière page, il la rend folle, comme le lecteur moyen. Si la disparition était à l’origine un coup de pub, l’auteur a réussi à distordre la réalité pour la rendre vraie. Il suffit d’y croire. Désormais elle et John sont dans le monde à l’envers, celui de Cane, qui réveille des monstres assoupis dans les profondeurs de la terre (ou de la psyché). Ce sera la fin de l’humanité, peu digne de subsister en raison de sa propension à la tuerie. Cane dira même à Trent qu’il est un personnage inventé de ses romans, un avatar qui n’a aucune autre réalité que celle qu’il lui donne. Il se prend pour Dieu, le dieu du Mal, et se prépare à lâcher ses légions sur le monde.
Linda ne peut revenir au monde réel car elle « sait » pour avoir lu, comme Eve a mangé le fruit. John y revient en étant poursuivi par des monstres lovecraftiens et se retrouve au carrefour de deux routes de campagne. Un gamin à la Stephen King – 13 ans, blond, en vélo et livreur de journaux – lui apprend où il se trouve. De retour à New York, l’enquêteur rend compte de sa mission à l’éditeur et lui dit avoir brûlé le manuscrit qui lui a été confié par Linda sur ordre de Cane. Mais, distorsion du réel, le manuscrit a bien été livré un mois avant, par Trent lui-même, il est dans toutes les librairies et le film sort en salles.

Effondré, John Trent est interné comme fou après avoir massacré à coup de hache un jeune qui sortait d’une librairie avec un roman d’horreur de Sutter Cane. « Vous aimez ? – Beaucoup. – Alors vous savez comme cela doit finir » – et il le tue. Son histoire est racontée à son psychiatre, le docteur Wrenn (David Warner) – ce qui fait le début du film. Le psy juge à la fin du film qu’il s’agit d’une hallucination mais sort de la cellule capitonnée avec un doute. De fait, Trent s’éveille le lendemain aux bruits d’une jacquerie à la Trump, la foule des fans se ruant sur les institutions à coup de battes de baseball et de haches pour démolir « le système » et traquer les tenant du Complot pseudo maléfique. La radio annonce que le monde est envahi de lecteurs mutants qui massacrent et s’entretuent tandis que des monstres sortent de l’enfer – ou de l’espace.

Dans un cinéma désert, qui passe L’Antre de la folie tiré du roman, John Trent assis avec un gigantesque seau de pop-corn dans les mains (la Malbouffe par excellence du Système), rit de se voir à l’écran dans les aventures qu’il vient de vivre. La fausse réalité du cinéma n’est pas reconnue par lui comme vraie, il fait partie des rares non contaminés de l’espèce humaine.
Ce qui rend le film « culte » aujourd’hui est qu’il a prédit la tendance à croire plutôt qu’à voir, la folie complotiste et l’invasion du Capitole par des hordes de trumpistes convaincus de combattre le Mal déguisés en chamanes barbares. Eux qui réveillent les démons de la discorde et de la pulsion de mort, l’envers du Beau, du Vrai, du Bien que les chrétiens non superstitieux ont repris des Grecs.
DVD L’Antre de la folie (In the Mouth of Madness), John Carpenter, 1995, avec Sam Neill, Jürgen Prochnow, David Warner, John Glover, Julie Carmen, Metropolitan video 2007, 1h31, €9.99 blu-ray €10.00










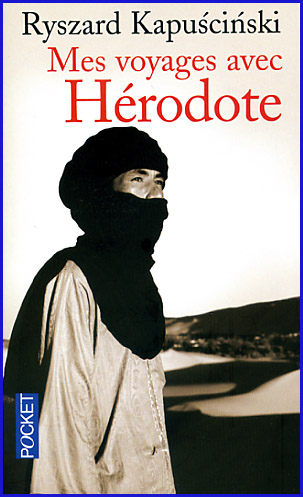


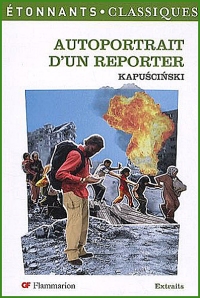
Commentaires récents